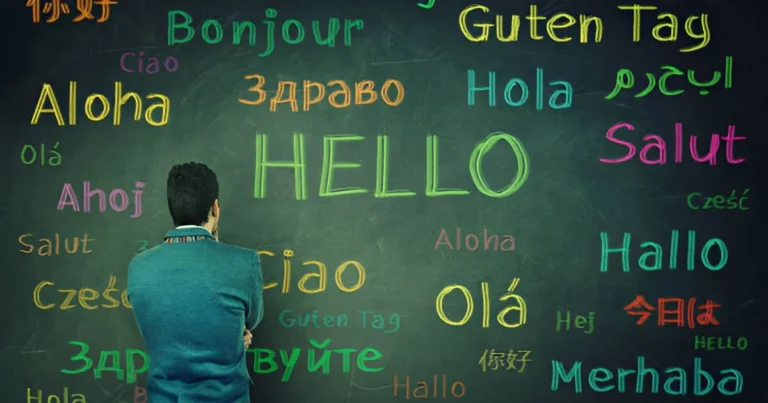Quand les romans sculptent le cerveau
Un inconnu s’assoit dans un train, son regard se perd à travers la vitre, une lettre froissée dans la poche de sa veste. Vous ne le connaissez pas. Pourtant, en quelques phrases, le roman vous invite à entrer dans ses pensées, à ressentir ses dilemmes, à anticiper ses gestes. Et vous acceptez. Sans effort, vous devinez ce qu’il ne dit pas, comme si ses silences étaient des mots. Ce pacte silencieux entre lecteur et personnage, cette immersion dans la vie intérieure d’un autre, pourrait bien être l’un des exercices cognitifs les plus puissants que nous accomplissons au quotidien, souvent sans en avoir conscience.
Depuis peu, les sciences du cerveau s’intéressent de très près à ce geste ordinaire qu’est la lecture des romans . Et ce qu’elles y découvrent dépasse largement le plaisir ou l’évasion. Lire un roman active, stimule, et même transforme certaines structures cérébrales liées à notre capacité de comprendre les intentions d’autrui, de décrypter des comportements complexes, ou de naviguer dans des relations sociales nuancées. En d’autres termes, lire façonne notre perception du monde social, et cette transformation laisse une trace mesurable dans le cerveau.
Le cerveau en narration : quand les mots deviennent des connexions
L’une des études pionnières sur le sujet a été réalisée en 2013 par Gregory S. Berns et son équipe au sein de l’Université Emory. Les chercheurs ont proposé à vingt et un étudiants de lire, pendant neuf jours consécutifs, un roman historique intitulé Pompeii de Robert Harris. Chaque matin, les participants passaient une IRMf (imagerie par résonance magnétique fonctionnelle) afin d’observer les modifications de leur connectivité cérébrale. L’expérience a révélé une augmentation significative de l’activité dans le gyrus postcentral gauche, une région impliquée dans la perception des sensations corporelles. Ce résultat a été interprété comme un indice d’incarnation neuronale, le cerveau des lecteurs simulerait les expériences physiques des personnages, comme s’ils les vivaient eux-mêmes.
Mais l’effet ne s’arrête pas à la seule perception corporelle. En 2024, la chercheuse Feyruz Usluoğlu, de l’Université de Toros, a publié une revue qui éclaire un autre aspect fascinant de la lecture de fiction et son impact sur les réseaux cérébraux impliqués dans la compréhension d’autrui. En s’appuyant sur des données issues de l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) et de tests comportementaux, elle montre que lire un roman active ce qu’on appelle le « réseau par défaut » du cerveau. Ce réseau est un ensemble de régions cérébrales qui s’activent lorsque l’on réfléchit à soi-même, aux autres, ou à des situations sociales complexes, en somme, lorsqu’on se met à la place d’autrui.
🔗 À lire aussi : La science des mots : Ce que les neurones de la lecture nous dévoilent
Ce que révèle cette étude, c’est que plus une personne lit de fiction, plus la communication entre les zones du cerveau impliquées dans le langage et celles dédiées à la compréhension sociale devient fluide et renforcée. Cela suggère que la lecture littéraire agit comme une forme d’entraînement pour notre capacité à mentaliser, c’est-à-dire à imaginer ce que ressent ou pense une autre personne. Loin d’être un simple passe-temps, la fiction littéraire deviendrait ainsi une sorte de gymnastique mentale quotidienne qui renforce nos aptitudes à naviguer dans un monde social de plus en plus complexe.
Une autre étude, menée par des chercheurs américains, a permis de mieux comprendre comment la fiction littéraire peut affiner notre capacité à saisir les pensées, les intentions et les émotions d’autrui. Pour explorer cette idée, les chercheurs ont conduit cinq expériences. Les participants ont été répartis au hasard pour lire soit un extrait de fiction littéraire, soit un texte de fiction populaire, soit un passage de non-fiction. Juste après la lecture, les chercheurs ont évalué leur aptitude à comprendre les états mentaux d’autrui à l’aide de tests psychologiques conçus pour mesurer la sensibilité aux émotions et la capacité à faire des inférences sociales.
Les résultats ont révélé que les lecteurs de fiction littéraire obtenaient des scores significativement plus élevés que ceux des autres groupes. Ils étaient, par exemple, plus aptes à deviner les émotions d’un personnage à partir de son regard (comme dans le Reading the Mind in the Eyes Test) ou à comprendre ses intentions à partir d’indices contextuels subtils (comme dans le test de Yoni). Ce type de littérature, souvent caractérisé par des récits complexes, des personnages ambigus et des situations ouvertes à l’interprétation, semble donc stimuler une lecture plus active. Le lecteur y est sans cesse amené à combler les non-dits, à interpréter les silences, à suivre les mouvements intérieurs des personnages. En s’exerçant à déchiffrer ces univers imaginaires, il renforcerait peu à peu sa propre capacité à comprendre les autres dans la vie réelle.
Ces résultats ont marqué un tournant dans les recherches sur la cognition sociale, car ils démontrent, avec des données expérimentales solides, que la littérature peut exercer un effet positif sur notre capacité à comprendre autrui, affinant ainsi notre intelligence sociale. Une démonstration remarquable que la lecture, loin d’être un acte solitaire, est profondément sociale.
Ce lien entre lecture littéraire et compréhension d’autrui ne se limite pas à des effets immédiats. D’autres recherches ont montré que, sur le long terme, cette pratique régulière agit comme un véritable entraînement pour notre cerveau social. Lorsque nous suivons les pensées d’un personnage complexe, lorsque nous tentons de comprendre ses hésitations, ses contradictions, ses blessures cachées, nous sollicitons les mêmes circuits cérébraux que ceux mobilisés dans nos propres interactions sociales. Et plus nous les activons, plus ils deviennent efficaces. C’est notamment le cas du cortex préfrontal dorsomédian, une région du cerveau impliquée dans la capacité à attribuer des intentions, à imaginer ce que l’autre pense ou ressent. Il a été observé que cette zone s’active davantage chez les personnes qui lisent fréquemment des romans, qu’ils soient lus ou simplement écoutés. Ainsi, la lecture de fiction, en nous confrontant à la complexité humaine, agit comme un entraînement naturel de notre cerveau social. L’habitude de lire des romans renforcerait de manière progressive notre aptitude à décoder les émotions, à interpréter les intentions et à faire preuve d’empathie, autant de compétences essentielles pour vivre ensemble.
🔗 Découvrez également : Dans le cerveau d’un écrivain (1/6) : Planification ou improvisation, que dicte votre cerveau ?
Quand lire devient une forme de thérapie
Au-delà des individus dits neurotypiques, la lecture de fiction pourrait aussi avoir des effets bénéfiques pour des personnes atteintes de troubles psychiatriques. C’est ce qu’ont mis en lumière les recherches du professeur József Fekete et de son équipe à l’Université de Pécs. Leur travail s’est intéressé à des patients souffrant de schizophrénie ou de troubles bipolaires, deux pathologies souvent marquées par des difficultés à interpréter les intentions d’autrui ou à se repérer dans les interactions sociales.
Pour évaluer les effets de la lecture sur ces compétences sociales, les chercheurs ont utilisé un outil spécifique : le Short Story Task (SST). Cette tâche consiste à faire lire aux participants une courte nouvelle littéraire, puis à leur poser des questions visant à évaluer leur capacité à comprendre ce que ressentent ou pensent les personnages. Les résultats suggèrent que les patients exposés à ces récits obtiennent de meilleurs scores aux tests de mentalisation que ceux qui ne lisent pas ou lisent des textes purement informatifs. Autrement dit, après avoir lu de la fiction, ces patients se montraient plus aptes à saisir ce que pense ou ressent un personnage, à déceler ses intentions ou à interpréter correctement une interaction sociale.
Ces résultats sont loin d’être anecdotiques. Ils suggèrent que la fiction littéraire, même à petite dose, peut jouer un rôle actif dans la réactivation des compétences sociales, là où elles sont fragilisées. Les histoires offrent un cadre structuré et sécurisant, où les émotions et les relations peuvent être explorées sans pression. En lisant, le patient exerce son cerveau à faire ce qu’il peine parfois à accomplir dans la vie réelle : comprendre l’autre. Et c’est justement dans cette mise en situation fictive que réside toute la force thérapeutique de la littérature.
🔗 En lien avec ce sujet : Écrire pour renaître : Entre catharsis et encre rebelle
À travers ces données, la lecture de fiction s’impose comme un outil supplémentaire à la fois simple et puissant, capable de retisser du lien social là où il s’est dénoué. Elle devient une passerelle entre le monde intérieur du lecteur et celui des autres. Sur le plan clinique, elle offre des perspectives nouvelles pour accompagner les personnes en souffrance psychique. Sur le plan éducatif, elle rappelle que les romans ne sont pas de simples distractions, mais des instruments de formation humaine. Et sur le plan sociétal, elle redonne à la lecture sa pleine valeur, celle d’un acte profondément transformateur.
Ainsi, lire un roman, ce n’est pas seulement suivre une intrigue, c’est mobiliser des réseaux neuronaux complexes, activer des compétences sociales subtiles, et peut-être, à force de lectures répétées, modifier durablement notre manière de voir le monde. À l’ère de la pensée rapide et des interactions superficielles, les romans pourraient bien rester l’un des derniers sanctuaires de la complexité humaine, et un outil d’entraînement précieux pour notre cerveau social.
Références
Berns, G. S., Blaine, K., Prietula, M. J., & Pye, B. E. (2013). Short- and long-term effects of a novel on connectivity in the brain. Brain Connectivity, 3(6), 590–600.
Kidd, D. C., & Castano, E. (2013). Reading literary fiction improves theory of mind. Science, 342(6156), 377–380.
Usluoğlu, F. (2024). How Does Reading Fiction Affect Us? International Journal of Behavior, Sustainability and Management, 11(21), 50–58.

Sara Lakehayli
Docteur en neuroscience cliniques et santé mentale, PhD
Membre associée au Laboratoire des Maladies du Système Nerveux, Neurosensorielles et du Handicap, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca.
Professeur à l'école supérieure de psychologie