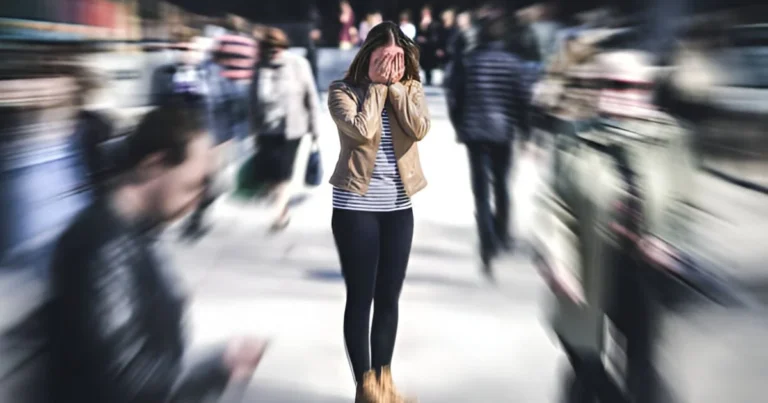Les faux souvenirs : Quand notre mémoire nous joue des tours
Il suffit d’un mot, d’une image, d’un visage entrevu dans la foule… et soudain, un souvenir refait surface. Il s’impose à nous avec la précision d’un instant réellement vécu. Nous nous en souvenons, en sommes convaincus. Du moins, c’est ce que nous croyons. Car il arrive que ce souvenir n’ait jamais existé. Non pas altéré ou flou, mais entièrement inventé par notre cerveau, et pourtant ressenti comme vrai.
La mémoire humaine fascine, car elle est l’un des piliers de notre identité. Mais à mesure que les sciences cognitives la scrutent, un paradoxe apparaît : cette fonction en apparence stable est d’une malléabilité vertigineuse. Loin d’être un simple outil d’enregistrement, notre mémoire reconstruit, modifie, et parfois… invente. Les faux souvenirs, ou false memories, ne sont pas de simples erreurs d’attention. Ils sont la preuve troublante que ce que nous tenons pour vrai peut être entièrement fabriqué par notre cerveau.
Une mémoire manipulable : Les leçons d’un centre commercial
Le champ de la psychologie expérimentale a connu un tournant décisif avec les recherches d’Elizabeth Loftus, pionnière de l’étude des faux souvenirs. L’étude désormais célèbre, connue sous le nom de « Lost in the Mall » (« perdu dans un centre commercial »), conduite initialement en 1995, avait pour objectif d’examiner la vulnérabilité de la mémoire autobiographique à l’implantation de souvenirs entièrement fictifs. Loftus cherchait à démontrer expérimentalement que de simples suggestions verbales pouvaient suffire à créer chez un individu la certitude d’avoir vécu un événement qui n’avait jamais eu lieu.
Loftus et Pickrell ont recruté des participants adultes auxquels ils présentaient quatre courts récits décrivant des événements supposément vécus durant leur enfance. Trois de ces récits étaient authentiques et avaient été vérifiés auprès des proches des participants. Le quatrième récit était totalement fictif et décrivait une situation crédible mais inventée : l’enfant s’était perdu dans un centre commercial, avait ressenti une grande inquiétude et avait été secouru par un adulte inconnu. Pour maximiser la crédibilité de ce récit fictif, les chercheurs l’accompagnaient de détails réalistes, notamment le nom et l’emplacement du centre commercial fréquenté durant l’enfance des sujets. Durant plusieurs séances espacées dans le temps, les participants étaient invités à lire ces récits et à se souvenir d’autant de détails que possible. À chaque session, ils tentaient de fournir des souvenirs précis, et les chercheurs les encourageaient à compléter ces souvenirs par des détails supplémentaires. Ils étaient également invités à exprimer leur degré de certitude quant à la réalité de ces événements rapportés.
Les résultats furent saisissants. Approximativement 25 % des participants finirent par affirmer se souvenir explicitement de cet événement fictif comme s’il s’agissait d’un souvenir authentique. Plus impressionnant encore, certains participants enrichissaient spontanément ce récit fictif en fournissant des détails très précis et émotionnellement chargés : sensations de peur et d’anxiété, détails sur les vêtements portés ce jour-là, voix entendues, et même parfois des visages ou des odeurs ressenties pendant l’événement inventé. Ces « souvenirs » devenaient alors vivaces, stables et souvent chargés d’émotion, ne se distinguant plus, dans le cerveau du participant, de souvenirs réels.
Ces résultats suggèrent que la mémoire autobiographique est loin d’être une archive fidèle et statique. Au contraire, elle fonctionne comme un système dynamique de reconstruction permanente, influençable par des informations extérieures crédibles. Loftus interpréta ces résultats en soulignant que le cerveau ne se contente pas d’enregistrer passivement le passé, mais tente constamment de créer une narration cohérente et plausible de nos expériences passées. Lorsque la mémoire est confrontée à des récits suffisamment crédibles mais erronés, elle peut « combler les vides » en produisant un souvenir fictif qui semble aussi réel qu’un souvenir authentique.
Faux souvenirs, vrais impacts
L’étude met en lumière les implications concrètes des faux souvenirs, notamment dans les domaines judiciaire et thérapeutique, où la mémoire est souvent perçue comme une preuve fiable. Pourtant, les recherches d’Elizabeth Loftus montrent qu’un souvenir peut être sincèrement rapporté sans jamais avoir existé. Une simple suggestion, un récit crédible ou une image modifiée peuvent suffire à créer une fausse mémoire, sans manipulation consciente. Ce phénomène remet en question la fiabilité des témoignages et soulève de sérieuses questions éthiques : comment interroger sans induire ? comment distinguer ce qui a été vécu de ce qui a été imaginé ?
Dans le champ thérapeutique, les enjeux sont tout aussi sensibles. Certaines techniques visant à faire remonter des souvenirs enfouis peuvent, malgré de bonnes intentions, induire des scènes entièrement fictives, surtout chez des personnes vulnérables, en quête de sens ou de réparation. Des patients finissent par se souvenir d’abus, de traumatismes ou d’épisodes fondateurs avec une intensité émotionnelle telle qu’il devient presque impossible d’en douter. Et pourtant, dans certains cas, ces souvenirs sont en grande partie, voire entièrement, le produit d’une élaboration progressive, sincère mais illusoire. Dans les deux contextes, surgissent ainsi des souvenirs puissants, émotionnellement chargés, parfois entièrement fabriqués… sans que la personne n’en ait la moindre conscience.
Cela montre à quel point notre mémoire est influençable. Contrairement à une caméra qui capterait chaque détail avec exactitude, notre cerveau ne garde pas un film complet de ce que nous vivons. Il enregistre plutôt des morceaux épars : une image, un son, une sensation, une émotion, parfois même un simple ressenti diffus. Ces fragments sont ensuite rassemblés pour former ce que nous appelons un souvenir.
Mais le plus étonnant, c’est ce qui se passe lorsque nous nous remémorons ce souvenir. On pourrait croire qu’il s’agit simplement de le « relire », comme on relit une page d’un livre. En réalité, c’est tout l’inverse, chaque rappel réactive le souvenir comme un fichier temporairement ouvert, qui peut alors être modifié avant d’être à nouveau « enregistré ». Ce processus, connu sous le nom de reconsolidation, rend le souvenir temporairement instable. Pendant ce laps de temps, il devient malléable, comme de l’argile chaude.
Sur le plan cérébral, ce processus mobilise un réseau complexe de structures interconnectées. L’hippocampe, logé dans le lobe temporal médian, joue un rôle central dans l’encodage initial et la réactivation des souvenirs épisodiques, il agit comme un index, reliant entre eux les fragments sensoriels, émotionnels et contextuels d’une expérience vécue. Le cortex préfrontal médian, quant à lui, intervient dans la métacognition et l’évaluation de la fiabilité d’un souvenir, participant activement à sa mise à jour lors de la reconsolidation. Le cortex temporal latéral, qui héberge de nombreuses représentations sémantiques, permet d’enrichir, ou parfois de fausser, un souvenir par des inférences, des associations ou des généralisations. Enfin, le système limbique, et en particulier l’amygdale, joue un rôle crucial dans la modulation émotionnelle, plus un souvenir est chargé émotionnellement, plus il devient instable, fragmenté et vulnérable aux interférences lors de sa reconsolidation.
Ainsi, un mot entendu, une suggestion implicite, ou une image marquante peuvent s’infiltrer dans un souvenir réactivé et être interprétée comme faisant partie intégrante du souvenir. Le souvenir transformé est ensuite « reconsolidé », c’est-à-dire fixé à nouveau dans la mémoire, mais sous une nouvelle forme. Et ainsi se construit parfois un faux souvenir.
Inventer pour se souvenir : Le paradoxe de la mémoire
Derrière le phénomène des faux souvenirs, c’est donc toute notre conception de la mémoire, et même de la vérité, qui vacille. Le souvenir, loin d’être une capsule temporelle, est une fiction crédible, une œuvre dynamique, mise à jour à chaque évocation. Cela ne signifie pas qu’il n’existe pas de véritables souvenirs, mais que chacun d’eux est, en un sens, une recomposition. La mémoire n’est pas là pour conserver le passé tel quel, mais pour fournir au présent une version exploitable du passé. Et ce processus, bien que faillible, permet de combler les vides, d’inférer du sens, de tirer des leçons. Il nous aide à donner de la cohérence à notre histoire personnelle, quitte à embellir, oublier, ou même inventer.
Mais à quoi bon un système aussi flexible, s’il peut nous conduire à des erreurs aussi convaincantes ? C’est justement cette souplesse qui fait sa force. Une mémoire totalement rigide, figée dans l’enregistrement brut du passé, serait inapte à l’adaptation. Pour apprendre, anticiper ou faire face à l’imprévu, nous devons pouvoir manipuler nos souvenirs, les réorganiser, les simplifier, y insérer des hypothèses. C’est en modifiant notre représentation du passé que nous donnons sens au présent, et que nous projetons notre avenir.
Cette capacité à recomposer, si précieuse au quotidien, a pourtant un revers, elle rend notre mémoire vulnérable aux illusions. Car lorsqu’un souvenir est lacunaire ou flou, notre cerveau cherche à lui donner du sens en comblant les vides. Il ne le fait pas dans un souci de vérité historique, mais dans une logique de cohérence psychologique. Ce qui compte, ce n’est pas tant ce qui s’est passé, que ce qui « aurait pu se passer » de manière crédible pour nous. Et cette logique, bien que pragmatique, ouvre la voie à l’erreur.
Par ailleurs, les faux souvenirs peuvent aussi remplir des fonctions identitaires et sociales. Ils nous aident à préserver une image cohérente de nous-mêmes, à raconter notre vie de manière continue, à nous sentir connectés aux autres. Même les souvenirs les plus biaisés peuvent répondre à un besoin de sens, d’explication ou de réconfort. Ils peuvent atténuer des blessures, justifier des choix, ou renforcer un sentiment d’appartenance à un groupe. Dans ce sens, ils agissent comme des outils psychologiques au service de notre stabilité émotionnelle et de notre intégration sociale. Autrement dit, la mémoire n’a pas pour mission première de restituer le passé à l’identique, mais de nous aider à vivre avec. Ce n’est pas une trahison de la vérité, mais une stratégie adaptative, une manière de rester fonctionnels, en paix avec nous-mêmes, et capables d’aller de l’avant malgré les incertitudes du passé.
Alors, peut-on se prémunir contre les faux souvenirs ? Pas totalement. Car l’un des aspects les plus déconcertants mis en lumière par Elizabeth Loftus, c’est qu’il est presque impossible de distinguer un souvenir réel d’un faux, lorsqu’on n’a pas accès à une preuve extérieure. Même les souvenirs fabriqués par suggestion peuvent être décrits avec un beaucoup de détails, vécus avec émotion, et défendus avec conviction, y compris lorsqu’ils sont biologiquement ou géographiquement impossibles. Ceci explique la force avec laquelle certains souvenirs sont affirmés, même lorsqu’ils sont faux. Et cela rend d’autant plus difficile leur détection car ils sont généralement indiscernables des souvenirs authentiques, du moins du point de vue subjectif.
Ainsi, la confiance que nous plaçons dans un souvenir n’est pas une garantie de sa véracité. Comme le montrent les travaux de Loftus, Brewin et d’autres chercheurs, la mémoire est un système actif, dynamique, profondément humain, parfois imprévisible, souvent reconstructif, mais toujours fascinant. En fin de compte, les faux souvenirs révèlent la nature même de notre rapport au monde. Ils nous disent que nous sommes des narrateurs autant que des observateurs, que ce que nous appelons passé est peut-être, au fond, une manière de continuer à raconter qui nous sommes, même si ce récit, parfois, nous joue des tours.
Références
Brewin, C. R. (2016). Reconceptualizing PTSD: Beyond the DSM-5. Psychological Bulletin, 142(6), 608–611.
Loftus, E. F., & Pickrell, J. E. (1995). The formation of false memories. Psychiatric Annals, 25(12), 720–725.
Loftus, E. F. (1999). Lost in the Mall: Misrepresentations and misunderstandings. Ethics & Behavior, 9(1), 51-60.

Sara Lakehayli
Docteur en neuroscience cliniques et santé mentale, PhD
Membre associée au Laboratoire des Maladies du Système Nerveux, Neurosensorielles et du Handicap, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca.
Professeur à l'école supérieure de psychologie