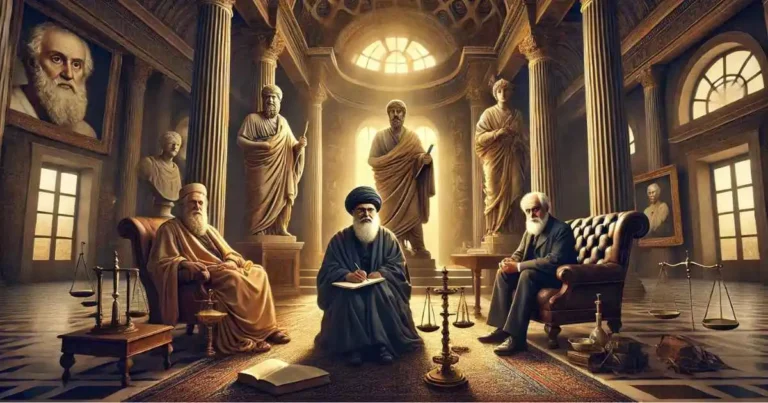Plus fort qu’un atome : Anatomie d’un préjugé
La lucidité de Péguy ou l’énigme de notre « coupable étourderie »
Le penseur Charles Péguy, dans un passage d’une grande acuité rapporté par Francine Lenne, met le doigt sur une faute aussi fondamentale que répandue de l’esprit humain :
« Parler de ce qu’il ne connaît pas (…) demeurera toujours l’occupation préférée de l’homme ».
Il observe avec une ironie qui confine au diagnostic clinique que si « l’audace de l’incompétence » semble s’incliner, presque par réflexe, devant les forteresses des savoirs formalisés que sont les hautes mathématiques ou les sciences exactes, elle se déploie en revanche avec une assurance déconcertante sur le terrain du quotidien. Là, dans les conversations familières sur la politique, les arts, la littérature ou même les robes, nous proférons des « sottises aussi énormes » que celles que nous pourrions commettre dans une démonstration mathématique.
La différence, et elle est de taille, est que dans ce dernier cas, l’erreur nous saute aux yeux, elle nous heurte ; dans le premier, « aucune douleur ne nous réveille ». Nous sommes protégés, anesthésiés par ce que Péguy nomme la « carapace » de la « suffisance », un blindage psychique qui nous maintient à bonne distance des « heurts que nous aurions à recevoir de la réalité ».
Les passages ci-dessus sont extraits du livre Le chevêtre, une lecture de Charles Péguy, de Francine Lenne, Presses Universitaires du Septentrion. Un article qui les développe est ici :
À partir de réflexions de Charles Péguy
Cette interrogation poignante sur notre aveuglement structurel, sur cette méconnaissance confortable, servira de fil conducteur à notre analyse pour sonder nos certitudes les mieux établies.
1. Le paradoxe des savants : quand l’intelligence cognitive bute sur le préjugé
L’énigme présentée par Péguy trouve un écho puissant et paradoxal dans une formule célèbre attribuée à Albert Einstein :
« Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé ».
Cette phrase, devenue aphorisme, met en scène une opposition fondamentale : d’un côté, la puissance « démiurgique » de l’intellect scientifique, capable de sonder et de fracturer le cœur de la matière ; de l’autre, son apparente impuissance face à la citadelle d’une croyance irrationnelle.
Or, et c’est là que le paradoxe se corse, les plus grands artisans de cette puissance cognitive, les « maîtres de la rationalité physique », ne sont nullement immunisés contre cette seconde force. Leurs propres angles morts, leurs propres préjugés, en sont la plus ironique des démonstrations. Car Planck, le grand Planck, et Einstein, l’immense Einstein, ont des préjugés hors de leur domaine, et notamment en ce qui concerne le psychisme humain…
🔗 À lire aussi : Idéologie : Une métamorphose existentielle des structures mentales
1. 1. Le pessimisme de Max Planck : une vérité scientifique à l’épreuve des générations.
Considérons d’abord le fameux « principe de Planck » :
« Une nouvelle vérité scientifique ne triomphe pas en convainquant ses adversaires, mais parce que ces derniers finissent par mourir, et qu’une nouvelle génération, familiarisée avec elle, grandit et l’adopte. »
Nous avons là un Planck apparemment pessimiste, puisqu’il ne fait pas confiance au discours de la science et aux preuves empiriques ou logiques qui peuvent être apportées à une théorie naissante et controversée.
Derrière le pessimisme caustique de cette boutade, qui sonne comme un adieu narquois adressé aux collègues entêtés de sa génération, se niche le véritable préjugé de Planck.
Son erreur n’est pas son pessimisme, mais bien le diagnostic qu’il pose. Il attribue la résistance au savoir nouveau à une simple question de génération, à un conflit d’habitudes intellectuelles que seule la mort peut résoudre.
C’est là une profonde méconnaissance de la nature de l’obstacle. Ce n’est pas l’âge du capitaine qui fait la résistance du navire, mais sa structure même.
Planck raisonne comme si la nouvelle génération était complètement perméable à la nouvelle idée, et malléable au point de l’adopter simplement parce qu’elle est dans l’air.
C’est une dénégation du fait que lorsque cette génération arrive à l’âge adulte, elle n’est absolument plus perméable ni malléable comme l’est le très jeune enfant face au discours du parent adulte.
À côté de l’identification cognitive qui a apporté à cet enfant une partie de l’héritage de savoir de l’Humanité , Il s’est déposé en lui, depuis très des tôt, des couches et des couches d’une identification subjective liée au discours parental et faisant l’objet d’un refoulement, donc devenue inconsciente.
Cette identification subjective fait le lit d’un certain nombre de croyances rebelles à se laisser réfuter par le raisonnement et par l’expérience, même chez l’athée le plus convaincu qui se croirait « non croyant ».
• l’on peut trouver chez des jeunes une mentalité plus « réactionnaire », « rétrograde », conservatrice et dénégatoire des découvertes scientifiques que chez des personnes de la génération précédente,
• la perméabilité et la malléabilité, lorsqu’elle s’observent chez des personnalités hystériques, font que « une idée chasse l’autre », « on écoute le dernier qui a parlé » ou « celui qui parle le plus fort » : selon la formule clinique, « l »hystérique suit la mode », c’est une « fashion victim », et donc l’idée la plus récente que véhicule son esprit, ici et maintenant, n’est pas forcément la plus fondée scientifiquement…
L’histoire de la physique donnera d’ailleurs tort à max Planck : l’adoption de la relativité générale fut spectaculairement accélérée par les preuves empiriques des expéditions d’Eddington en 1919, démontrant que la preuve factuelle peut bel et bien convaincre, même les plus récalcitrants.
La bascule majeure dans l’acceptation publique et scientifique de la relativité générale vint des expéditions d’Eddington (1919) qui mesurèrent la déviation de la lumière au voisinage du Soleil ; la couverture médiatique qui suivit fit d’Einstein une célébrité et contribua à l’adoption large de sa théorie dans la communauté (même si les débats techniques et philosophiques se poursuivirent).
L’erreur de Planck est donc double :
• il ignore la force de la démonstration et de l’expérimentation, et, plus fondamentalement,
• il raisonne comme si la nouvelle génération était une page blanche, alors qu’elle arrive au monde déjà chargée d’une structure subjective inconsciente, bien plus tenace qu’une simple opinion.
🔗 Découvrez également : Cerveau d’Einstein : Décryptage de la boîte noire d’un génie
1.2. Le contresens d’Albert Einstein : la moelle épinière contre la subjectivité.
Einstein lui-même, ce géant qui a remodelé notre vision de l’univers, tombe dans un piège conceptuel d’une étonnante naïveté lorsqu’il s’aventure sur le terrain du psychisme et du social. Pour expliquer l’obéissance fanatique des soldats de la Wehrmacht, il écrit :
« Je méprise profondément ceux qui aiment marcher en rangs sur une musique (…) ce ne peut être que par erreur qu’ils ont reçu un cerveau; une moelle épinière leur suffirait amplement. »
En réduisant l’adhésion idéologique à un simple arc réflexe médullaire, il commet un contresens magistral. Il retombe sur une explication mécaniste et simpliste, digne d’un biologisme du XIXe siècle.
Il se trompe lorsqu’il attribue ces comportements – d’obéissance aveugle des militaires au Führer allemand – non pas à l’identification subjective, ni même à un conditionnement pavlovien, ce qui suppose que ces humains ont quand même un cerveau…
Non ! Il va même jusqu’à leur dénier l’obéissance à un instinct (mécanisme fort complexe), puisqu’il attribue leur comportement à un simple réflexe mettant en jeu la seule moelle épinière !
Citons ce passage de mon article dans le numéro de la revue Topique dédié au thème « Psychanalyse et propagande » :
Fantasme, Discours, Idéologie – D’une transmission qui ne serait pas propagande
« Passons rapidement sur l’instinct (on accuse parfois la propagande politique de « réveiller nos bas instincts »), volontiers confondu par le profane avec le réflexe (exemple : « réflexe d’autodéfense »). Celui-ci, bien plus élémentaire l’arc réflexe médullaire ne met en jeu qu’un neurone récepteur et un neurone effecteur est incapable de tendre à lui seul vers un but adapté. L’instinct, lui, est une impulsion innée, héréditaire et spécifique. Il est réputé « parfait, hautement complexe, et adapté », alors que le réflexe est extrêmement simple et pas spécialement adapté. »
Si Einstein ne dispose pas du concept adéquat pour penser ce phénomène, c’est
• d’une part parce que, bien que contemporain de Freud, il semble n’avoir jamais pris la mesure théorique de la découverte de l’inconscient ;
• d’autre part, parce qu’il n’a jamais entrepris ce voyage pratique qu’est une analyse, qui l’aurait confronté à la méconnaissance de sa propre identification subjective.
Son erreur est d’ignorer que l’adhésion au nazisme ne fut pas une affaire de réflexe, mais une construction psychique complexe qui a mobilisé le cerveau d’éminents philosophes comme Heidegger, de prix Nobel de physique comme Heisenberg***, et la plume de grands écrivains comme Céline, Brasillach ou Drieu La Rochelle. C’est une affaire de langage, de désir et de croyance, bref, de subjectivité, et non de moelle épinière.
🔗 À lire aussi : Psychanalyse et Neurosciences : Vers une alliance raisonnée
*** « Au service de la propagande nazie »
[Lors des premières années du régime] « Heisenberg prétend rester un simple citoyen obéissant aux lois du Reich et sans engagement politique.
Cependant, entre 1941 et 1944, Heisenberg participe à plusieurs voyages de propagande nazie en Hongrie, au Danemark, aux Pays-Bas et en Pologne, dans le rôle d’éminence culturelle, accompagné par des officiels du parti nazi et célébré par les autorités militaires d’occupation, pour gagner les élites locales à la collaboration[20].
Et lors de ses entretiens avec Niels Bohr à Copenhague en septembre 1941, il lui dit sa « ferme conviction que l’Allemagne gagnera la guerre et que nous étions fous d’espérer (sa défaite) et de refuser la collaboration », et lui donne la nette impression que « sous (sa) direction, tout était fait en Allemagne pour fabriquer l’arme nucléaire ».
Cette réunion jette un froid entre Heisenberg et Bohr, lequel est exfiltré peu de jours après vers la Suède puis l’Angleterre et de là aux États-Unis à Los Alamos.
En 1943, Heisenberg se rend aux Pays-Bas où il confie qu’une victoire de l’Allemagne serait un moindre mal[23]. En Pologne occupée, dirigée par Hans Frank, un ami d’enfance, il prononce un discours réservé aux Allemands. »
2. Le fondement théorique : Identification Cognitive et Identification Subjective, les sœurs ennemies
Pour sortir de ces impasses conceptuelles et comprendre enfin la nature de l’erreur du savant comme l’invraisemblable solidité du préjugé, il nous faut un appareil théorique d’une grande précision.
Ce n’est pas du côté des psychologies de la conscience ou du comportementalisme que nous le trouverons, mais bien dans l’édifice de la psychanalyse, particulièrement dans la lecture structurale qu’en a faite Jacques Lacan.
C’est là que se trouve, reprise et développée par l’auteur de ces lignes, la distinction capitale, véritable clé de voûte de l’édifice psychique, entre deux modalités hétérogènes de l’identification humaine qui sont sœurs, puisque toutes deux filles du langage. Mais on va voir que ce sont deux sœurs ennemies…
2.1. L’Identification Cognitive : le savoir conscient et révisable.
La première, que nous nommerons l’identification cognitive, constitue la face « CONNAISSANCE » de notre rapport au monde.
• C’est par elle que nous recevons, comme un héritage précieux, le savoir qu’a accumulé au fil des générations l’humanité qui nous a précédés. C’est le savoir que l’on acquiert sur les bancs de l’école, dans les livres, au fil des démonstrations mathématiques et des protocoles expérimentaux. Elle nous fournit des contenus mémoriels (des dates, des formules, des concepts) et des outils logiques (la déduction, la démonstration, le calcul) qui nous dispensent de devoir, à chaque génération, réinventer la roue ou redécouvrir les lois de la gravité.
• Ce versant cognitif tend vers l’objectivité. Il cherche à décrire le réel de la manière la moins équivoque possible. Il formalise le monde, passant du langage commun (parlé ou écrit) à l’équation mathématique ou à la formule de logique : ce mot vient d’ailleurs de « logos » (langage, discours)
• Ce savoir, qu’il soit conscient ou immédiatement accessible à la conscience (préconscient), est par nature un édifice en perpétuelle construction, ouvert, dynamique et révisable (on peut le remettre en question). Il se soumet, du moins en théorie, à l’épreuve des faits et à la réfutation par l’argumentation. Si une expérience nouvelle contredit une théorie établie, ou si un raisonnement plus puissant en expose les failles, cette théorie pourra être questionnée, remaniée, voire abandonnée au profit d’une meilleure.
• C’est le champ de la science, de la raison critique, de la pensée qui se sait et s’accepte comme questionnable et potentiellement faillible.
• C’est aussi le versant de notre intelligence qui depuis le premier tiers du 20ème siècle nous a permis d’arriver, littéralement, à « désintégrer un atome« … de façon guerrière (bombe nucléaire) ou pacifique (centrales nucléaires).
🔗 Découvrez également : Psychologie des foules : Une analyse visionnaire du comportement collectif
2.2. L’Identification Subjective : la méconnaissance inconsciente et structurante.
Mais à côté de cette voie royale du savoir objectif, recueilli par des interactions actuelles avec le monde qui nous entoure, opère une autre logique, plus souterraine, beaucoup plus ancienne (en fait « anachronique »), et d’une puissance sans commune mesure. Pour la saisir, il faut revenir à l’aube de la vie de tout être parlant.
• L’enfant n’apprend pas à parler avec un dictionnaire et une grammaire ; il est plongé, immergé dans ce que Lacan nomme le « bain de langage » de ses parents (ou des adultes qui l’élèvent), un discours où s’entremêlent inextricablement les connaissances et le désir.
• Pensez au nourrisson : sa survie même dépend de cet autre (l’humain adulte, généralement ses parents) qui le nourrit, le soigne et le nomme. Il ne reçoit pas des mots neutres, mais des mots chargés du désir, des angoisses, des espoirs et des préjugés de cet autre. Le ton de la voix, les silences, l’insistance sur certains termes forgent sa première relation au monde.
• De cette dépendance vitale et de cette immersion linguistique naît l’identification subjective. Comme le formule Lacan de façon saisissante, « Le « dit premier » décrète, légifère, aphorise, est oracle », un peu comme la parole supposée infaillible des souverains pontifes (!). Le discours parental n’est pas une source d’informations à vérifier, il est une autorité, une « vérité » qui constitue.
• Cette parole fondatrice, parce qu’elle est reçue à un stade où la critique est impossible, parce qu’elle est intimement scellée aux affects les plus fondamentaux (l’amour pour le parent, la peur de le perdre), et enfin parce qu’elle est devenue inconsciente, constitue la face « MÉCONNAISSANCE » de l’identification.
• Ce savoir subjectif, à l’inverse du premier, est rebelle à l’expérience et à la critique, il est non questionnable et non révisable. C’est une connaissance qui s’ignore comme telle, une croyance vécue comme une évidence absolue. Elle est la charpente invisible de notre psychisme, le support de notre sentiment d’identité (« je suis ceci », « je ne suis pas cela »), la source de nos désirs les plus secrets et de nos fantasmes les plus indéracinables. C’est le terreau de toute croyance dogmatique, de nos allégeances socio-politiques indéfectibles, de nos goûts et de nos dégoûts les plus profondément ancrés,… de nos préjugés dont il constitue la matière même. Sauf techniques spéciales, comme celle de la psychanalyse, ce savoir est pratiquement impossible à « désintégrer »…
Ces deux identifications sont des « sœurs ennemies » : la seconde vient constamment « mettre des bâtons dans les roues » à la première, ce qui explique la résistance féroce opposée par les préjugés subjectifs à des figures du savoir comme Galilée en astronomie, Darwin en biologie, ou Freud avec la découverte de l’inconscient.
De la méconnaissance à la reconnaissance
La boucle de notre raisonnement est désormais bouclée.
La « coupable étourderie » que Péguy dénonçait avec tant de finesse, la résistance à la désintégration du « préjugé », résistance qu’Einstein jugeait bien supérieure à celle de l’atome, et les surprenants angles morts conceptuels de Planck et Einstein eux-mêmes, tout cela s’éclaire à la lumière de cette distinction fondamentale entre cognition et subjectivité.
Le préjugé n’est pas une simple scorie de la pensée, une erreur que davantage de rationalité suffirait à balayer. Il est l’affleurement d’une structure inconsciente qui nous constitue au plus profond.
Notre travail de clarification, issu d’un premier jet et affiné par le questionnement, nous mène à une triple conclusion.
Premièrement, c’est un appel à la lucidité sur nos propres préjugés.
Nul, pas même le plus grand des génies scientifiques, n’échappe aux effets de son identification subjective. Reconnaître cela n’est pas un aveu de faiblesse, mais le premier pas, un pas décisif, vers une pensée véritablement critique, qui commence par se critiquer elle-même dans un travail d’auto-analyse permanent.
Deuxièmement, c’est une démonstration convaincante de la puissance explicative de la psychanalyse, freudienne puis lacanienne.
Là où d’autres approches se contentent de descriptions superficielles ou tombent dans des impasses mécanistes, elle offre une grille de lecture structurée et puissante pour penser les énigmes du comportement humain, de l’adhésion idéologique la plus aveugle à la résistance au savoir le plus établi.
Enfin, et c’est peut-être là le point essentiel…
… cette analyse nous invite à une méditation sur la nature même de l’intelligence.
Celle-ci ne réside pas seulement dans la puissance cognitive capable de transformer le monde matériel, mais dans la capacité, bien plus ardue et bien plus rare, à interroger notre propre subjectivité, à débusquer les logiques de notre désir, à critiquer nos évidences les plus chères. C’est ainsi, et seulement ainsi, que l’on progresse réellement.
À l’heure où l’on s’ingénie à construire des intelligences artificielles, ce qui est un objectif par ailleurs tout à fait estimable, il serait sage… de se rappeler que la plus grande intelligence est peut-être celle qui sait qu’elle ne sait pas tout, surtout sur elle-même. Il serait sage… de se souvenir de cette dualité entre le versant conscient de l’identification, que permet le langage, et son versant inconscient via la connexion des mots aux affects ressentis dans le corps. Le véritable enjeu n’est pas de créer des calculateurs surpuissants, mais de modéliser cette articulation conflictuelle entre le cognitif et le subjectif.
Le mouvement de l’I.A. est déjà lancé et semble s’accélérer, donc il est trop tard pour déclarer : « Avant de vouloir créer une autre intelligence, il serait bon de commencer par comprendre la nôtre, dans toute sa merveilleuse et déroutante complexité ». Mais rien n’empêche de surfer sur cette vague en utilisant la puissance et les talents des « IAG » (Intelligences Artificielles Génératives) pour modéliser et simuler certains aspects de l’identification subjective, non pas pour créer une conscience, mais pour forger un outil heuristique capable de nous éclairer sur notre propre fonctionnement fantasmatique. C’est précisément là l’ambition de notre projet d’ébauche d’une Subjectivité Artificielle.
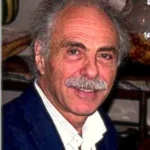
Jean-Jacques Pinto
Médecin-psychiatre, psychanalyste et psychothérapeute
Plusieurs décennies de pratique 1° de la psychanalyse classique et de la psychothérapie d'inspiration psychanalytique, et 2° de l'enseignement en psychiatrie, psychanalyse, psychologie, argumentation, rhétorique.
Séminaires, conférences, rédaction d'ouvrages et d'articles sur des thèmes en rapport avec la psychanalyse, la psychothérapie des psychoses, l'Analyse des Logiques Subjectives (A.L.S.) et la Subjectivité Artificielle.