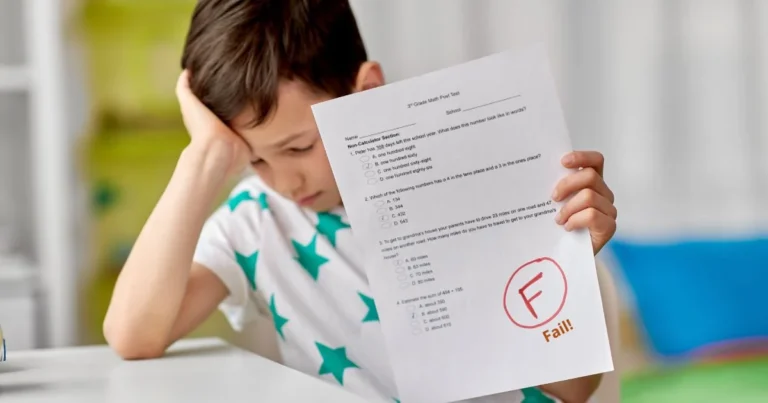L’enfant naît-il altruiste ?
Né du besoin de vivre ensemble, le cerveau humain pense, ressent et agit toujours en relation. Modelé par la vie sociale, il décrypte les intentions, partage les émotions et ajuste en permanence ses comportements à ceux des autres. Ce vaste réseau d’interactions, que les chercheurs désignent sous le nom de cerveau social, forme la base biologique de l’empathie, de la coopération et de l’entraide. Mais si notre cerveau est ainsi câblé pour la relation, cela interroge une idée longtemps admise : celle d’une bonté acquise, fruit de la culture et de la morale.
Pendant des siècles, la psychologie et la philosophie ont en effet considéré la bienveillance comme une conquête de la raison sur les instincts. On imaginait l’enfant naturellement égocentrique, centré sur ses besoins, et l’apprentissage moral comme un processus destiné à lui inculquer la générosité, la compassion et le sens du bien. Or, les découvertes récentes en psychologie du développement et en neurosciences sociales renversent cette perspective.
Les travaux menés ces vingt dernières années montrent qu’avant même de parler, de comprendre les règles ou d’intérioriser les normes, le très jeune enfant manifeste déjà une forme d’empathie active et d’entraide spontanée. Il s’approche pour aider un adulte à fermer une porte, tend un objet tombé, console un pair en pleurs. Ces comportements, que les chercheurs appellent prosociaux, apparaissent spontanément, sans consigne, sans récompense, sans pression sociale.
Ces gestes minuscules, observés dans toutes les cultures, racontent la même histoire : celle d’un cerveau social qui semble réagir naturellement à la détresse d’autrui. Comme si, avant d’être moraux, nous étions biologiquement connectés les uns aux autres. Cette intuition, longtemps cantonnée à la philosophie ou à la poésie, a fini par intriguer les scientifiques. Mais comment démontrer qu’une telle prédisposition existe réellement, qu’elle ne dépend ni de la culture ni de l’éducation ?
Pour le savoir, il fallait observer la bonté à son état le plus pur : dans les premiers mois de la vie, avant le langage, avant les règles, avant toute notion du bien et du mal. Et c’est précisément ce qu’ont tenté de faire plusieurs équipes de chercheurs, à travers une série d’expériences devenues emblématiques, des scènes d’une simplicité désarmante, où la main d’un enfant raconte mieux que les mots ce que signifie “être humain”.
Le cerveau câblé pour la bonté
Il existe des images qui, à elles seules, bouleversent notre idée de l’humain. Celle d’un bébé tendant une banane à un adulte en est une. Un geste pur qui, à première vue, ne semble rien dire et qui pourtant dit tout. C’est dans un laboratoire de Seattle, à l’Université de Washington, que cette scène a été observée. Le psychologue Rodolfo Cortés Barragan et son collègue Andrew Meltzoff y ont mené une série d’expériences simples, presque naïves dans leur apparente banalité. Leur question était directe : un enfant, avant même de parler, est-il capable d’un acte réellement altruiste ?
L’expérience ressemblait à un jeu d’enfant, et c’est justement ce qui la rendait fascinante. Un adulte assis face à l’enfant tenait un fruit, une fraise, une banane ou un raisin, puis le laissait tomber par inadvertance de son côté de la table. L’adulte tendait la main, mimant l’effort pour le récupérer, mais sans y parvenir. De l’autre côté, le bébé observait. Dans près de six cas sur dix, il s’approchait, ramassait le fruit, et le lui rendait. Une seconde expérience allait rendre le constat encore plus frappant. Cette fois, les chercheurs avaient demandé aux parents de venir juste avant l’heure du repas, lorsque les enfants avaient faim. Et pourtant, une partie d’entre eux a encore choisi de donner plutôt que de manger. Leur geste allait à l’encontre d’un besoin fondamental, ils cédaient un aliment dont ils avaient envie, simplement parce que quelqu’un d’autre semblait en avoir besoin.
🔗 À lire aussi : La fenêtre manquée : L’histoire de Victor, l’enfant sauvage
Barragan et Meltzoff parlent ici d’altruisme spontané, un comportement coûteux, accompli sans récompense ni attente de retour. Chez les chimpanzés, soumis aux mêmes conditions, rien de tel ne se produit : ils aident volontiers à ramasser un objet, mais jamais une nourriture désirable. Ce contraste entre le singe et l’enfant interroge ce que nous avons de plus profondément humain. Donner ce qu’on désire, c’est accepter une perte immédiate pour le bénéfice d’un autre. Et à dix-neuf mois à peine, certains bébés en sont déjà capables, comme si leur cerveau savait, avant eux, que la survie de l’espèce repose sur la main tendue.
L’instinct d’aider : ce que dit le cerveau
Ce que ces expériences donnent à voir de façon émouvante, les neurosciences le confirment aujourd’hui : aider n’est pas seulement un choix, c’est une impulsion biologique. Le geste du bébé tendant la banane n’est pas le fruit du hasard ni d’un apprentissage prématuré. Il s’enracine dans un réseau cérébral complexe que les chercheurs appellent désormais le cerveau social, un ensemble de régions qui nous permettent de percevoir, comprendre et partager les émotions d’autrui.
Lorsque nous voyons quelqu’un en difficulté, certaines zones du cerveau s’activent avant même que nous ayons le temps d’y réfléchir. L’insula, au cœur du cortex, réagit à la perception de la détresse comme si elle la faisait sienne. Le système des neurones miroirs, découvert à Parme dans les années 1990, entre alors en action : il nous permet de “ressentir avec” l’autre, de reproduire mentalement son effort ou sa douleur. C’est ce même mécanisme qui nous pousse à sursauter en voyant quelqu’un se brûler ou à tendre le bras quand une personne trébuche.
Les neurones miroirs : Découverts dans les années 1990 par Giacomo Rizzolatti et son équipe à Parme, les neurones miroirs ont profondément transformé la compréhension du cerveau social. Ces cellules nerveuses s’activent non seulement lorsque nous réalisons une action, mais aussi lorsque nous observons quelqu’un d’autre l’accomplir — comme si voir, c’était déjà faire. Chez l’enfant, ce système joue un rôle crucial dans l’apprentissage par imitation : marcher, parler, sourire, comprendre les intentions d’autrui. Il intervient aussi dans les bases de l’empathie : percevoir la douleur, la joie ou la réussite de l’autre mobilise les mêmes circuits cérébraux que si nous les vivions nous-mêmes. Ce mécanisme miroir crée ainsi une résonance émotionnelle automatique, un langage neuronal universel qui nous permet de ressentir avec, avant même de comprendre.
Plus haut dans la hiérarchie cérébrale, le cortex préfrontal ventromédian et le cingulaire antérieur coordonnent la réponse : ils évaluent la situation, régulent l’émotion et traduisent cette empathie brute en comportement concret. Ensemble, ces circuits forment un véritable câblage de la compassion, un ensemble de voies neuronales qui transforment la perception de la souffrance en motivation d’agir.
Ce que la morale appelle bonté, le cerveau traduit en un enchaînement d’activations millimétrées. Mais cette mécanique reste indissociable du corps : à chaque acte d’aide, le système nerveux libère de l’ocytocine, l’hormone de l’attachement et de la confiance. Cette molécule, sécrétée aussi lors du contact ou du lien affectif, renforce le sentiment de proximité et de sécurité mutuelle. Faire le bien, littéralement, fait du bien : les circuits de la récompense, stimulés par la dopamine, s’activent comme lorsqu’on réussit un défi ou qu’on reçoit une caresse.
🔗 Découvrez également : Une histoire par jour, et le cerveau s’éveille
Les anthropologues rappellent que les premiers groupes humains ne pouvaient survivre que grâce à la coopération : partager la nourriture, protéger les plus faibles, veiller les malades. Ceux qui aidaient augmentaient leurs chances de survie collective, et donc la transmission de leurs gènes. Aujourd’hui encore, ce câblage ancien demeure actif. Quand nous tendons la main à quelqu’un, nous rejouons sans le savoir un scénario vieux de centaines de milliers d’années : celui d’un être social programmé pour le lien. Et si le monde change, ce réflexe, lui, reste le même. Il suffit parfois d’un regard, d’un geste, pour qu’il s’active à nouveau, comme une mémoire ancienne que le cerveau n’a jamais cessé de porter.
L’ocytocine : Souvent surnommée hormone de l’attachement, l’ocytocine est un messager chimique produit par l’hypothalamus et libéré à la fois dans le cerveau et dans le sang. Elle influence nos émotions, renforce la confiance et favorise la coopération. Présente lors de l’allaitement, de l’accouchement ou du simple contact physique, elle consolide les liens sociaux, soutient les comportements altruistes et affine notre capacité à lire les émotions dans le regard d’autrui. En créant une sensation de proximité et d’appartenance — à un groupe, à une relation ou à une cause —, elle agit comme un ciment biologique du lien humain. Dans le cerveau du bébé comme dans celui de l’adulte, c’est elle qui transforme l’interaction en attachement et le contact en confiance.
Quand la culture sculpte la bonté
Si le cerveau humain semble prédisposé à la bienveillance, encore faut-il qu’elle puisse s’exprimer. Comme un instrument dont la mélodie dépend de la manière dont on en joue, le câblage neuronal de la bonté a besoin d’un contexte social pour se déployer. Les chercheurs en psychologie du développement insistent sur ce point. Les gestes d’aide et de coopération apparaissent spontanément chez l’enfant, mais leur fréquence et leur intensité dépendent très tôt de l’environnement affectif dans lequel il grandit. Un climat de confiance, des parents attentifs aux émotions de l’autre, des modèles de solidarité au quotidien, tout cela agit comme un catalyseur.
Les études menées par la psychologue Sylvie Chokron et son équipe montrent que les enfants élevés dans un milieu chaleureux et empathique repèrent plus vite la détresse d’autrui et y répondent plus spontanément. D’autres travaux, notamment ceux de Lucie Rose et Klara Kovarski, ont confirmé que les enfants dont les parents valorisent la coopération et la compassion développent plus tôt des comportements d’entraide. Autrement dit, l’éducation n’enseigne pas l’altruisme, elle en entretient la flamme. Ainsi, la bonté se nourrit d’expérience. Elle n’est pas un élan naïf, mais une compétence relationnelle que la société peut cultiver ou étouffer.
🔗 À lire aussi : L’humeur contagieuse : Quand nos cerveaux se miroitent
Chaque fois qu’un enfant voit un adulte tendre la main, partager, écouter, son cerveau enregistre une leçon silencieuse, celle que la coopération n’est pas une faiblesse, mais une forme d’intelligence vitale. Et chaque acte d’aide, aussi infime soit-il, ravive cette mémoire ancienne qui sommeille en nous, la mémoire d’un monde où survivre signifiait s’entraider.
Le cerveau est câblé pour la bonté, certes, mais il appartient à chaque génération d’en entretenir le courant, de ne pas laisser se rompre le fil fragile qui relie le geste instinctif au choix conscient de l’humanité.
Références
Barragan RC, Brooks R, Meltzoff AN. Altruistic food sharing behavior by human infants after a hunger manipulation. Sci Rep. 2020 Feb 4;10(1):1785.
Benenson, J., Pascoe, J., & Radmore, N. (2007). Children’s altruistic behavior in the dictator game. Evolution and Human Behavior, 28, 168-175.
Rose, L., Kovarski, K., Caetta, F., Makowski, D., & Chokron, S. (2024). Beyond empathy: Cognitive capabilities increase or curb altruism in middle childhood. Journal of experimental child psychology, 239, 105810.
Zhou, X. (2024). The Formation Mechanism of Altruistic Behavior. Journal of Education, Humanities and Social Sciences.

Sara Lakehayli
Docteur en neuroscience cliniques et santé mentale, PhD
Membre associée au Laboratoire des Maladies du Système Nerveux, Neurosensorielles et du Handicap, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca.
Professeur à l'école supérieure de psychologie