Dyspraxie : Quand le corps aide le cerveau à retrouver son chemin
Imaginez un enfant de sept ans, assis à son bureau d’école. Ses camarades remplissent déjà deux lignes d’écriture cursive, alors qu’il bataille encore avec la première lettre de son prénom. Le stylo tremble entre ses doigts, la feuille se froisse, et une goutte de sueur perle sur son front. Ce qui pour les autres est un automatisme devient pour lui un combat. Cet enfant n’est pas paresseux, ni distrait, ni « maladroit » au sens commun du terme : il est dyspraxique. Ce trouble du développement de la coordination touche entre 5 et 7 % des enfants d’âge scolaire (Blank et al., 2019), ce qui signifie qu’en moyenne, dans une classe de 30 élèves, deux enfants sont concernés. Pourtant, la dyspraxie reste un trouble invisible, trop souvent mal compris ou confondu avec un déficit d’attention ou une simple négligence.
Or, derrière ces gestes hésitants se cache une réalité neurologique complexe. La bonne nouvelle, c’est que le cerveau n’est pas figé. Grâce à la plasticité cérébrale, il peut apprendre à compenser, à recréer, à inventer de nouvelles stratégies. Et c’est précisément là que la psychomotricité déploie toute sa puissance : en transformant le corps en terrain d’expérimentation, elle aide ces enfants à bâtir de nouveaux chemins neuronaux.
La dyspraxie, un trouble du geste et de la planification motrice
La dyspraxie, plus connue aujourd’hui sous le terme de trouble développemental de la coordination (TDC), est bien plus qu’un simple « manque d’adresse ». Elle ne résulte ni d’un déficit intellectuel, ni d’un manque d’effort ou de motivation de l’enfant, encore moins d’une éducation laxiste ou d’un défaut d’attention. Elle est désormais reconnue comme une altération neurologique affectant la programmation, la planification et l’automatisation des gestes volontaires.
Chaque action motrice que nous réalisons quotidiennement – tenir un stylo, attacher ses lacets, attraper un ballon en mouvement – repose sur un enchaînement extraordinairement complexe d’opérations cérébrales. Derrière l’apparente simplicité d’un geste se cache en réalité un orchestre neurologique où chaque structure cérébrale joue sa partition. Le cortex pariétalconstruit la représentation spatiale et visuelle de l’action à réaliser ; le cortex prémoteur et les aires motrices élaborent et organisent la séquence ; le cervelet affine la précision, règle la fluidité et corrige en temps réel les erreurs ; le corps calleux assure la communication harmonieuse entre les deux hémisphères. Ces régions ne travaillent pas de façon isolée : elles forment des réseaux dynamiques, reliant perception, cognition et motricité.
Chez l’enfant dyspraxique, ce réseau perd sa synchronisation. Les informations circulent, mais de manière brouillée, lente, parfois incomplète. L’orchestre n’est plus parfaitement accordé : certains instruments commencent trop tard, d’autres s’arrêtent trop tôt, le rythme est hésitant. Les gestes apparaissent alors saccadés, imprécis, coûteux en énergie. Ce n’est pas que l’enfant ne « sait pas » faire : c’est qu’il ne parvient pas à automatiser ce qu’il a compris et appris.
Les recherches en neuroimagerie viennent confirmer cette réalité. Les travaux de Wilson et ses collaborateurs,mais aussi d’autres études plus récentes utilisant l’IRM fonctionnelle, mettent en évidence des anomalies de connectivité dans les circuits pariéto-frontaux et une moindre efficacité dans la communication entre le cervelet et le cortex moteur. Cette moindre intégration explique la difficulté à anticiper et à ajuster les gestes en fonction du contexte. On sait aussi que les noyaux gris centraux, impliqués dans la sélection et l’automatisation des programmes moteurs, présentent une activité atypique, ce qui pourrait expliquer l’effort permanent que nécessite chaque action.
🔗 À lire aussi : Grandir par le mouvement : La psychomotricité comme socle éducatif
Dans la vie quotidienne, ces désynchronisations neurologiques se traduisent par une multitude de difficultés concrètes. L’enfant dyspraxique peine à s’habiller : mettre un pull, fermer une fermeture éclair, boutonner une chemise deviennent de véritables épreuves. Les gestes sont lents, maladroits, parfois découragés par l’échec répété. À l’école, écrire une phrase entière peut demander un effort disproportionné : la main tremble, les lettres ne respectent pas l’alignement, la vitesse est très en deçà de celle des camarades. En éducation physique, attraper un ballon ou enchaîner une série de sauts devient une tâche anxiogène, car les mouvements paraissent désordonnés et maladroits.
Ces obstacles répétés ont des conséquences psychologiques considérables. La frustration s’installe, l’enfant se sent « moins bon » que les autres, il redoute les moqueries et peut développer un sentiment d’infériorité. Plusieurs études en psychologie du développement soulignent le risque accru de troubles anxieux et de baisse de l’estime de soi chez les enfants avec TDC. Lorsque chaque geste du quotidien devient une lutte, l’enfant intériorise une image négative de lui-même : il se perçoit comme « maladroit », « incapable », et cette croyance peut persister à l’âge adulte.
Pour illustrer cela, prenons l’exemple de Sami, 8 ans, suivi en psychomotricité. Le matin, il met plus de vingt minutes à s’habiller, ce qui génère une tension familiale permanente. À l’école, il évite les jeux de ballon car il a peur de rater devant ses camarades. Lors des séances, il exprime souvent sa fatigue : « J’ai l’impression de courir un marathon juste pour écrire une page ». Ce témoignage reflète une réalité partagée par beaucoup d’enfants dyspraxiques : leur quotidien est marqué par une dépense énergétique et émotionnelle immense pour accomplir des gestes que les autres enfants réalisent spontanément et sans effort.
La dyspraxie ne se réduit donc pas à une « maladresse ». C’est un trouble neurodéveloppemental complexe qui touche à la fois les circuits de la planification motrice, l’intégration sensorielle et les dimensions affectives et sociales de l’enfant. Elle illustre de manière frappante combien le geste humain n’est jamais uniquement mécanique, mais profondément enraciné dans un dialogue entre le cerveau, le corps et l’environnement.
La plasticité cérébrale, un chantier permanent
Longtemps, on a cru que le cerveau était une machine terminée une fois l’enfance passée. Jusqu’aux années 1970, l’idée dominante dans les neurosciences était qu’après une période dite « critique » – l’enfance et l’adolescence –, les circuits neuronaux se figeaient pour de bon, comme du ciment solidifié. Les lésions cérébrales, pensions-nous, étaient irréversibles, et l’adulte n’avait plus la possibilité de remodeler son cerveau. Cette vision pessimiste a été radicalement bouleversée grâce aux travaux pionniers de Michael Merzenich et de son équipe, qui ont démontré, d’abord chez l’animal puis chez l’humain, que le cerveau restait capable de se transformer tout au long de la vie. Aujourd’hui, on sait avec certitude que le cerveau est un organe plastique, malléable, toujours en chantier.
Chez l’enfant, la plasticité cérébrale est particulièrement foisonnante. Durant les premières années de vie, le cerveau produit des millions de nouvelles synapses chaque seconde, souvent comparé à une forêt tropicale luxuriante. Chaque expérience, chaque geste répété ou chaque découverte grave littéralement une trace dans cette forêt neuronale. L’enfant qui grimpe, qui court, qui manipule des objets, ne fait pas que jouer : il sculpte son cerveau, il façonne des chemins nerveux qui serviront de fondations à ses apprentissages futurs.
🔗 Découvrez également : Psychomotricité : L’histoire d’un corps en quête de sens
La psychomotricité s’appuie directement sur ce principe. Elle mise sur la répétition variée des expériences motrices, non pas comme une contrainte, mais comme une source de plaisir et de motivation. Chaque exercice proposé – qu’il s’agisse de lancer un ballon, de tracer une forme ou de suivre un parcours – est une occasion de renforcer un circuit, d’en créer un nouveau, ou de réorganiser les connexions existantes. L’enfant dyspraxique, en multipliant les essais et les réussites dans un cadre bienveillant, rééduque son cerveau sans même s’en rendre compte. Prenons l’exemple de Lina, 7 ans, qui avait de grandes difficultés à écrire son prénom. Après plusieurs mois d’exercices psychomoteurs ludiques — jeux de motricité fine, dessins dans le sable, gestes graphiques sur tableau mural —, elle a nettement amélioré sa coordination et la fluidité de ses mouvements. Ce progrès ne résulte pas seulement d’un apprentissage conscient : il traduit une véritable réorganisation des circuits cérébraux impliqués dans la coordination visuomotrice, comme l’ont montré de nombreuses études sur la plasticité cérébrale.
La plasticité n’est donc pas un concept abstrait réservé aux laboratoires. C’est un processus tangible, quotidien, qui se manifeste dans chaque petit progrès de l’enfant. Elle nous rappelle que le cerveau est un organe vivant, dynamique, ouvert à l’expérience. Et dans le cas de la dyspraxie, elle constitue une formidable ressource : même si certains circuits sont déficients, le cerveau possède la capacité de réinventer des solutions, d’explorer d’autres voies, de bâtir des compensations durables.
La psychomotricité, une pédagogie du corps et de l’émotion
La psychomotricité repose sur une conviction essentielle : le corps est à la fois moteur, cognitif et émotionnel. Travailler le geste ne consiste pas seulement à perfectionner une technique, mais à réconcilier l’enfant avec son corps, à restaurer une continuité entre ce qu’il ressent, ce qu’il imagine et ce qu’il accomplit.
Là où l’école demande des résultats rapides — écrire une ligne, découper sans dépasser, attraper une balle — la psychomotricité offre un espace différent : un lieu d’expérimentation et d’humanité, où l’enfant a le droit d’essayer, d’échouer, puis de recommencer. Le tapis, les ballons, les cordes ou le sable ne sont pas de simples accessoires : ils deviennent des médiateurs, des alliés. Chaque activité permet à l’enfant de se confronter à ses difficultés, mais aussi de découvrir de nouvelles manières d’agir. Le travail corporel n’est donc pas une répétition mécanique, mais une mise en mouvement de tout l’être — où le moteur, le cognitif et l’émotionnel s’entrelacent.
Un des principes fondateurs de cette approche est la progressivité. L’enfant dyspraxique ne peut pas, du jour au lendemain, maîtriser un geste complexe comme écrire lisiblement ou lacer ses chaussures. Le psychomotricien procède par étapes, dans une véritable pédagogie du détour : des gestes amples et globaux — tracer des cercles dans l’air, marcher sur une ligne, faire rouler une balle — vers la précision des doigts et la coordination oculo-manuelle. Ce chemin prépare le cerveau à construire les bases nécessaires. Il active d’abord les réseaux sensorimoteurs généraux avant de renforcer les circuits spécialisés.
La dimension émotionnelle est tout aussi déterminante. Les travaux en psychologie affective (notamment ceux d’Antonio Damasio et d’Immordino-Yang, 2007) ont montré que l’apprentissage ne peut être dissocié des émotions. Un enfant stressé active surtout son système limbique, qui inhibe attention et mémoire. À l’inverse, la confiance et le plaisir stimulent les circuits dopaminergiques, favorisant motivation et consolidation des apprentissages. La psychomotricité s’appuie précisément sur ce levier : elle fait du jeu et du plaisir des moteurs d’apprentissage, non de simples récompenses.
Chaque séance devient ainsi un laboratoire vivant, où l’enfant explore ses limites à son rythme. Le psychomotricien valorise chaque réussite, même minime, comme un pas vers l’autonomie. Un geste imparfait mais réalisé sans aide devient une victoire personnelle — et neurologique.
Karim, 8 ans, en est un bel exemple. Dyspraxique, il refusait les cours de sport, toujours choisi en dernier. En séance, il a commencé par lancer un ballon sur une cible immobile, puis sur une cible mouvante. À chaque étape, un retour positif renforçait sa confiance. Quelques semaines plus tard, il n’avait pas seulement amélioré sa coordination œil-main : il avait retrouvé le plaisir de jouer avec les autres, et osé reprendre sa place dans les jeux collectifs.
Ainsi, la psychomotricité agit comme une réconciliation entre l’enfant et son corps. Là où la dyspraxie installe souvent un sentiment d’échec, elle restaure une image positive : « mon corps peut réussir », « je suis capable d’agir », « je peux apprendre autrement ». Ces phrases intérieures, invisibles mais puissantes, sont le terreau sur lequel la plasticité cérébrale peut s’épanouir.
🔗 En lien avec ce sujet : Le pouvoir thérapeutique du mouvement
Bouger pour apprendre, apprendre en bougeant
La dyspraxie rappelle combien le geste humain est une orchestration complexe. Derrière un mouvement apparemment simple — boutonner une chemise, tracer une lettre, attraper un ballon — se cache une coordination fine entre planification, perception et exécution. Lorsque cet équilibre se rompt, l’enfant se heurte à des obstacles invisibles : la ligne qui dévie malgré ses efforts, la chaussure impossible à lacer, le regard pesant des autres. La maladresse devient alors une expérience intime de décalage entre l’intention et l’action.
Mais rien n’est figé : le cerveau reste plastique, façonné par l’expérience. Chaque tentative, même maladroite, redessine peu à peu ses circuits neuronaux. Le mouvement n’est pas seulement un effet du cerveau, il en est aussi l’architecte. Le psychomotricien ne cherche pas à « corriger » un geste, mais à restaurer la confiance entre le corps et la pensée, à ouvrir de nouveaux chemins. Cette approche, qui valorise le processus plutôt que la performance, permet à l’enfant de réconcilier ce qu’il ressent, ce qu’il imagine et ce qu’il accomplit. Le mouvement devient alors un langage, un terrain d’expérimentation, un laboratoire du vivant. Ainsi, la psychomotricité défend une pédagogie incarnée où l’échec devient tremplin. Bouger, c’est apprendre. Et apprendre, c’est aussi bouger.
En définitive, la psychomotricité n’est pas une correction, mais une réécriture du vivant. Elle ouvre des possibles là où il n’y avait que des impasses. Peut-être est-ce là sa leçon la plus précieuse : nous sommes des êtres de mouvement, et c’est en bougeant — maladroitement parfois, mais sincèrement toujours — que nous sculptons nos cerveaux et découvrons la liberté d’apprendre autrement.
Références
Blank, R., Smits-Engelsman, B., Polatajko, H., & Wilson, P. (2019). European Academy for Childhood Disability (EACD): Recommendations on the definition, diagnosis and intervention of developmental coordination disorder. Developmental Medicine & Child Neurology, 61(3), 242–285.
Immordino-Yang, M. H., & Damasio, A. (2007). We feel, therefore we learn: The relevance of affective and social neuroscience to education. Mind, Brain, and Education, 1(1), 3–10.
Merzenich, M. M. (2001). Cortical plasticity contributing to child development and learning. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 7(4), 289–295.
Wilson, P. H., Ruddock, S., Smits-Engelsman, B., Polatajko, H., & Blank, R. (2013). Understanding performance deficits in developmental coordination disorder: A meta-analysis of recent research. Developmental Medicine & Child Neurology, 55(3), 217–228.
Zwicker, J. G., Missiuna, C., Harris, S. R., & Boyd, L. A. (2012). Brain activation of children with developmental coordination disorder is different than peers. NeuroReport, 23(8), 463–468.
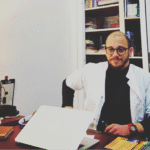
Saad Chraibi
Psychomotricien
• Diplômé de l’Université Mohammed VI à Casablanca, exerçant en libéral dans son propre cabinet à Casablanca (Maroc).
• Adopte une approche globale et intégrative, prenant en compte les dimensions corporelle, psychique, émotionnelle et relationnelle de la personne.
• Ancien étudiant en médecine (4 années), disposant d’une solide formation biomédicale et d’une rigueur clinique intégrée à sa pratique psychomotrice.
• Expérience professionnelle diversifiée : structures associatives, exercice libéral, travail interdisciplinaire avec orthophonistes, psychologues, neuropsychologues.
• Spécialisé dans l’adaptation des prises en charge à des profils variés, avec une forte orientation vers le travail en réseau.
• Investi dans des projets thérapeutiques personnalisés, fondés sur des évaluations précises et respectueux du rythme, de l’histoire et du potentiel de chaque patient, quel que soit son âge.




