Grandir par le mouvement : La psychomotricité comme socle éducatif
Grandir, c’est traverser une succession de conquêtes corporelles et mentales, une lente orchestration où chaque geste esquissé, chaque mouvement tenté et chaque équilibre trouvé participe à l’édification de l’enfant. Bien avant d’apprendre à lire ou à compter, il découvre le monde à travers son corps, par ses gestes, ses regards, ses appuis, ses jeux de mains. Ces expériences motrices sont les premières pierres de son développement, et c’est précisément dans cette rencontre entre le corps et l’esprit que la psychomotricité prend tout son sens.
Henri Wallon, l’un des pionniers de la psychologie du développement, affirmait déjà que « le mouvement est à la base de la pensée ». Jean Piaget, quant à lui, a montré que l’intelligence naît de l’action, du rapport concret que l’enfant établit avec son environnement à travers ses sens et sa motricité. Lev Vygotski, enfin, a insisté sur le rôle des interactions sociales et culturelles dans la construction psychomotrice : chaque geste est aussi une médiation vers l’autre. Autrement dit, la psychomotricité n’est pas une discipline secondaire : elle constitue le socle invisible de tout développement affectif, cognitif et social.
🔗 À lire aussi : Une histoire par jour, et le cerveau s’éveille
Le corps comme premier langage de l’enfant
Du point de vue neuromusculaire, chaque progrès moteur est l’aboutissement d’un dialogue complexe entre cerveau et corps. Lorsque le nourrisson tend les bras pour saisir un objet, il active ses circuits corticospinaux, son cervelet ajuste la précision du geste, et ses récepteurs proprioceptifs informent son cerveau sur la position de son corps dans l’espace. Ce geste simple, qui semble n’être qu’un jeu, entraîne en réalité une cascade d’apprentissages : coordination œil-main, anticipation, planification et persévérance. Paul Ajuriaguerra, neuropsychiatre et figure majeure de la psychomotricité, a montré combien la maturation du tonus et du geste constitue la base de l’accès au langage et à la pensée symbolique.
La motricité fine, souvent sous-estimée, est un révélateur de cette complexité. Tenir un crayon, dessiner une forme, découper une feuille mobilisent à la fois les muscles intrinsèques de la main, les circuits sensorimoteurs du cortex pariétal et les aires préfrontales impliquées dans l’attention et la planification. Des études longitudinales menées notamment par Cameron et coll. (2012) ont démontré que les compétences en motricité fine à l’âge de 5 ans prédisaient significativement les performances scolaires en lecture et en mathématiques à l’âge de 8 ans. Ainsi, un enfant qui manipule des cubes ou qui trace maladroitement ses premières lettres est déjà en train de sculpter les fondations de ses futurs apprentissages.
La motricité globale, elle, engage le rapport au monde. Courir, sauter, grimper ou danser active le système vestibulaire, centre de l’équilibre situé dans l’oreille interne, ainsi que le cervelet, véritable « chef d’orchestre » du mouvement. Ces expériences corporelles permettent à l’enfant d’intégrer son schéma corporel et de construire une conscience spatiale et temporelle. Arnold Gesell, pédiatre et psychologue, avait établi dès les années 1930 des courbes de développement moteur (marche, préhension, équilibre) qui montrent la régularité des acquisitions, mais aussi leur rôle structurant pour les autres domaines. Un enfant qui grimpe à un arbre n’entraîne pas seulement ses muscles : il apprend à gérer son appréhension, à calculer une trajectoire, à s’adapter à l’imprévu. Ces compétences motrices deviennent ensuite des compétences cognitives et sociales.
🔗 Découvrez également : Le poison du quotidien : Ce que la sédentarité fait à votre cerveau
Quand les gestes sculptent le cerveau
Les neurosciences actuelles confirment ces intuitions. À la naissance, le cerveau compte environ 100 milliards de neurones, mais ce n’est pas leur nombre qui importe : ce sont les connexions. Entre 0 et 3 ans, l’enfant crée jusqu’à 1 million de synapses par seconde (Center on the Developing Child, Harvard University, 2016). Cette effervescence synaptique est modulée par l’expérience : chaque geste, chaque exploration sensorimotrice vient renforcer certains circuits et en élaguer d’autres. La marche, qui apparaît en moyenne entre 12 et 15 mois, illustre bien cette dynamique. Elle n’est pas qu’une prouesse mécanique : elle ouvre à l’enfant l’accès à de nouveaux espaces, élargit son champ d’exploration, stimule son langage et enrichit sa vie sociale. Des études montrent que les enfants qui acquièrent tôt la marche développent aussi une communication gestuelle et verbale plus riche, preuve que motricité et cognition cheminent de concert.
La latéralisation constitue un autre exemple frappant. Entre 5 et 7 ans, l’enfant stabilise sa dominance d’un côté du corps (main, pied, œil). Ce processus, lié à la spécialisation hémisphérique cérébrale, est crucial pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Un enfant dont la latéralité n’est pas encore consolidée peut confondre gauche et droite, inverser des lettres, ou avoir des difficultés à suivre la ligne du texte. Ajuriaguerra insistait sur ce lien entre organisation corporelle et organisation cognitive, rappelant que « l’enfant écrit avec son corps autant qu’avec sa main ».
L’écriture, d’ailleurs, en est l’exemple le plus achevé. Acte complexe, elle engage la motricité fine, la posture, la régulation tonique, la coordination visuo-motrice, mais aussi la structuration spatiale et temporelle. Un enfant dysgraphique n’est pas seulement maladroit : il révèle une fragilité psychomotrice qui entrave l’harmonisation du geste et de la pensée. C’est pourquoi la prise en charge psychomotrice vise à restaurer cette unité, en travaillant le tonus, l’espace, le rythme, pour permettre au geste d’écrire de devenir fluide et porteur de sens.
🔗 En lien avec ce sujet : Psychomotricité : L’histoire d’un corps en quête de sens
En définitive, la psychomotricité éclaire une vérité essentielle : le corps est le premier langage de l’enfant, le premier support de son intelligence, le premier outil de sa relation au monde. Favoriser son développement psychomoteur, c’est nourrir simultanément ses compétences motrices, affectives et cognitives. Comme l’écrivait Wallon, « la pensée est fille de l’émotion et du mouvement ». Derrière chaque pas hésitant, chaque dessin maladroit, chaque course joyeuse se cache une promesse immense : celle de devenir un être capable de raisonner, de créer, d’aimer et d’habiter pleinement le monde.
Référenecs
Ajuriaguerra, J. de (1974). La dysgraphie chez l’enfant. Masson.
Cameron, C. E. et al. (2012). Fine Motor Skills and Executive Function Both Contribute to Kindergarten Achievement. Child Development, 83(4), 1229–1244.
Diamond, A. (2000). Close interrelation of motor development and cognitive development and of the cerebellum and prefrontal cortex. Child Development, 71(1), 44–56.
Gesell, A. (1945). The Embryology of Behavior: The Beginnings of the Human Mind. Harper & Brothers.
Piaget, J. (1936). La naissance de l’intelligence chez l’enfant. Delachaux et Niestlé.
Vygotski, L. S. (1934/1997). Pensée et langage. La Dispute.
Wallon, H. (1942). L’évolution psychologique de l’enfant. Armand Colin.
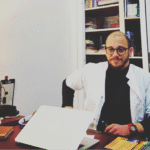
Saad Chraibi
Psychomotricien
• Diplômé de l’Université Mohammed VI à Casablanca, exerçant en libéral dans son propre cabinet à Casablanca (Maroc).
• Adopte une approche globale et intégrative, prenant en compte les dimensions corporelle, psychique, émotionnelle et relationnelle de la personne.
• Ancien étudiant en médecine (4 années), disposant d’une solide formation biomédicale et d’une rigueur clinique intégrée à sa pratique psychomotrice.
• Expérience professionnelle diversifiée : structures associatives, exercice libéral, travail interdisciplinaire avec orthophonistes, psychologues, neuropsychologues.
• Spécialisé dans l’adaptation des prises en charge à des profils variés, avec une forte orientation vers le travail en réseau.
• Investi dans des projets thérapeutiques personnalisés, fondés sur des évaluations précises et respectueux du rythme, de l’histoire et du potentiel de chaque patient, quel que soit son âge.







