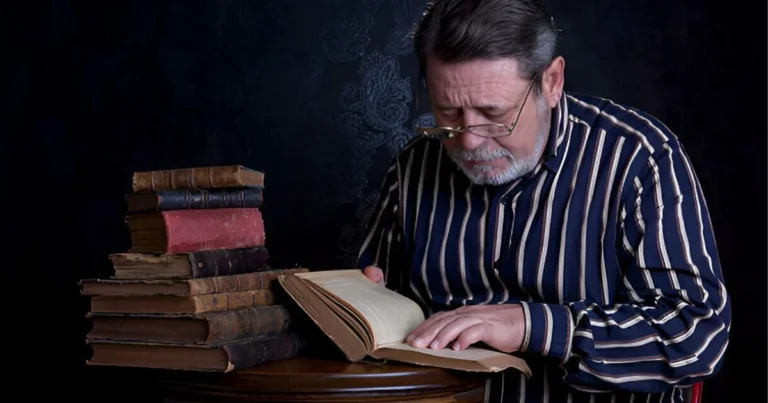Le visage du sosie : L’énigme du syndrome de Capgras
Dans son roman, La Chambre aux échos, Richard Powers explore les frontières instables de la conscience à travers le destin de Mark Schluter, un homme dont la réalité se fissure lentement. Victime d’un grave accident, Mark se réveille dans une chambre d’hôpital. Il reconnaît le visage penché sur lui, celui de sa sœur, Karen. La voix est la même, les traits aussi, jusqu’aux rides familières aux coins des yeux. Et pourtant, quelque chose cloche. Un soupçon, une certitude glacée. Ce n’est pas elle. Ce ne peut pas être elle. C’est une autre femme, parfaitement semblable, mais étrangère. Un sosie.
Une telle scène pourrait être interprétée comme une métaphore du deuil ou de la fracture intérieure qu’engendre le traumatisme. Mais elle s’enracine dans une réalité neurologique bien documentée, quoique rare et déroutante : le syndrome de Capgras. Ce trouble du lien et de la reconnaissance pousse un individu à croire que ses proches ont été remplacés par des imposteurs indétectables, des doubles sans authenticité. Il ne s’agit pas d’un doute passager ou d’un trouble de la mémoire. Il s’agit d’une certitude, une conviction souvent imperméable à toute argumentation logique. Le visage est reconnu, mais sa présence est niée. Ce paradoxe, aussi troublant pour les cliniciens que pour les familles, continue de défier notre compréhension du cerveau humain.
Voir sans reconnaître : Quand la reconnaissance s’effondre
Si Mark est un personnage de fiction, son trouble, lui, est bien réel. En 1923, les psychiatres français Joseph Capgras et Jean Reboul-Lachaux décrivent pour la première fois cette illusion, à partir d’une patiente persuadée que des sosies ont envahi son entourage. Depuis, ce syndrome est devenu un objet de fascination pour les neurosciences, la psychiatrie et même la philosophie. Car ce qui vacille ici, ce n’est pas la reconnaissance visuelle. Les patients atteints du syndrome de Capgras identifient parfaitement les traits de la personne en face d’eux. Ce qu’ils ne reconnaissent plus, c’est la présence affective qui donne du sens à ce visage. Le visage est bien vu, bien identifié, mais il ne déclenche plus rien. Ce qui manque, ce n’est pas l’image, mais la résonance.
Pour mieux comprendre ce phénomène, il faut revenir sur la manière dont le cerveau traite les visages familiers. Cette tâche repose en grande partie sur une région du lobe temporal appelée gyrus fusiforme, qui joue un rôle central dans la reconnaissance visuelle des visages. C’est là que se construit l’image stable, unique, de ceux que nous connaissons. Mais cette reconnaissance ne suffit pas à elle seule. Pour que cette image fasse sens, elle doit s’accompagner d’un ressenti, d’une chaleur, d’un élan. Ce lien est assuré par des circuits plus profonds, notamment l’amygdale et le système limbique, qui attribuent une valence émotionnelle au stimulus. Chez les patients atteints du syndrome de Capgras, ces circuits ne s’activent plus. Le visage est reconnu, mais il n’évoque plus rien. L’absence de cette réponse affective devient insupportable pour le cerveau. Alors, il cherche une explication. Et la plus plausible, ou plutôt la moins douloureuse, devient : « Ce n’est pas elle… Elle lui ressemble trait pour trait, mais ce n’est pas elle. C’est son sosie. »
🔗 À lire aussi : Prosopagnosie : Le monde sans visages
Quand l’illusion devient contagieuse: le délire à deux
Parmi les cas les plus déroutants du syndrome de Capgras figure celui rapporté récemment en 2024 par Vladimir Knežević et son équipe. L’étude s’intéresse à une forme particulièrement rare et dramatique de ce trouble : le syndrome de Capgras partagé, survenant dans le contexte d’un trouble psychotique induit. Deux sœurs, jusque-là sans antécédents psychiatriques majeurs, se retrouvent plongées dans une dynamique délirante qui les pousse à croire que leurs parents ont été remplacés par des imposteurs. L’une des sœurs, plus jeune, souffre d’une forme de schizophrénie paranoïde, avec un discours désorganisé, des hallucinations auditives et une croyance inébranlable que sa mère a été clonée par leurs voisins. L’autre, bien que sans symptôme psychotique manifeste, adopte peu à peu la même conviction, dans un isolement social croissant accentué par la mort du père. Les chercheurs ont pu suivre cette évolution au fil des années, dans un contexte où les patientes vivent dans une proximité exclusive, sans contact extérieur, renforçant le caractère clos du délire. Les deux femmes ont été hospitalisées de force à la suite d’un acte de violence dirigé contre leur mère, qu’elles considéraient comme une usurpatrice.
Séparées lors de leur hospitalisation, elles ont reçu un traitement antipsychotique. Si l’aînée s’est rapidement améliorée, l’autre a présenté une évolution plus lente et incomplète. Le suivi à long terme révèle un tableau inquiétant. Quinze ans plus tard, après une longue période d’isolement rural avec leur mère, les deux sœurs récidivent avec un nouvel épisode de violence. Cette fois, la cible n’est plus familiale, mais un voisin, accusé d’être un complice du sosie. Cette étude met en garde contre les effets délétères du maintien d’un environnement délirant non pris en charge, et insiste sur la nécessité d’un accompagnement à long terme. Le délire, même atténué par un traitement, peut persister en veille dans une structure mentale fragilisée, et resurgir à la faveur d’un nouveau repli ou d’une perte de repère.
🔗 Découvrez également : Les faux souvenirs : Quand notre mémoire nous joue des tours
Les circuits débranchés de la familiarité
Le syndrome de Capgras intrigue parce qu’il révèle une scission silencieuse entre deux fonctions que l’on croit inséparables : voir et ressentir. Ce n’est pas la reconnaissance qui échoue, mais le lien émotionnel qui l’accompagne. Le visage est bien identifié, mais il ne provoque plus la moindre résonance. Comme si la perception, amputée de sa charge affective, devenait suspecte.
C’est précisément ce que démontrent les travaux du neurologue Ramachandran et du chercheur William Hirstein à l’Université de Californie. Ils étudient un patient persuadé que ses parents ont été remplacés par des imposteurs. Pour explorer cette conviction, ils mesurent ses réponses électrodermales, un indicateur physiologique des réactions émotionnelles, lorsqu’il regarde des visages familiers. Les résultats montrent une absence totale de réaction physiologique face aux visages familiers, comme si ces derniers ne déclenchaient plus aucune résonance émotionnelle. Le visage de sa mère est reconnu, mais il ne déclenche rien. Il est perçu comme neutre, étranger, vidé de son lien affectif.
Pour rendre compte de ce phénomène, Ramachandran propose un modèle désormais classique, fondé sur deux voies cérébrales. La voie ventrale, intacte chez ce patient, permet la reconnaissance visuelle consciente des visages. Mais la voie dorsale, qui relie les centres visuels à l’amygdale, région essentielle dans le traitement émotionnel, semble altérée. Le cerveau voit, mais il ne sent plus. Cette dissociation suffit à rompre la continuité de la présence, et à faire naître l’illusion d’un sosie. L’impression est si intense, si incongrue, que le cerveau l’interprète comme une preuve : « ce n’est pas elle ».
Cette hypothèse sera enrichie quelques années plus tard par une équipe de Harvard. Grâce à l’imagerie fonctionnelle, les chercheurs ont identifié une désorganisation des connexions entre les régions temporales, impliquées dans l’analyse visuelle des visages, et les régions préfrontales, qui permettent de confronter les perceptions à la réalité. Le syndrome de Capgras ne serait donc pas seulement une défaillance perceptive, mais aussi une altération du système de croyance et de validation. Le visage semble authentique, mais l’absence de familiarité émotionnelle n’est plus remise en question par le cerveau. L’anomalie n’est pas intégrée comme doute, elle devient certitude. Et cette certitude, le patient ne peut ni la discuter, ni s’en détacher.
Ainsi, derrière la conviction délirante du sosie se cachent deux ruptures silencieuses : une rupture du lien émotionnel, et une rupture du contrôle cognitif. Le cerveau ne parvient plus à dire : « c’est étrange, mais peut-être que je me trompe ». Il dit au contraire : « c’est étrange, donc ce n’est pas elle ». Entre l’image reconnue et le cœur qui ne répond plus, la pensée comble le vide par une histoire : celle du double, du vol d’identité, de l’imposture.
Le syndrome de Capgras nous force à reconsidérer ce que signifie reconnaître quelqu’un. Ce n’est pas un acte purement visuel. C’est une résonance, un lien tissé dans le temps. Nous ne reconnaissons pas des visages, mais des présences. Et lorsque ce fil invisible se rompt, c’est toute notre vie relationnelle qui se disloque. Le trouble met aussi en lumière la complexité du cerveau humain. À chaque instant, il coordonne une infinité de signaux, visuels, émotionnels, mnésiques, pour que le monde garde sa cohérence. Et quand l’une de ces connexions se rompt, il compense, il fabrique, il délire. Le cerveau n’est pas une simple machine à percevoir. C’est une fabrique de sens.
🔗 Vous aimerez également: Le monde déformé : Le syndrome d’Alice au pays des merveilles
Cette logique, qui redonne du sens au délire en tant que tentative d’élaboration psychique face à une perte intolérable, suggère que certains syndromes d’illusion, loin de constituer des disfonctionnements isolés, peuvent être envisagés comme les manifestations ultimes d’une tentative subjective de restaurer une forme de cohérence interne. Le syndrome de Capgras devient alors le miroir tragique de notre besoin d’autrui, de notre ancrage dans le lien, et de la souffrance extrême qu’entraîne sa rupture.
Références
Capgras, J., & Reboul-Lachaux, J. (1923). L’illusion des sosies dans un délire systématisé chronique. Bulletin de la Société Clinique de Médecine Mentale, 11, 6–16.
Darby, R. R., Laganiere, S., Pascual-Leone, A., Prasad, S., & Fox, M. D. (2017). Finding the imposter: brain connectivity of lesions causing delusional misidentifications. Brain : a journal of neurology, 140(2), 497–507.
Hirstein, W., & Ramachandran, V. S. (1997). Capgras syndrome: A novel probe for understanding the neural representation of the identity and familiarity of persons. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 264(1380), 437–444.
Knežević, V., Ratkovic, D., Ivanovic Kovacevic, S., Sobot, V., Vejnovic, A. M., & Comic, M. (2024). Importance of Capgras syndrome in shared psychotic disorder: a case report. Journal of International Medical Research, 52(3), 1–7.
Powers, R. (2006). The Echo Maker. New York: Farrar, Straus and Giroux. (Titre français : La Chambre aux échos, 2008, Actes Sud)

Sara Lakehayli
Docteur en neuroscience cliniques et santé mentale, PhD
Membre associée au Laboratoire des Maladies du Système Nerveux, Neurosensorielles et du Handicap, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca.
Professeur à l'école supérieure de psychologie