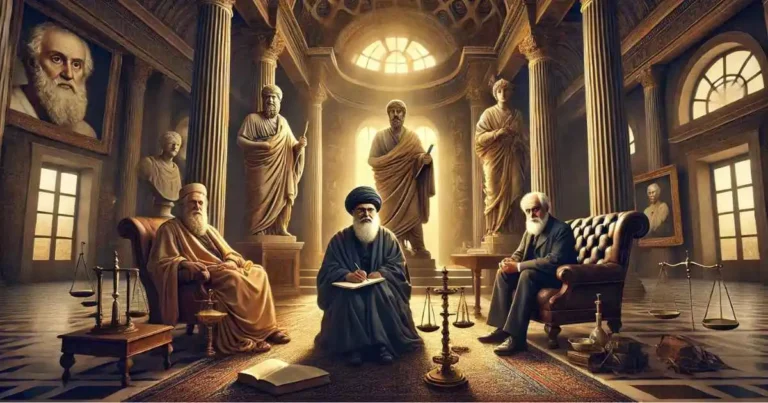Prosopagnosie : Le monde sans visages
Il voyait les yeux, les nez, les bouches. Il pouvait les dessiner avec une rigueur presque froide, chaque ligne juste, chaque courbe exacte. Mais ce qu’il dessinait ne signifiait rien. Il ne reconnaissait pas ce qu’il venait lui-même de tracer. Les visages ne lui parlaient plus. Il ne les voyait pas flous, non, il les voyait trop bien, mais en morceaux. Un menton, une oreille, des lunettes… tout était là, éparpillé, dissocié, privé de cette unité mystérieuse qui fait un visage.
Quand on lui montrait une photo de lui-même, il secouait la tête. Ce visage-là, disait-il, il ne l’avait jamais vu. Même son propre reflet dans un miroir restait celui d’un inconnu. Il pouvait passer devant une glace sans soupçonner que l’homme qu’il croisait… c’était lui. Et pourtant, il n’était pas perdu dans le monde. Il reconnaissait les objets, les lieux, les voix. Ce que ses yeux ne retenaient plus, son oreille le saisissait. Il identifiait sa femme à sa manière de parler, ses amis à leur rire, à leur démarche. Le visage seul ne suffisait plus, ou plutôt, il ne disait plus rien.
Ce n’est pas une fiction, mais un fragment de réel tiré de l’histoire d’un patient atteint de prosopagnosie, cette étrange cécité des visages, où l’on voit sans reconnaître, où les traits familiers deviennent anonymes, comme effacés par l’étrangeté. Une forme d’agnosie où le plus humain des repères devient soudain indéchiffrable. Chez ce patient décrit par le neurologue Oliver Sacks, la reconnaissance était devenue un art du détour. Il avançait dans un monde où les masques avaient remplacé les visages, où les présences flottaient sans ancrage.
L’étrangeté familière des visages perdus
Il y a, dans la prosopagnosie, une étrangeté à la fois clinique et existentielle, les visages sont là, pleinement visibles, détaillés, bien éclairés, et pourtant, ils ne disent plus rien. L’œil les perçoit, mais la personne s’efface. Ce qui devrait susciter la reconnaissance intime d’un proche, d’un parent, d’un ami, ne déclenche qu’un silence intérieur. Le visage devient une présence sans nom, un assemblage de traits aussi inutiles qu’une signature illisible. L’étrangeté de cette expérience ne vient pas d’un flou ou d’une cécité, mais de cette lucidité glaçante, on voit très bien, mais on ne sait plus qui.
La prosopagnosie touche un territoire bien précis de la perception, celui de la reconnaissance des visages. La vision, dans son ensemble, demeure intacte. Lire, reconnaître des objets, s’orienter dans l’espace, tout cela reste possible. Mais ce qui s’effondre, c’est cette fonction si discrète et pourtant essentielle : la capacité à reconnaître un visage familier parmi tous les autres. Les expressions émotionnelles, les sourires, les froncements de sourcils, parfois même un regard insistant, peuvent encore être perçus. Mais la personne qui habite ces expressions… elle ne se révèle plus. Le visage devient une surface sans nom. Le lien entre traits et identité, naguère immédiat, se défait silencieusement.
C’est ici que la recherche anatomique éclaire cette perte invisible. Dès les années 1970 les chercheurs ont constaté que la prosopagnosie est liée à des lésions de la région occipito-temporale inférieure droite, parfois symétriques, affectant les gyri fusiformes. Ces zones, interfaces entre la perception visuelle et la mémoire identitaire, constituent une carteneuronale du visage humain. Quand elles sont lésées, même partiellement, le cerveau perd sa capacité à lire un visage comme un tout, il ne reste que des fragments, des morceaux sans cohérence. Certains patients peuvent ainsi décrire des lunettes, un nez, une cicatrice… mais sont incapables de dire à qui tout cela appartient.
Le visage, pourtant, est notre miroir le plus essentiel. C’est lui qui nous permet d’entrer en relation, de ressentir la familiarité, de reconnaître en l’autre quelqu’un. Dans la prosopagnosie, cette fonction première est abolie. Le monde devient une foule d’inconnus familiers, un défilé de masques où il faut toujours deviner, supposer, ou feindre de savoir. Pour certains patients, cette perte est vécue comme un exil social discret, une gêne quotidienne, parfois une douleur intime. Ne pas reconnaître son propre reflet, ne pas pouvoir identifier son enfant sans sa voix, c’est être privé d’une part de soi autant que de l’autre.
Et pourtant, ces patients ne sont ni délirants, ni déments, ni aveugles. Ils ont simplement perdu l’accès à ce que nous croyons aller de soi : la présence de l’autre dans son visage. Ils nous rappellent à quel point ce geste, si banal, de reconnaître un visage, est en réalité un miracle neurologique, un équilibre fragile entre perception, mémoire, émotion et attention.
La carte brouillée de la reconnaissance
La reconnaissance faciale est une aptitude si fondamentale qu’elle semble aller de soi. Dès les premières heures de vie, les nourrissons s’orientent spontanément vers les visages. À l’âge adulte, elle devient un mécanisme automatique, rapide, souvent inconscient. Pourtant, chez certaines personnes, ce processus ne s’installe jamais. Dans la prosopagnosie développementale, la difficulté à reconnaître les visages n’est pas acquise au fil du temps ni causée par une lésion : elle est présente dès l’enfance, inscrite dans un défaut de spécialisation des circuits cérébraux impliqués dans la reconnaissance faciale. Une manière d’être au monde sans jamais capter cette présence invisible qui rend chaque visage unique.
Ce trouble, longtemps ignoré, affecte environ 2 à 3 % de la population et reste souvent non diagnostiqué. Ceux qui en souffrent développent très tôt des stratégies de contournement : ils reconnaissent les autres par leur voix, leur façon de marcher, leur parfum, ou encore les objets qu’ils portent. Une reconnaissance périphérique, indirecte, parfois efficace, mais toujours fragile. En 2023, une équipe de chercheurs internationaux , Valerio Manippa, Annalisa Palmisano, Martina Ventura et Davide Rivolta , a publié une étude importante dans la revue Brain Sciences. Leur objectif était de comprendre, après vingt-cinq années de recherches en neuroimagerie, ce qui se passe réellement dans le cerveau des personnes atteintes de prosopagnosie développementale. Contrairement à une simple compilation de résultats, leur travail relie les différentes études en les éclairant à la lumière des connaissances actuelles. Une manière de tracer le fil rouge d’un trouble longtemps mal compris.
Ce que montre cette recherche, c’est que reconnaître un visage ne dépend pas d’un seul endroit dans le cerveau, mais d’un réseau complexe, principalement situé dans l’hémisphère droit. Ce réseau, appelé core face network, repose sur trois zones clés : une région à l’arrière du cerveau qui détecte les traits (OFA), une autre dans le gyrus fusiforme qui aide à identifier les visages (FFA), et une troisième dans le sillon temporal supérieur qui capte les mouvements, comme les expressions ou le regard (pSTS). Ce noyau est soutenu par un réseau plus large, qui participe à la reconnaissance des émotions, à l’accès à la mémoire des personnes et à l’attention portée aux visages familiers.
Dans la prosopagnosie développementale, ce système ne fonctionne pas comme prévu. Les chercheurs ont analysé 63 études impliquant plus de 800 personnes atteintes de ce trouble, afin de mieux comprendre son origine. Alors que les premières recherches n’avaient pas identifié d’anomalie évidente dans le cerveau, les études plus récentes montrent des différences claires qui se traduisent par une connectivité affaiblie entre les régions du cerveau, une activité réduite, et un fonctionnement désorganisé du réseau facial.
Les images cérébrales révèlent notamment une diminution de la matière grise dans certaines zones importantes, comme la FFA droite, le pSTS, et le gyrus temporal moyen. Ce dernier n’est pas spécialisé dans les visages, mais il aide à accéder à des informations sur les personnes connues, comme leur nom ou leur histoire. De plus, les connexions entre ces régions, en particulier dans l’hémisphère droit, sont moins efficaces. C’est un peu comme si les autoroutes cérébrales entre les zones visuelles et celles de la reconnaissance faciale étaient partiellement bouchées.
Mais l’altération ne s’arrête pas à l’anatomie. Le fonctionnement même de ces régions est perturbé. Par exemple, lorsque l’on montre plusieurs fois le même visage à un cerveau typique, la FFA réduit son activité, signe qu’elle le reconnaît. Chez les personnes atteintes de prosopagnosie, cette réduction ne se produit pas. Leur cerveau semble réagir à chaque visage comme s’il était nouveau, incapable de le stabiliser en mémoire. Plus étonnant encore, certaines personnes perçoivent bien les traits d’un visage, et sont capables d’identifier des émotions ou des expressions. Pourtant, elles ne parviennent pas à savoir de qui il s’agit. Cela signifie que ce n’est pas la vision en elle-même qui est défaillante, mais le passage entre perception et souvenir, comme si le visage restait toujours un étranger, même après l’avoir vu cent fois.
Les enregistrements cérébraux, réalisés par électroencéphalographie (EEG), confirment cette idée. Une onde particulière, appelée N170, apparaît normalement environ 170 millisecondes après la présentation d’un visage. Elle est plus forte pour les visages que pour les objets, et plus marquée dans l’hémisphère droit. Chez les personnes atteintes de prosopagnosie, cette onde est souvent plus faible, moins spécifique ou mal latéralisée. D’autres ondes, associées à la mémoire et à la reconnaissance consciente, sont également altérées. C’est comme si le cerveau commençait le processus… mais n’allait pas jusqu’au bout.
Pour autant, ce trouble ne se manifeste pas de la même façon chez tout le monde. Certains patients développent des stratégies ingénieuses : ils reconnaissent les gens à leur voix, leur façon de marcher, leurs vêtements ou leur parfum. D’autres présentent des réponses cérébrales presque normales, mais restent incapables de reconnaître un visage. Cela montre que la prosopagnosie développementale est un trouble très variable, un spectre plus qu’une catégorie unique.
Mais il y a de l’espoir. Des recherches récentes suggèrent que le cerveau peut s’adapter. Une étude dirigée par DeGutis et ses collègues a testé un entraînement basé sur la perception globale des visages, c’est-à-dire la capacité à voir un visage comme un tout, et non comme une somme d’éléments. Après cet entraînement, les participants ont montré des améliorations à la fois dans leurs performances et dans l’activité de leur cerveau, notamment dans les régions-clés comme la FFA et l’OFA. Cela signifie que même si les circuits sont atypiques, ils peuvent être stimulés et renforcés avec les bonnes méthodes.
Mais au-delà de la rééducation, la prosopagnosie nous interroge sur les fondements mêmes de notre rapport aux autres. Reconnaître un visage, c’est reconnaître une personne. C’est un acte de liaison, d’incarnation, d’ancrage dans le tissu social. Le visage, c’est ce qui nous distingue, ce qui nous trahit, ce qui nous relie. Lorsque cette fonction s’effondre, c’est tout un monde de présences, de souvenirs, de familiarités qui se brouille.
Quand le clinicien devient le patient
La prosopagnosie n’est pas qu’un objet d’étude pour les cliniciens, elle peut aussi habiter celui qui observe. Oliver Sacks, neurologue de renom, en savait quelque chose. Longtemps, il a ignoré que ses difficultés à reconnaître les visages avaient un nom. Il pensait être distrait, ou bizarre comme il le disait lui-même avec ironie. Ce n’est qu’après avoir rencontré ses propres patients atteints de prosopagnosie qu’il a reconnu, dans leur expérience, un reflet de la sienne.
Sacks n’oubliait pas les gens. Il se souvenait de leurs paroles, de leur énergie, parfois même de la musique de leur voix. Mais leurs visages ne s’imprimaient pas. Il pouvait croiser un collègue dans un ascenseur et lui parler comme à un inconnu. Il pouvait saluer chaleureusement un ami… et ne pas le reconnaître une heure plus tard, s’il avait changé de veste. Il a un jour expliqué qu’il pouvait se retrouver perdu dans une salle bondée parce qu’aucun visage ne ressortait du flot, tous flottaient dans une indifférence visuelle troublante, comme des silhouettes interchangeables. Il racontait aussi, avec humour et une certaine mélancolie, comment il ne se reconnaissait pas lui-même dans un miroir ou sur une photo, à moins qu’un indice extérieur, sa barbe, son costume, l’arrière-plan, ne vienne trahir son identité. Ce n’était pas une perte de mémoire. C’était une incapacité à faire coïncider le visage vu avec le soi connu.
Cette révélation fut pour lui un basculement. Car elle transforma ce qu’il croyait être une singularité gênante en phénomène neurologique objective. En devenant le patient de son propre livre, il illustra mieux que quiconque à quel point la prosopagnosie n’est pas un défaut d’attention, ni une négligence sociale, mais une variation profonde de la façon dont le cerveau relie l’image au lien. Vivre avec ce trouble, disait-il, c’est naviguer dans un monde relationnel sans visages, où l’on apprend à écouter plus fort, à repérer les petits détails, à cultiver d’autres formes de reconnaissance. Mais c’est aussi, parfois, se sentir décalé au cœur de la rencontre, comme si l’autre était là, mais voilé d’un flou que rien ne dissipe.
En révélant sa propre prosopagnosie, Oliver Sacks a humanisé le trouble qu’il décrivait. Il a fait de cette perte une fenêtre ouverte sur les mystères de la perception, sur la part invisible que joue le cerveau dans notre lien aux autres. Il a montré qu’on peut être un grand neurologue… sans jamais reconnaître le visage de ses collègues dans un couloir.
Le monde sans visages n’est pas vide, il est réorganisé. Il devient un monde de voix, de silhouettes, de gestes. Un monde où l’identification passe par d’autres chemins. Et dans ce monde-là, les personnes atteintes de prosopagnosie ne sont ni perdues, ni brisées. Elles habitent autrement, elles voient autrement. Leur handicap devient une invitation à penser la perception non comme une simple captation de stimuli, mais comme un art de tisser du sens entre les fragments.
Références
Manippa, V., Palmisano, A., Ventura, M., & Rivolta, D. (2023). The neural correlates of developmental prosopagnosia: Twenty-five years on. Brain Sciences, 13(10), 1399.
Meadows, J. C. (1974). The anatomical basis of prosopagnosia. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 37(5), 489–501. https://doi.org/10.1136/jnnp.37.5.489
Lahiri, D. (2020). Prosopagnosia. Cortex. Advance online publication.
Sacks, O. (2010). L’œil de l’esprit (trad. F. Rosso). Paris : Seuil.

Sara Lakehayli
Docteur en neuroscience cliniques et santé mentale, PhD
Membre associée au Laboratoire des Maladies du Système Nerveux, Neurosensorielles et du Handicap, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca.
Professeur à l'école supérieure de psychologie