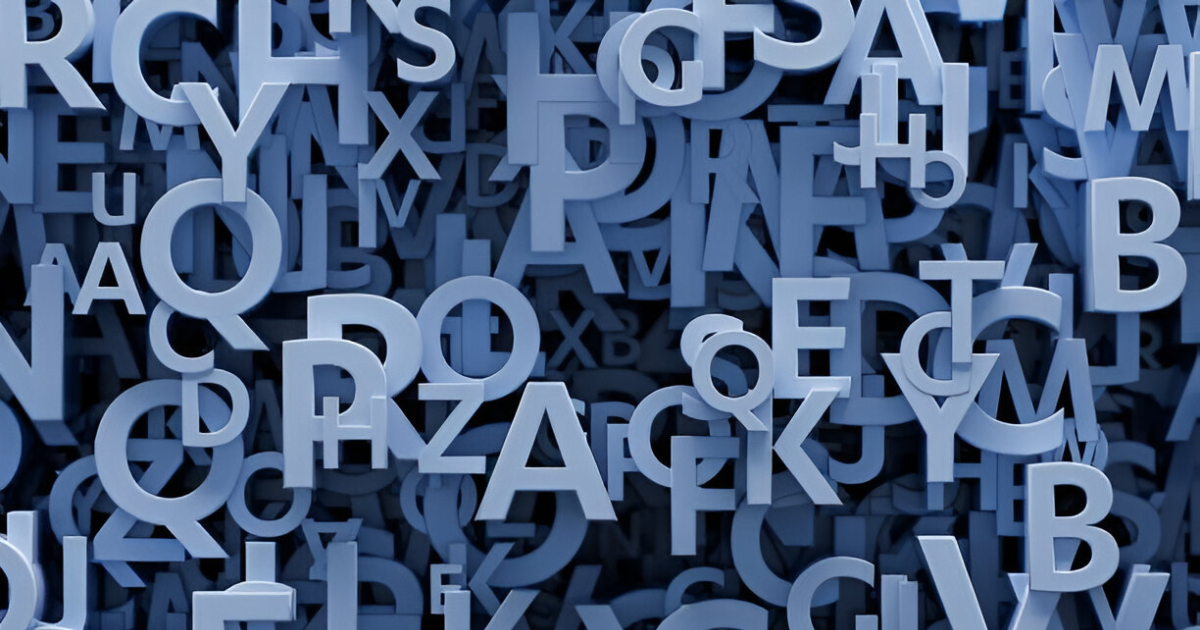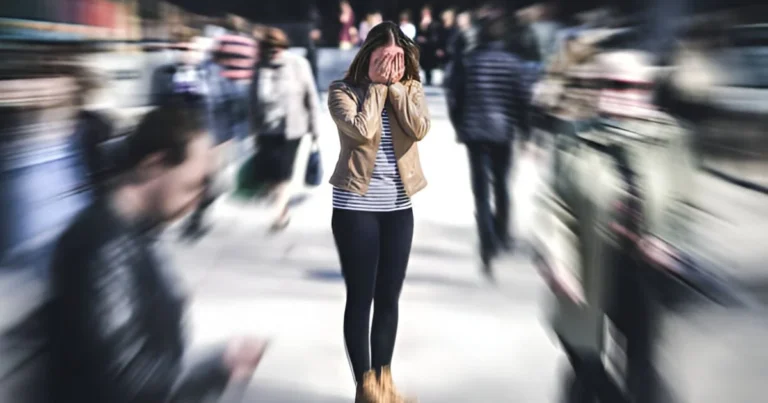Peut-on penser sans les mots ?
Nous croyons tous que penser, c’est parler dans notre tête. Mais est-ce vraiment le cas ? Imaginez un monde sans mots. Pourrions-nous raisonner, anticiper, résoudre des problèmes ? Certains l’affirment : sans langage, pas de pensée complexe. Nos idées seraient alors limitées à des sensations vagues et des images floues. Pourtant, des preuves scientifiques et des témoignages bousculent cette vision. Des personnes sourdes de naissance, n’ayant jamais appris de langue, développent des formes de pensée élaborées. Les bébés réfléchissent avant de parler. Des génies comme Einstein disaient penser en images plutôt qu’en mots.
Alors, le langage est-il un simple outil de parole, ou l’architecte de notre pensée ? Peut-on vraiment concevoir sans mots ? Plongeons ensemble dans cette fascinante énigme cognitive.
Le langage et la pensée : Une question philosophique et historique
Depuis des siècles, philosophes et linguistes se disputent la relation entre langage et pensée. Le langage est-il un simple outil servant à exprimer des idées préexistantes, ou bien est-il la structure même de la pensée ?
Dans l’Antiquité, Platon considère que les idées existent indépendamment du langage, dans un monde des formes accessible par la raison. Aristote, plus pragmatique, voit dans le langage un moyen naturel d’exprimer la pensée, mais pas son fondement. Au XVIIe siècle, Descartes renforce cette vision : pour lui, la pensée est une propriété de l’âme, et le langage ne fait que la manifester. En revanche, Hobbes et Locke soutiennent que les mots façonnent nos idées, donnant au langage un rôle essentiel dans la structuration du raisonnement.
Au XIXe siècle, la linguistique prend le relais. Wilhelm von Humboldt développe l’idée que chaque langue façonne une vision du monde spécifique. Cette intuition est reprise par Edward Sapir et Benjamin Whorf, qui avancent que la structure linguistique influence la perception et la pensée, une thèse connue sous le nom de relativité linguistique.
Ferdinand de Saussure : Le langage structure-t-il la pensée ?
C’est dans ce contexte que Ferdinand de Saussure, au début du XXe siècle, révolutionne la linguistique en proposant une approche totalement nouvelle du langage. Plutôt que de considérer les mots comme de simples étiquettes posées sur des idées préexistantes, il introduit la notion de signe linguistique, composé de deux éléments indissociables :
- Le signifiant (le son ou le mot écrit).
- Le signifié (le concept mental qu’il évoque).
Cette relation est arbitraire et dépend uniquement des conventions établies par une communauté linguistique. Pour Saussure, la pensée brute est une masse informe, chaotique, sans structure claire. Ce n’est qu’à travers le langage que cette pensée peut s’organiser et devenir intelligible. Le langage ne se contente donc pas de traduire des idées préexistantes : il les modèle, les segmente et les organise. En ce sens, la langue impose une structure cognitive qui façonne notre perception du réel.
Par exemple, certaines langues divisent les couleurs différemment, ce qui influence la manière dont leurs locuteurs les perçoivent. D’autres distinguent grammaticalement des concepts comme le temps ou le genre, ce qui oriente la pensée de ceux qui les parlent.
Jacques Lacan : Le langage précède le sujet
Cette conception influence profondément Jacques Lacan, qui transpose ces principes en psychanalyse. Il reprend l’idée que le langage structure la pensée, mais va encore plus loin en affirmant que le langage précède même le sujet. Selon lui, l’individu ne devient un être pensant qu’en intégrant le Symbolique, ce registre du langage structuré qui définit les lois, les règles sociales et le système des signifiants par lequel nous donnons du sens au monde. C’est en entrant dans ce réseau de signifiants que l’enfant accède à la pensée structurée et au statut de sujet. Apprendre à parler ne se résume donc pas à nommer les choses : c’est une inscription psychique, une manière d’organiser son rapport à soi et aux autres.
Mais cette construction de l’identité passe aussi par l’Imaginaire, un autre registre fondamental de Lacan. L’exemple du stade du miroir illustre ce processus : avant même de parler, l’enfant se reconnaît dans son reflet, formant une image idéalisée et unifiée de lui-même. Pourtant, cette image est trompeuse : elle est le fruit d’une construction, une illusion qui ne prend tout son sens qu’en étant validée par le langage et par l’Autre (les parents, la société).
Enfin, il existe un registre que le langage ne peut totalement saisir : le Réel, ce qui échappe aux mots et à la symbolisation. Le Réel représente ce qui ne peut être pleinement exprimé, ce qui résiste au langage et revient parfois sous forme de trauma ou d’angoisse. C’est la limite de toute pensée linguistique : tout ne peut être dit, tout ne peut être pensé en mots.
Ainsi, pour Lacan, la pensée, la conscience de soi et même l’inconscient sont structurés comme un langage, inscrits dans le réseau du Symbolique, influencés par l’Imaginaire et confrontés aux impasses du Réel. Le langage n’est donc pas un simple outil d’expression, mais une condition préalable à l’existence du sujet et à sa pensée. Dès lors, une question demeure : penser sans langage est-il seulement envisageable, ou bien toute pensée est-elle irrémédiablement prise dans les mailles du langage ?
La position de Noam Chomsky sur le lien entre langage et pensée
Noam Chomsky, linguiste et philosophe majeur du XXe siècle, adopte une approche distincte dans ce débat. Contrairement aux théories relativistes (comme l’hypothèse de Sapir-Whorf), il défend l’idée que le langage et la pensée sont liés, mais que la pensée peut exister indépendamment du langage verbal.
Chomsky est célèbre pour sa théorie de la grammaire générative, selon laquelle les humains naissent avec une capacité innée à acquérir le langage. Cette idée repose sur l’existence d’un dispositif d’acquisition du langage (Language Acquisition Device – LAD), qui permet aux enfants d’apprendre n’importe quelle langue à partir d’un nombre limité d’exemples.
Pour lui, le langage est une structure propre à l’esprit humain, mais il n’est pas nécessairement la seule forme de pensée. Il distingue deux niveaux dans la relation entre langage et pensée :
La pensée profonde et abstraite, qui pourrait exister indépendamment du langage verbal. Il suggère qu’il existe une forme de « langage de la pensée » (mentalese), une structure cognitive interne qui précède l’expression verbale.
Le langage comme outil d’expression, qui permet de traduire ces pensées en mots mais ne les crée pas forcément.
Dans une interview, il affirme : « On peut très bien penser sans langage. La pensée est bien plus vaste que le langage. Il y a énormément de choses que l’on ne peut pas dire avec des mots. »
Dans sa réflexion, Chomsky s’inscrit dans la lignée de Descartes et du rationalisme, soutenant que la pensée peut exister indépendamment des mots. Contrairement aux théories de Saussure ou de Whorf, il ne considère pas le langage comme un cadre déterminant absolu de la pensée, mais plutôt comme un outil facilitant son expression.
Pour lui, les humains possèdent une forme de pensée abstraite indépendante du langage, et le langage n’est qu’un des moyens d’exprimer cette pensée. Ainsi, il apporte une vision nuancée : Oui, le langage joue un rôle fondamental dans la communication et l’organisation des idées. Mais, la pensée n’est pas réductible aux mots : elle peut exister sous forme d’intuitions, d’images mentales ou de structures conceptuelles non verbales. En somme, pour Chomsky, les mots sont des fenêtres sur la pensée, mais la pensée ne s’arrête pas aux mots.
Deux grandes visions opposées
Ainsi, deux grandes visions s’opposent dans l’histoire de la philosophie et de la linguistique :
La tradition rationaliste et essentialiste (Platon, Descartes, Chomsky) : La pensée existe indépendamment du langage, qui n’en est qu’un outil. Et la tradition linguistique et structuraliste (Saussure, Lacan, Whorf) : Le langage est la matrice même de la pensée, il structure notre cognition et façonne notre perception du monde.
Cette tension est au cœur des débats contemporains : peut-on réellement penser sans langage, ou toute forme de pensée repose-t-elle sur une structure linguistique, même inconsciente ? Nous explorerons ces deux courants dans la suite de notre réflexion.
Penser sans mots : une réalité cognitive ?
Le langage est souvent considéré comme le support fondamental de la pensée. Pourtant, certaines formes de raisonnement semblent exister indépendamment des mots. Peut-on alors penser sans langage, ou s’agit-il simplement d’une illusion cognitive ?
Pensée visuelle et imagerie mentale
Certaines personnes rapportent une pensée en images plutôt qu’en mots. Temple Grandin, spécialiste du comportement animal et autiste, affirme concevoir ses idées sous forme de films mentaux détaillés. Plutôt que d’utiliser un raisonnement verbal, elle manipule des images, les assemble et les teste mentalement. Albert Einstein expliquait lui aussi que ses découvertes scientifiques naissaient d’expériences de pensée visuelles bien avant d’être traduites en équations ou en mots. Ces témoignages suggèrent qu’une partie de la cognition pourrait fonctionner indépendamment du langage, via des représentations mentales non verbales.
Les bébés et la pensée en prélangage
Des recherches récentes ont démontré que les nourrissons possèdent des capacités cognitives complexes avant même l’acquisition du langage. Par exemple, une étude menée par Monica Barbir et ses collègues au sein du Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique (LSCP) a révélé que les bébés de 20 mois peuvent apprendre de nouvelles règles grammaticales en quelques minutes et les utiliser immédiatement pour acquérir de nouveaux mots. Cette découverte suggère que les nourrissons exploitent des indices grammaticaux pour faciliter l’apprentissage du vocabulaire, indiquant une forme de raisonnement précoce indépendante du langage verbal.
Ces résultats renforcent l’idée que la pensée préverbale est non seulement possible, mais qu’elle joue un rôle crucial dans le développement cognitif des enfants. Avant même de maîtriser le langage, les nourrissons démontrent une capacité à analyser et à interpréter des structures complexes, ce qui constitue une forme de pensée indépendante des mots.
Les aphasiques et la pensée sans langage
L’étude sur les aphasiques et la pensée sans langage montre que, même lorsque la capacité à parler ou comprendre des mots est gravement altérée, certaines formes de raisonnement et de cognition restent intactes.
Lors d’une expérience, des chercheurs ont soumis des patients aphasiques (souffrant d’une perte sévère du langage après un AVC ou une lésion cérébrale) à des tests qui ne nécessitent aucun recours aux mots. Par exemple :
- Tests de raisonnement visuel : les patients devaient compléter des suites logiques d’images ou identifier des motifs récurrents sans utiliser le langage.
- Reproduction de formes et d’objets : ils devaient recopier ou organiser des images selon une logique précise.
- Tâches de planification : on leur demandait d’organiser des actions dans le bon ordre (exemple : illustrer comment faire du café à l’aide d’images).
Dans les résultats, les patients aphasiques ont souvent réussi ces tâches avec un niveau de performance proche de celui de personnes non aphasiques. Cela prouve que leur capacité à raisonner, organiser des informations et prendre des décisions n’est pas forcément altérée par la perte du langage.
Ce type d’étude remet en question l’idée selon laquelle le langage est indispensable à la pensée. Il montre que certaines fonctions cognitives, comme la perception, la mémoire ou la logique visuelle, peuvent opérer indépendamment des mots.
Les sourds de naissance : un cas de pensée sans langage ?
Certaines personnes sourdes de naissance développent spontanément un système gestuel personnel pour communiquer. Ces individus, appelés « home signers » (signants domestiques), créent des structures gestuelles organisées sans avoir appris une langue des signes officielle. Ils offrent un cas particulier pour comprendre si la pensée peut exister indépendamment du langage. En l’absence d’un système linguistique structuré, comment organisent-ils leur réflexion et expriment-ils leurs idées ?
Des recherches menées sur les « home signers », montrent que ces individus développent spontanément des systèmes gestuels pour communiquer. Ces gestes, bien qu’individuels et non appris auprès d’une communauté linguistique, suivent néanmoins des règles structurées. Par exemple, les home signers utilisent des gestes répétitifs et combinés pour exprimer des concepts abstraits ou complexes. Dans certaines études, ils ont été capables de représenter des actions, des objets et des relations spatiales avec des signes distincts et cohérents, même si leur « langue » n’a pas de grammaire formalisée comme la langue des signes des communautés sourdes.
Les observations montrent que, même sans une langue conventionnelle, ces individus possèdent une pensée organisée et structurée. Ils sont capables de :
- Planifier des actions et résoudre des problèmes concrets.
- Exprimer des intentions et des émotions par leurs gestes.
- Développer des concepts abstraits comme le temps ou la causalité.
Toutefois, ces systèmes gestuels semblent plus limités que les langues conventionnelles. Sans une syntaxe pleinement développée, les home signers peuvent avoir du mal à exprimer des idées complexes, notamment celles nécessitant des structures grammaticales élaborées.
Dans le débat langage-pensée, ce cas renforce l’idée que le langage formel n’est pas absolument nécessaire à la pensée, puisque ces individus raisonnent, communiquent et s’organisent malgré l’absence d’une langue standardisée. Cependant, leur cognition semble aussi influencée par l’absence d’un système linguistique élaboré, suggérant que le langage enrichit et affine la pensée plutôt qu’il ne la crée de toutes pièces.
Mais le langage façonne-t-il tout de même notre pensée ?
Face à ces résultats, certains chercheurs contestent l’idée que la pensée puisse réellement être indépendante du langage. Selon eux, même lorsque nous traitons des images, des formes ou des concepts abstraits, notre cerveau les assimile en interne sous forme verbale.
- Les mots organisent et affinent la pensée : bien que nous puissions percevoir un objet sans le nommer, dès qu’il s’agit de s’en souvenir ou d’y réfléchir, nous avons tendance à le transformer en concept verbal.
- Le dialogue interne : la plupart des adultes entretiennent un dialogue mental permanent avec eux-mêmes, structurant ainsi leur raisonnement à l’aide du langage.
- Les études sur la mémoire : certaines recherches montrent que les personnes mémorisent mieux des éléments lorsqu’elles peuvent les nommer. Cela suggère que le langage joue un rôle clé dans l’organisation des souvenirs et des concepts abstraits.
Par ailleurs, certaines erreurs de perception semblent liées au langage : des expériences ont montré que lorsque des personnes n’ont pas de mot spécifique pour une distinction (comme une couleur ou une nuance), elles la perçoivent avec moins de précision. Cela appuie l’idée que la langue influence non seulement la pensée, mais aussi notre perception du monde.
Si la pensée sans mots est possible, elle semble cependant limitée dans ses capacités abstraites. Le langage permet de conceptualiser des idées complexes, de structurer un raisonnement logique et de partager des pensées avec autrui.
Ainsi, plutôt que d’opposer ces deux visions, il semble que la pensée soit hybride : certaines formes de raisonnement peuvent émerger sans mots, mais le langage est un outil puissant qui affine et enrichit nos idées. Nous pouvons donc peut-être penser sans langage… mais pas de la même manière.
Une pensée hybride : Interaction entre langage et cognition
Le débat entre langage et pensée ne se résume pas à une opposition tranchée entre deux camps. Plutôt que d’être une condition absolue de la pensée, le langage pourrait jouer un rôle d’amplificateur et d’organisateur, facilitant la structuration et la transmission des idées plutôt que leur émergence même.
Les moines en méditation profonde
Les témoignages de méditants avancés illustrent un cas fascinant de pensée sans langage. Lors d’états méditatifs profonds, certains moines bouddhistes décrivent une conscience claire et lucide, totalement dissociée des mots. Leur expérience ne se limite pas à une absence de langage intérieur, mais à un état de vigilance mentale où des intuitions surgissent sous forme de ressentis, d’images ou de prises de conscience immédiates.
Des recherches en neurosciences ont exploré les effets de la méditation sur l’activité cérébrale chez des moines bouddhistes tibétains pratiquant la méditation depuis des décennies. Ces études ont révélé des modifications significatives dans le fonctionnement du cerveau pendant les états méditatifs profonds.
Par exemple, une étude menée par le neuroscientifique Richard Davidson de l’Université du Wisconsin a comparé l’activité cérébrale de méditants novices à celle de moines expérimentés ayant accumulé plus de 10 000 heures de pratique. Les participants ont été invités à pratiquer une méditation de « compassion », visant à générer un sentiment d’amour bienveillant envers tous les êtres. Les résultats ont montré que les moines présentaient une augmentation spectaculaire de l’activité des ondes gamma, un type d’onde cérébrale associé à des processus mentaux supérieurs tels que la conscience et l’attention. Cette activité gamma était nettement plus prononcée chez les moines que chez les novices, suggérant que l’entraînement mental intensif peut entraîner des changements significatifs dans le cerveau.
De plus, l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) a révélé une activation accrue du cortex préfrontal gauche, une région du cerveau associée à la gestion des émotions positives et au bien-être, ainsi qu’une diminution de l’activité dans les zones impliquées dans le langage et l’orientation spatiale. Ces observations suggèrent que, pendant la méditation profonde, la cognition peut être active tout en étant dissociée des structures verbales habituelles.
Ces découvertes soulèvent des questions sur la nature de la pensée et son rapport au langage. Elles suggèrent que certaines formes de cognition, notamment celles développées par une pratique méditative intense, peuvent se manifester sans recours au langage, remettant en question l’idée que le langage est indispensable à toutes les formes de raisonnement abstrait.
Ces recherches ouvrent la voie à une compréhension plus nuancée de l’interaction entre langage et pensée, en montrant que le cerveau humain est capable de modes de fonctionnement variés, certains indépendants des structures linguistiques.
Les neurosciences et la psychologie cognitive montrent que certaines tâches (comme le raisonnement logique ou la catégorisation) sont facilitées par le langage, tandis que d’autres (perception, intuition, émotions) peuvent s’en affranchir. Ainsi, plutôt que d’être mutuellement exclusifs, langage et pensée semblent entretenir une relation dynamique, où le premier façonne et enrichit le second sans être sa condition absolue.
Si le langage façonne incontestablement certaines formes de pensée, il n’en est pas l’unique moteur. Il est une structure qui ordonne, affine et transmet nos idées, mais il ne détient pas le monopole du raisonnement. De la pensée visuelle aux intuitions fulgurantes, des émotions profondes aux décisions prises sans mots, l’esprit humain explore des territoires qui échappent aux phrases et aux signes. Les bébés, les aphasiques, les méditants ou encore les animaux démontrent qu’une forme de cognition existe en dehors du langage. Nous pouvons donc penser sans mots, mais cette pensée suit sans doute des chemins différents, moins linéaires, plus diffuse et pourtant bien réels.
Références
Barbir, M., Babineau, M. J., Fiévet, A.-C., & Christophe, A. (2023). Rapid infant learning of syntactic-semantic links. Proceedings of the National Academy of Sciences, 120(1), e2209153119.
Chomsky, N. (1957). Syntactic Structures. The Hague: Mouton.
Grandin, T. (2006). Thinking in Pictures: My Life with Autism (Expanded ed.). New York, NY: Vintage Books.
Locke, J. (1690). An Essay Concerning Human Understanding. London: Thomas Bassett.
Lutz, A., Brefczynski-Lewis, J., Johnstone, T., & Davidson, R. J. (2008). Regulation of the Neural Circuitry of Emotion by Compassion Meditation: Effects of Meditative Expertise. PLoS ONE, 3(3),e1897.
Piaget, J. (1923). Le langage et la pensée chez l’enfant [The Language and Thought of the Child]. Neuchâtel: Delachaux et Niestlé.
Porch, B. E. (1973). Porch Index of Communicative Ability. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
Saussure, F. de. (1916). Cours de linguistique générale [Course in General Linguistics]. Lausanne: Payot.
Vygotsky, L. S. (1934). Myshlenie i rech’ [Thought and Language]. Moscow: Gosudarstvennoe social’no-ekonomičeskoe izdatel’stvo.
Whorf, B. L. (1956). Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf. J. B. Carroll (Ed.). Cambridge, MA: MIT Press.

Amine Lahhab
Réalisateur
Master en Réalisation- Ecole Supérieur de l'AudioVisuel (ESAV), Université de Toulouse.
License en Histoire- Université Hassan 2 de Casablanca.
DEUG en Philosophie- Université Hassan 2 de Casablanca.