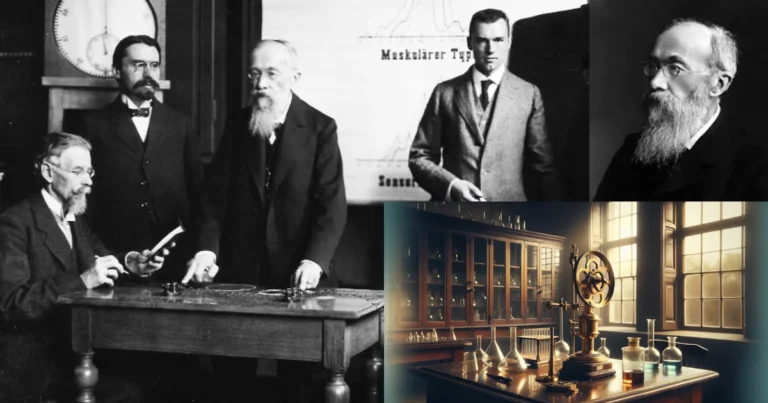Mon ami le livre : Mon rempart contre la solitude
« Quand je pense à tous les livres qu’il me reste à lire, j’ai la certitude d’être encore heureux. »
– Jules Renard
Il y a, dans cette simple pensée, quelque chose d’universel. Le bonheur suspendu à des pages encore inconnues, la promesse que, malgré le silence ou l’absence, il existe toujours un ailleurs où l’on peut se rendre, sans bouger. Face à la solitude, certains cherchent la foule, d’autres préfèrent la compagnie silencieuse des livres. Le livre demeure ce refuge espéré, cet ami qui attend, fidèle, à portée de main.
Il arrive que le silence s’y immisce, sans raison particulière. La solitude s’installe, simplement, comme une part de la vie. Dans ces instants, ouvrir un livre devient un geste facile, presque évident. En lisant, on rejoint ceux qui, avant nous, ont traversé des moments semblables. Leurs mots nous accompagnent, sans bruit, et rendent ce temps plus présent, plus vivant.
Alors, pourquoi ne pas s’accorder ce moment ? Celui de retrouver un livre, de s’asseoir en sa compagnie, ne serait-ce que pour quelques pages. Il n’en faut parfois pas plus pour que la solitude devienne plus douce, pour que le silence se remplisse d’une présence tranquille. Un livre ouvert, c’est déjà une main tendue, une amitié brève peut-être, mais qui marque pour toujours.
Solitude : malheur ou choix ? Une condition humaine complexe
La solitude. Ce mot résonne souvent comme un écho vide, un espace déserté, presque inquiétant. Dans notre monde hyperconnecté, être seul paraît presque anormal, comme si l’absence de contacts immédiats équivalait à une défaillance sociale. Pourtant, la solitude est une condition humaine universelle, aussi ancienne que la pensée elle-même.
Dans la solitude, il y a celle qui se subit : l’isolement affectif après une rupture, la marginalisation, le vide relationnel. Celle-là, elle blesse, elle pèse, elle fait peur.
Mais il y a aussi celle qui se choisit, parfois instinctivement, parfois consciemment, comme un retrait volontaire pour se ressourcer, réfléchir, ou simplement exister autrement, hors du tumulte.
Et pour certains, cette inclination vers la solitude fait partie intégrante de leur nature. Ils ne la recherchent pas par fuite ou par souffrance, mais parce qu’ils y trouvent une forme d’harmonie. Aimer être seul n’a rien de maladif : c’est parfois simplement un mode d’être, une préférence intime pour la compagnie de soi-même, loin des distractions extérieures.
Les philosophes, de Montaigne à Nietzsche, ont souvent vu dans la solitude un lieu de vérité intérieure. « Il faut s’arracher à la foule », disait Sénèque, « et retrouver la paix. » Cette paix, ce calme, c’est ce que certains appellent solitude féconde.
Les recherches modernes confirment cette dualité : une étude menée par Nguyen, Ryan et Deci (2018) montre que la solitude n’est pas nécessairement une expérience négative. En fait, lorsqu’elle est choisie, elle agit comme un régulateur émotionnel : elle atténue les émotions intenses, qu’elles soient joyeuses ou angoissantes, et conduit souvent à un état de relaxation profonde. Ce n’est pas le fait d’être seul qui compte, mais comment on vit cette solitude.
La lecture, entre compagnonnage intime et partage silencieux
Lire, ce n’est pas seulement tourner des pages, c’est habiter un espace, intérieur et vaste à la fois. Pour certains, cet espace devient une échappatoire, un monde où la solitude change de visage.
On pense souvent que la lecture est un acte isolé, mais elle est aussi relationnelle. Relation à soi, aux autres à travers les mots, et parfois même, dans certaines circonstances, à une communauté silencieuse de lecteurs.
Dans des contextes de grande vulnérabilité, cette puissance relationnelle de la lecture a été mise en lumière. Des ateliers de lecture théâtralisée organisés pour des personnes âgées ont permis, au fil des semaines, de rompre doucement l’isolement. Lire à voix haute, incarner un personnage, écouter les autres, tout cela a fait naître une nouvelle forme de présence. Ces moments, bien que simples, ont transformé une solitude pesante en un partage discret, où chaque livre devenait un prétexte pour se relier. Une étude récente a montré que ces lectures partagées ont réduit significativement le sentiment de solitude chez ces participants, comme si les mots avaient tissé des liens invisibles mais solides.
Mais la lecture ne se vit pas toujours dans l’échange. Elle peut aussi être une compagnie solitaire, choisie, assumée. L’écrivain Jean d’Ormesson en parlait souvent, lui qui, jeune, passait de longues heures seul dans les bibliothèques ou à l’étranger, loin des siens. Les livres étaient ses confidents, ses compagnons de route. Il disait souvent : « Les livres m’ont appris à ne jamais être vraiment seul. »
Pour lui, lire n’était pas une fuite, mais une joie discrète, un art d’être seul sans l’être vraiment, la lecture le mettait en dialogue constant avec le monde, passé et présent. Ainsi, ce moment passé entre les pages devient un pont, tantôt vers les autres, tantôt vers soi.
La solitude féconde : les écrivains face au vertige intérieur
La solitude, pour les écrivains, n’est pas un luxe. Elle est souvent une nécessité rude, un face-à-face avec soi-même que rien ne vient adoucir, sinon la lecture. Non pas une lecture passive, mais une plongée, une confrontation. Lire, pour eux, c’est accepter de traverser des mondes que l’on ne contrôle pas, regarder en face ses propres failles, et celles que les récits mettent au jour.
Marcel Proust, enfermé dans sa chambre, vivait cette tension. La solitude lui pesait, autant qu’elle lui était vitale. Il écrivait souvent la nuit, en proie à des douleurs physiques, mais aussi à une intensité émotionnelle que seule la lecture venait parfois apaiser. Lire lui permettait de capter l’éclat des choses invisibles, d’écouter le bruissement du monde qu’on ne perçoit qu’en silence. Il ne cherchait pas la solitude, il s’y abandonnait, parce qu’elle était le seul lieu où la mémoire pouvait surgir, intacte. C’est par les livres qu’il a su prolonger ces instants fugitifs, les ancrer dans la durée.
Pour Proust, la lecture transcendait la simple distraction, elle reflétait une présence fidèle dans ces heures d’isolement, une amitié silencieuse qu’il revendiquait sans fard : « La lecture est une amitié. »
Cette amitié lui était primordiale, elle lui offrait l’élan nécessaire pour découvrir des recoins de son esprit que la solitude, laissée sans repère, rendait parfois difficiles à atteindre.
Le livre, pour lui, n’était pas là pour remplacer les autres, mais pour permettre une forme de voyage intérieur que la compagnie humaine ne pouvait offrir, « Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. »
Lire, c’est exercer un autre regard, porté à la fois sur soi-même et sur ce que les autres ont su exprimer par leurs mots. Dans la solitude, cette lecture devient un instrument délicat : elle révèle ce que l’on ignore encore, elle éclaire le silence, non pour le briser, mais pour lui donner sens.
Et parfois, la solitude ne révèle pas un moi unifié, mais fait surgir des identités multiples, des regards éclatés sur le monde. Fernando Pessoa, poète portugais du début du XXe siècle, a vécu cette expérience jusqu’au vertige.
Pessoa était l’un des plus grands explorateurs de l’âme humaine, et l’un des plus fidèles compagnons de la solitude. Dans ses écrits, il ne parle pas d’une seule voix. Pessoa invente ce qu’il appelle des hétéronymes, des auteurs imaginaires, dont chacun est doté d’une biographie, d’un style et d’une vision du monde qui lui était propre. Ce ne sont pas de simples masques, mais des existences parallèles, qu’il nourrissait avec autant de soin que la sienne. Peut-être était-ce là, pour lui, une manière de combler le silence, de peupler sa solitude avec des âmes complices qu’il faisait naître de lui-même.
Pour Fernando Pessoa, la solitude était plus qu’un état, c’était un destin. Il n’en fuyait pas les tourments, il les écrivait, il les lisait. Il se nourrissait de cette absence de repères, de ce flottement existentiel qu’il traduisait en poèmes. Lire, pour lui, c’était aussi dialoguer avec ses multiples « moi », ces figures intérieures qui peuplaient son esprit. Sa solitude n’était pas paisible, elle était peuplée de doutes, mais il avait trouvé dans les livres un terrain où ces incertitudes pouvaient exister sans honte.
Ainsi, la solitude n’a pas un seul visage, pour certains, elle est un espace fragile, chargé de silences qu’il faut apprivoiser, pour d’autres, elle est mouvement, agitation intérieure et succession de visages et de pensées qu’il faut comprendre et parfois contenir.
Mais dans ces deux chemins, aussi opposés qu’intimes, la lecture demeure un acte courageux : celui de rencontrer ce que l’on porte en soi, qu’il s’agisse de souvenirs oubliés ou de voix encore inconnues.
Et si ces écrivains ont su trouver dans les livres une manière d’habiter leur solitude, c’est peut-être parce qu’ils ont compris que lire, c’est toujours accepter d’entrer dans un espace incertain, un espace où l’on n’est jamais tout à fait seul, ni tout à fait le même.
Repenser la solitude : lecture, bien-être et perception
La solitude, dans sa forme brute, n’épargne personne. Elle s’impose parfois comme un fardeau, un vide que rien ne comble. Mais elle n’est pas figée. Ce que nous en faisons, ce que nous en pensons, peut changer l’expérience elle-même. Apprendre à voir autrement, voilà ce que la lecture propose. Non pas nier l’absence, mais l’habiter autrement.
On sait aujourd’hui, grâce à certaines études, que notre perception de la solitude peut évoluer, et avec elle, les émotions qui en découlent. Une étude menée par Rodriguez, Pratt, Bellet et McNally (2023) a démontré que lorsqu’on réapprend à envisager la solitude comme une expérience bénéfique, celle-ci devient plus supportable, parfois même source de sérénité. Les participants qui avaient été exposés aux bienfaits de la solitude ressentaient moins d’émotions négatives, et plus de calme intérieur, même dans un contexte d’isolement.
La lecture joue ici un rôle subtil mais fondamental. En s’immergeant dans un livre, on se détache du regard social sur la solitude, on cesse de la vivre comme un stigmate. Le silence n’est plus perçu comme un manque, mais comme une disponibilité. Chaque page tournée est une preuve que l’on peut trouver du sens dans le retrait, que le vide apparent cache un espace de possibles.
Il ne faut pas craindre la solitude. Nombreux sont ceux qui, un livre à la main, ont su la traverser, la comprendre, et en ressortir grandis. La lecture n’est pas une échappatoire, mais une force. Elle donne des mots à ce que l’on ressent, elle offre des horizons quand tout semble se refermer. Ceux qui lisent apprennent à faire face, car chaque lecture aiguise le regard, le tourne vers ce qui éclaire et fortifie. Chaque page lue est une preuve que la solitude peut être tenue, apprivoisée, et parfois même, aimée. Ouvrir un livre, c’est se donner les moyens de rester debout, même lorsque le monde se retire. C’est entrer dans ce dialogue silencieux d’où l’on ressort, sinon changé, du moins plus entier.
Jamais un livre ne remplira la place d’un autre, il occupe seulement la sienne, discrète et fidèle. Il offre une présence constante, celle d’un ami silencieux que l’on retrouve toujours, sans conditions.
Cette amitié ne se mesure pas en mots échangés, mais en chemins parcourus ensemble. Lire, c’est avancer aux côtés d’un compagnon qui connaît le silence, qui le partage, et qui, à chaque page, vous tend la main.
Il n’y a pas de solitude là où les livres veillent.
Références
Cantisano, N., et al. (2024). Effect of dramatised reading workshops on older people with neurocognitive disorders. Sommet mondial des innovations sociales. https://univ-tlse2.hal.science/hal-04718617/
Nguyen, T., Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2018). Solitude as an approach to affective self-regulation. Personality and Social Psychology Bulletin, 44(1), 92–106.
Rodriguez, M., Pratt, S., Bellet, B. W., & McNally, R. J. (2023). Solitude can be good—If you see it as such: Reappraisal helps lonely people experience solitude more positively. Journal of Personality.
Sun, H., & Schafer, M. H. (2022). Cognitively engaging solitary activities: Another layer of protection against loneliness. Innovation in Aging, 6(Suppl_1), 231–232.

Amine Lahhab
Réalisateur
Master en Réalisation- Ecole Supérieur de l'AudioVisuel (ESAV), Université de Toulouse.
License en Histoire- Université Hassan 2 de Casablanca.
DEUG en Philosophie- Université Hassan 2 de Casablanca.