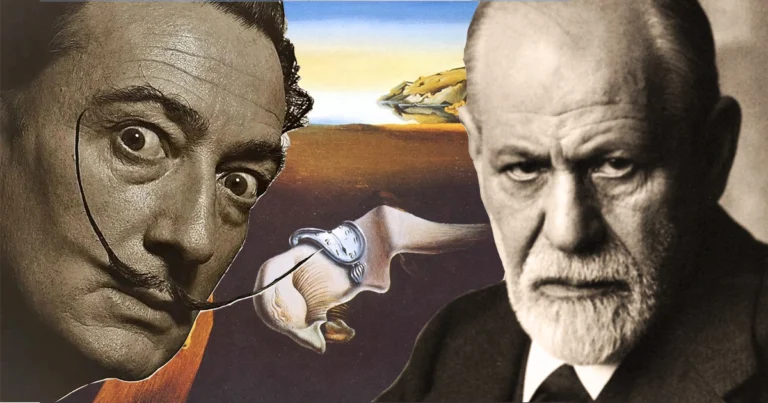Columbo : « Juste une dernière chose… »
Il arrive toujours un en retard, l’air distrait, froissant son vieux manteau beige comme on froisse une habitude. Ses cheveux sont en bataille, sa cravate de travers, et il promène une silhouette fatiguée dans une Peugeot 403 cabossée qui tousse à chaque virage. Il ne dégaine pas d’arme, mais un carnet froissé, un cigare mal éteint, et une avalanche de questions apparemment banales. Rien chez lui n’impressionne : ni le style, ni la prestance, ni le ton. Et pourtant, face à lui, les meurtriers les plus brillants vacillent. Car sous cet imperméable tourmenté se cache une logique implacable, une perspicacité infaillible.
Il s’appelle Columbo. Et il n’a jamais l’air de savoir… jusqu’à ce qu’il sache tout.
Une révolution tranquille : Columbo, la série qui a renversé les codes
Quand Columbo apparaît pour la première fois à la télévision américaine, en 1968, rien ne semble le prédestiner à un succès planétaire. Ni son rythme lent, ni son esthétique modeste, ni même son détective principal — à mille lieues des archétypes virils et flamboyants du petit écran. Et pourtant, l’effet est immédiat. La série séduit par ce qu’elle refuse : pas de poursuites en voiture, pas d’armes à feu, pas de cliffhangers haletants. À la place, un jeu d’esprit, une lente progression, une tension discrète. Une forme d’élégance à contretemps.
Le plus étonnant, c’est que Columbo renverse l’ordre même du récit policier. Dans chaque épisode, le spectateur connaît d’emblée le coupable. Le suspense ne repose plus sur la question du “qui”, mais sur celle du “comment”. Comment ce petit homme, visiblement dépassé, va-t-il réussir à coincer un meurtrier sûr de son intelligence ? Ce basculement narratif est une audace rare à l’époque. Le public, habitué à deviner le coupable, devient complice d’une autre forme de plaisir : assister, presque en douce, à la chute progressive d’un ego criminel.
L’effet Columbo repose aussi sur une écriture fine et une mise en scène rigoureuse. Un jeune Steven Spielberg, encore inconnu, réalise un épisode en 1971 (Murder by the Book), et en sortira transformé. “J’ai appris à filmer sans bruit”, dira-t-il plus tard. Cette économie du spectaculaire, cette maîtrise du silence et du détail, deviendra sa signature — bien avant les requins géants ou les dinosaures numériques.
Le personnage de Columbo, incarné avec génie par Peter Falk, n’était pas censé devenir une icône. Falk, borgne et fumeur invétéré, a d’ailleurs dû se battre pour imposer l’image négligée du détective : l’imperméable froissé, le cigare mâchonné, le chien amorphe, la vieille Peugeot 403 cabossée… Tout cela semblait “anti-télévisuel”. Trop banal. Trop gris. Et pourtant, c’est cette banalité même qui crée le trouble. Car derrière l’homme distrait, toujours au bord de s’excuser, se cache un esprit redoutable.
Chaque épisode devient une variation sur le même thème : un criminel élégant, riche, sûr de lui, face à un inspecteur modeste et obstiné, qui pose des questions trop simples pour être anodines. Et lentement, presque imperceptiblement, le château de cartes s’effondre.
Ce succès ne repose donc pas sur l’action, mais sur l’intelligence, la patience et la parole. Une forme d’enquête qui tient plus du dialogue que de la traque, plus du face-à-face que de la confrontation. Et c’est précisément là que le parallèle s’impose : Columbo n’est pas qu’un détective. Il est aussi, à sa manière, un philosophe en civil. Une figure discrète, presque archaïque, qui interroge sans jamais accuser, qui doute sans feindre, qui détricote la vérité avec une douceur implacable. Et cette posture, si singulière, rappelle une autre silhouette célèbre de l’histoire de la pensée : Socrate.
Un corps à contre-emploi : Columbo, le Socrate de Los Angeles
Il y a des corps qui inspirent la confiance, d’autres qui imposent le respect. Celui de Columbo fait douter. Rien dans sa silhouette ne laisse présager la moindre autorité : il marche en traînant les pieds, l’air perpétuellement fatigué, le dos légèrement voûté, les poches pleines de papiers froissés. Il semble chercher ses mots comme il chercherait ses clés. Même son imperméable, usé jusqu’à l’absurde, donne l’impression qu’il n’appartient à personne. Ou plutôt, à quelqu’un qu’on ne remarque jamais. Et pourtant, tout cela est d’une redoutable efficacité.
Columbo n’est pas simplement négligé : il est inesthétique par choix. Son allure devient une arme paradoxale — une forme de camouflage social. Ce décalage assumé entre l’apparence et la lucidité rappelle, sans surprise, celui de Socrate. Le philosophe grec, lui aussi, avançait masqué : petit, au ventre proéminent, au nez écrasé, souvent tourné en dérision, il ne ressemblait en rien à un maître de sagesse. Et pourtant, sous cette enveloppe triviale, logeait une pensée d’une acuité implacable.
Chez Columbo comme chez Socrate, le corps joue un rôle stratégique. Il détourne l’attention, efface toute prétention. Il permet d’approcher l’autre sans provoquer de résistance. Car qui se méfierait d’un homme qui s’excuse sans cesse, qui oublie son carnet de notes, qui s’embrouille dans les horaires et qui semble plus préoccupé par les croquettes de son chien que par le meurtre commis ? Cette posture d’effacement, presque d’humilité maladroite, n’est pas une faiblesse : c’est un leurre. Et il fonctionne.
Le contraste entre l’apparence de Columbo et celle de ses adversaires est frappant. Le criminel est souvent élégant, sûr de lui, parfois célèbre, toujours bien habillé. Il incarne le succès social, la réussite extérieure. Columbo, lui, semble appartenir à un autre monde. Un monde où l’apparence n’a pas d’importance. Où seuls comptent les faits, les contradictions, les silences, les détails qu’on oublie trop vite. Il n’entre pas dans la pièce pour affirmer sa présence, mais pour écouter, observer, se faire oublier. Jusqu’au moment où tout bascule.
Cette posture du retrait, cette manière de ne pas imposer son savoir, de laisser l’autre s’exposer, c’est aussi celle de Socrate. Lui aussi était moqué pour son apparence, pour sa manière de parler, pour ses questions trop simples. Mais il savait où il allait. Il menait l’entretien comme on mène une enquête : pas à pas, en creusant doucement, jusqu’à faire surgir ce que l’autre aurait préféré taire.
Columbo, comme Socrate, ne cherche pas à convaincre par la force. Il ne s’impose pas. Il se glisse dans la faille, dans l’espace oublié entre deux certitudes. Et il y plante sa question. Toujours posée avec douceur. Toujours formulée comme une hésitation. Mais toujours dévastatrice.
Une méthode d’enquête socratique : poser, douter, dévoiler
Columbo ne cherche jamais à piéger. Il interroge, il doute, il revient — encore et encore. Sa méthode repose sur l’art de faire parler, pas de faire taire. Il écoute, il note, il semble s’égarer… puis pose une question de plus, presque par politesse. Et c’est là que tout commence à vaciller. Derrière cette stratégie discrète se cache une tradition ancienne, celle de Socrate, qui menait ses dialogues comme une enquête — non pas pour affirmer, mais pour dévoiler. Les philosophes grecs appelaient cela l’elenchos : une méthode de réfutation par le dialogue, où l’on pousse l’autre à se contredire en le suivant dans son propre raisonnement.
Socrate ne contestait pas frontalement. Il posait une première question, anodine. Puis une deuxième, un peu plus précise. Puis une autre, encore, jusqu’à ce que surgisse une contradiction entre ce que son interlocuteur pensait croire… et ce qu’il venait lui-même d’admettre. Cette dissonance, cette fissure logique, était le moment clé. Non pas pour humilier, mais pour libérer : une fois la certitude ébranlée, la pensée pouvait enfin bouger. Columbo agit de la même manière. Il ne dit jamais : « vous mentez », mais : « il y a juste un petit détail qui me chiffonne… » Et de détail en détail, le récit se délite. Ce n’est pas une démonstration, c’est une érosion.
Mais l’elenchos n’est que la moitié du chemin. Car une fois les failles exposées, reste à faire surgir quelque chose de plus juste. C’est là qu’intervient la maïeutique, l’autre pilier de la méthode socratique — littéralement, « l’art d’accoucher », en référence au métier de sage-femme. Socrate, dont la mère était accoucheuse, disait faire naître les idées, non les imposer. Et c’est ce que Columbo permet aussi : il ne fait pas avouer, il fait admettre. Il laisse au suspect le soin de dire ce qu’il a tenté de cacher. L’interrogatoire devient alors un espace de vérité, non une scène de domination. Ni violence, ni intimidation. Seulement un dialogue — tenace, patient, implacable.
Une éthique sans éclat : Columbo et Socrate, figures d’une justice intérieure
Columbo ne lève jamais la voix. Il ne brandit ni insigne, ni menace. Il ne frappe pas à la porte pour s’imposer, mais pour entrer doucement, comme un invité mal à l’aise. Et pourtant, il obtient toujours ce qu’il cherche : la vérité. Non pas par ruse, mais par conviction. Car ce qui anime Columbo n’est pas la victoire, ni le prestige, mais une forme de fidélité silencieuse à la justice. Une droiture qui ne se dit pas, mais se vit — et qui, là encore, le rapproche de Socrate.
Socrate, lui aussi, n’avait ni grade, ni pouvoir. Il n’était ni juge, ni prêtre, ni maître. Il se contentait de poser des questions, de marcher dans la ville, de parler avec ceux qu’il croisait. Mais il ne fléchissait jamais devant l’injustice. Il allait jusqu’au bout, jusqu’au procès, jusqu’à la condamnation, sans jamais renier sa démarche. Comme Columbo, il dérangeait les puissants, non par provocation, mais par constance. Et comme lui, il plaçait l’éthique au-dessus de la réputation.
Ce qui frappe chez ces deux figures, c’est leur refus du cynisme. Ils savent que le monde est tordu, que la vérité est souvent maquillée, que les coupables sont parfois charmants. Mais ils ne se résignent pas. Ils avancent, un pas après l’autre, sans haine, sans arrogance. Leurs adversaires sont souvent arrogants, sûrs de leur supériorité sociale ou intellectuelle. Mais ni Socrate ni Columbo ne se laissent intimider. La vérité, pour eux, ne dépend ni du statut ni du costume. Elle émerge dans l’écart, dans la dissonance, dans ce moment fragile où le masque se fend.
Juste une dernière chose… Socrate est mort pour ses questions ; Columbo, lui, vit à travers elles. Mais l’un était un homme, l’autre une figure de fiction. Et cette différence change tout. Là où Socrate affrontait la cité et payait de sa vie sa fidélité au vrai, Columbo évolue dans un monde écrit pour qu’il gagne. Pourtant, quelque chose les relie profondément : cette foi inébranlable dans le pouvoir du dialogue, dans la lenteur du doute, dans l’humble persévérance de celui qui cherche. Columbo n’égale pas Socrate — il en est l’écho tranquille, transposé dans un autre langage. Une manière de nous rappeler que, même dans la fiction, la vérité continue de marcher en civil, discrète, tenace… et qu’elle commence souvent par une simple question.
Références
McBride, J. (2010). Steven Spielberg: A Biography. University Press of Mississippi.
Harrington, W (1996). Columbo: The Game Show Killer. Forge, January 1, 1996
Platon. (1993). Théétète (L. Brisson, Trad.). GF Flammarion. (Œuvre originale écrite au IVe siècle av. J.-C.)
Vlastos, G. (1983). The Socratic Elenchus. Oxford Studies in Ancient Philosophy, 1, 27–58.

Amine Lahhab
Réalisateur
Master en Réalisation- Ecole Supérieur de l'AudioVisuel (ESAV), Université de Toulouse.
License en Histoire- Université Hassan 2 de Casablanca.
DEUG en Philosophie- Université Hassan 2 de Casablanca.