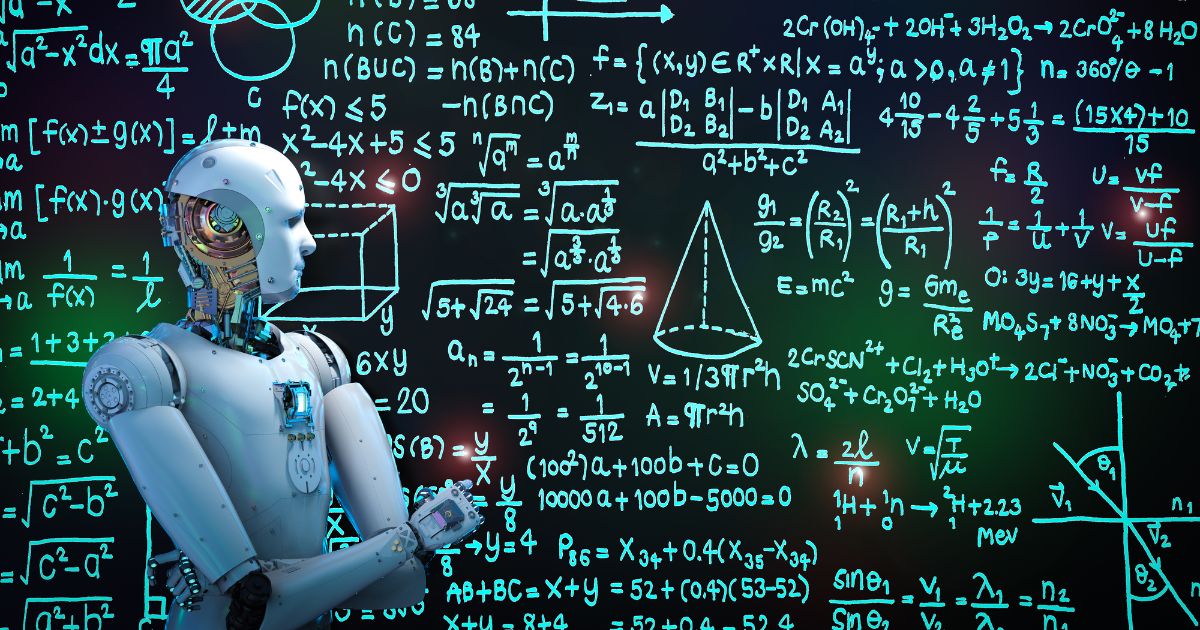Apprendre à l’ère des robots : Le pari risqué de ChatGPT chez les ados
“L’intelligence artificielle ne menace pas l’intelligence humaine. Elle l’invite à se redéfinir.”
Depuis novembre 2022, les adolescents et les jeunes adultes ont trouvé un nouvel interlocuteur, une présence numérique inépuisable, réactive, pédagogique et parfois même rassurante : ChatGPT. À la maison, en classe, dans les transports, à la bibliothèque ou dans le secret de leur chambre, ils le consultent pour rédiger, corriger, résumer, comprendre, planifier, traduire. L’intelligence artificielle conversationnelle est entrée dans le champ éducatif sans frapper, mais avec une efficacité fulgurante.
L’école, l’université, les devoirs et même les examens ne sont plus ce qu’ils étaient. Car l’humain, désormais, pense aveclA machine. Mais dans cette fusion cognitive en marche, qu’advient-il des mécanismes traditionnels d’apprentissage ? Comment l’usage intensif de ChatGPT transforme-t-il les processus neurocognitifs, les dynamiques psychologiques et la construction identitaire de l’élève en développement ? Quelle place reste-t-il au corps, au mouvement, à l’écriture manuscrite, à la lenteur, à l’effort, à l’ennui même, ces éléments si fondamentaux à toute maturation psychomotrice et intellectuelle ?
🔗 À lire aussi : Grandir par le mouvement : La psychomotricité comme socle éducatif
ChatGPT comme figure symbolique : Le nouvel Autre
Dans la perspective développementale (Erikson, 1950 ; Piaget, 1972), l’adolescence est un moment de crise identitaire où l’individu cherche à affirmer sa singularité tout en se confrontant à l’autorité et aux modèles. Dans ce contexte, ChatGPT devient une figure paradoxale : un “autre” omniscient, mais non jugeant, un adulte virtuel sans regard, sans émotion, sans limite.
Cette désintermédiation (plus besoin de professeur, de parent ou de livre) produit un effet de sécurité narcissique, où l’élève n’est plus exposé à l’échec social. Il peut demander, rater, corriger, reposer une question sans honte. Cela favorise une relation d’apprentissage déculpabilisée, ce qui est bénéfique pour les élèves anxieux ou inhibés. Il retrouve alors une forme d’autonomie guidée.
Mais cette autonomie est conditionnée : elle repose sur un tiers externe qui pense, rédige, structure, explique à sa place. La question est alors : est-ce que l’adolescent apprend, ou est-ce qu’il accède à du savoir déjà penser ?
Beaucoup d’adolescents n’utilisent pas ChatGPT pour apprendre, mais pour produire. Il devient une fabrique à performances scolaires. L’objectif n’est plus de comprendre une notion, mais de rendre un devoir bien écrit. Or, selon Vygotski (1934), l’apprentissage est un processus dialectique, nourri d’interactions sociales, d’erreurs, de conflits cognitifs et de médiations. Si ChatGPT remplace cette médiation humaine, il court-circuite l’apprentissage réel.
🔗 Découvrez également : Quand l’échec tue
Quand le cerveau délègue : Fonctions exécutives en veille, cognition en péril
L’usage régulier de ChatGPT modifie le profil cognitif fonctionnel de l’élève. Les fonctions exécutives — planification, mémoire de travail, flexibilité mentale, inhibition, monitoring — sont de moins en moins sollicitées.
- La mémoire de travail est soulagée : ChatGPT “tient” l’information, reformule à volonté, permet de revenir en arrière. Mais selon Baddeley (2000), la mémoire de travail est un système central de la cognition : elle soutient la compréhension, la résolution de problèmes, le raisonnement. Moins on l’entraîne, plus elle s’affaiblit.
- La planification est aussi externalisée. L’élève n’a plus à organiser sa pensée, faire des brouillons, construire un plan. Il délègue cette charge à la machine.
- La métacognition (conscience de ses propres processus mentaux) est alors réduite.
- L’inhibition, fonction clé du cortex préfrontal, est impactée : l’IA donne une réponse rapide, fluide, valorisante. Le cerveau adolescent, hypersensible à la récompense immédiate (Steinberg, 2005), est tenté de zapper les étapes intermédiaires pour accéder directement au résultat.
Ce phénomène rejoint ce que certains appellent la cognition déléguée (Norman, 1993) : une externalisation des processus mentaux vers des outils techniques. Cela n’est pas nouveau (l’écriture, la calculatrice, Google en sont des exemples), mais ici, la fluidité conversationnelle de l’IA masque la complexité du processus cognitif. L’élève a l’illusion de comprendre ce qu’il ne fait que paraphraser.
Les neurosciences cognitives montrent que le cerveau adolescent est dans une phase de restructuration synaptique majeure. L’usage intensif d’outils numériques, et notamment interactifs comme ChatGPT, modifie :
- La connectivité fronto-pariétale, essentielle dans les tâches de raisonnement logique et de résolution de problèmes ;
- Le réseau du mode par défaut, impliqué dans la pensée réflexive, la mémoire autobiographique et la planification future. Moins utilisé au profit de circuits de réponse-récompense ;
- La plasticité dopaminergique, accrue par la gratification immédiate (réponses instantanées, reformulations illimitées), ce qui altère la tolérance à la frustration et le temps de latence cognitive.
On peut parler d’un changement écologique du cerveau : celui-ci n’est plus habitué à construire patiemment une idée, à rester en suspens, à travailler l’erreur. Il devient un cerveau de l’interaction rapide, de l’anticipation guidée, de la paraphrase intelligente. Un cerveau économe, mais potentiellement fragilisé en l’absence de guide intérieur.
🔗 À lire aussi : Quand la pensée remplace le clavier
La désincarnation du savoir
La psychomotricité rappelle que tout apprentissage passe par une inscription corporelle. Or, l’usage de ChatGPT — via un clavier, une interface, un écran — engage très peu les systèmes sensorimoteurs. Il déconnecte le savoir de l’acte :
- L’écriture manuscrite, par exemple, active de nombreuses aires cérébrales : moteur (aire prémotrice), visuo-spatiale (lobe pariétal), et langagière (aire de Broca). Elle implique un enchaînement rythmique, tonique et symbolique. En la remplaçant par la frappe, on perd une dimension corporelle du langage.
- Le temps corporel de l’apprentissage (regard soutenu, rythme respiratoire, pause posturale, mouvement de la main) est réduit à un cliquetis de doigts.
- L’élève est statique : position assise prolongée, absence de mouvement, fatigue oculaire, crispation des poignets. L’apprentissage devient un acte décorporé, ce qui diminue l’intégration multisensorielle des savoirs.
La psychomotricité insiste sur le fait que le savoir n’est pas qu’intellectuel, il est vécu. Apprendre, c’est aussi ressentir, toucher, bouger, écrire, rater, se redresser. L’usage exclusif de ChatGPT réduit l’apprentissage à une série de représentations désincarnées, sans vécu corporel.
🔗 À lire aussi : La science des mots : Ce que les neurones de la lecture nous dévoilent
ChatGPT ne signe pas la fin de l’apprentissage, mais il exige une refondation de nos manières de penser, d’enseigner, d’accompagner. Utilisé intelligemment, il peut devenir un partenaire cognitif puissant, un amplificateur de curiosité, un miroir de pensée. Mais cela suppose de maintenir une part d’effort et de doute dans le processus éducatif ; préserver la place du corps et du geste dans l’acte d’apprendre ; enseigner la métacognition et la critique, pour éviter que la pensée soit déléguée sans conscience.
Il ne s’agit pas de rejeter l’outil, mais de l’intégrer dans une pédagogie neuro-écologique, où l’humain reste au centre, et l’intelligence artificielle à la périphérie — comme soutien, non comme substitut.
« Ce n’est pas tant que l’IA nous vole notre intelligence. C’est que, parfois, nous lui offrons sans résistance. »
Références
Matei, S. A. (2013). The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains, by Nicholas Carr. New York, NY: W. W. Norton, 2010. 276 pp.
Gee, J. P. (2007). What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. New York: Palgrave Macmillan.
Giedd, J. N. (2004). Structural magnetic resonance imaging of the adolescent brain. Annals of the New York Academy of Sciences, 1021, 77–85.
Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. Boston: Center for Curriculum Redesign
Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). Intelligence Unleashed: An argument for AI in Education. Pearson Education.
Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions. Cognitive Psychology, 41(1), 49–100.
Norman, D. A. (1993). Things That Make Us Smart: Defending Human Attributes in the Age of the Machine. Addison-Wesley.
Ophir, E., Nass, C., & Wagner, A. D. (2009). Cognitive control in media multitaskers. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(37), 15583–15587.
Selwyn, N. (2019). Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education. Polity Press.
Steinberg, L. (2005). Cognitive and affective development in adolescence. Trends in Cognitive Sciences, 9(2), 69–74.
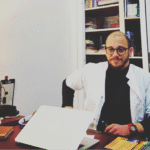
Saad Chraibi
Psychomotricien
• Diplômé de l’Université Mohammed VI à Casablanca, exerçant en libéral dans son propre cabinet à Casablanca (Maroc).
• Adopte une approche globale et intégrative, prenant en compte les dimensions corporelle, psychique, émotionnelle et relationnelle de la personne.
• Ancien étudiant en médecine (4 années), disposant d’une solide formation biomédicale et d’une rigueur clinique intégrée à sa pratique psychomotrice.
• Expérience professionnelle diversifiée : structures associatives, exercice libéral, travail interdisciplinaire avec orthophonistes, psychologues, neuropsychologues.
• Spécialisé dans l’adaptation des prises en charge à des profils variés, avec une forte orientation vers le travail en réseau.
• Investi dans des projets thérapeutiques personnalisés, fondés sur des évaluations précises et respectueux du rythme, de l’histoire et du potentiel de chaque patient, quel que soit son âge.