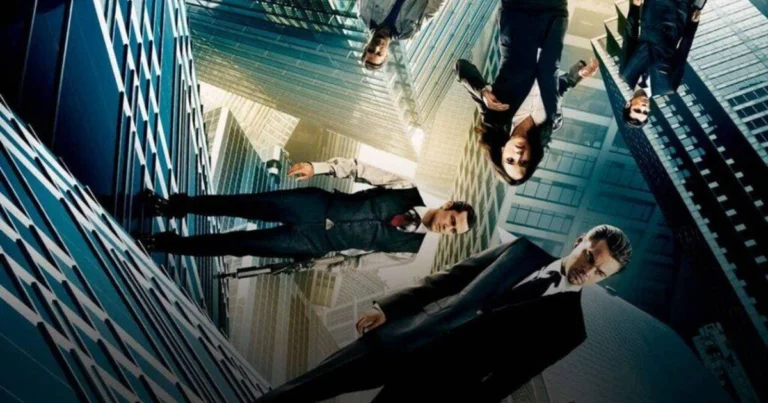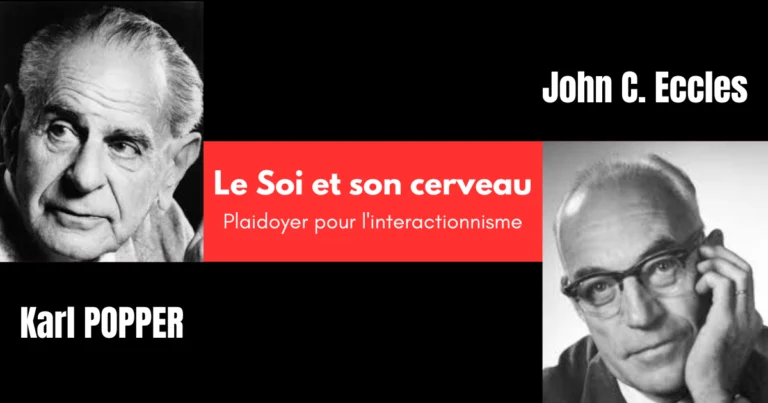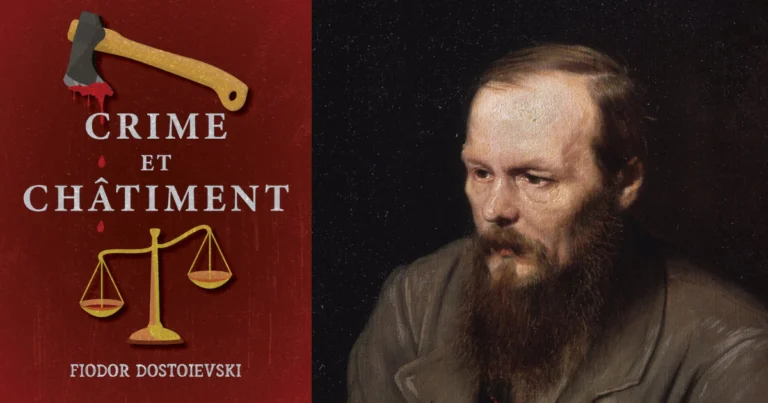Blasphemous : Une traversée clinique du sacré mutilé
Blasphemous, développé par « The Game Kitchen », est bien plus qu’un jeu vidéo de type metroidvania : c’est un ex-voto numérique, une fresque baroque et crépusculaire, une descente clinique dans les abîmes de la psyché humaine. Son univers gothique, inspiré par l’iconographie religieuse de l’Espagne inquisitoriale, offre un théâtre saisissant de la souffrance ritualisée. L’on y incarne « Le Pénitent », silhouette silencieuse à la tête coiffée d’un capuchon de fer rappelant à la fois les flagellants médiévaux et les figures sacrificielles.
Mais derrière les pics ensanglantés, les prières distordues et les monstres suppliciés, Blasphemous se donne à voir comme une métaphore interactive de la douleur psychique, de la mémoire traumatique, du corps réprimé. C’est un langage symbolique, un rêve éveillé au service d’une narration post-traumatique où le geste, la chair et l’affect ne cessent de dialoguer. En cela, il se prête à une analyse croisée entre psychopathologie, psychomotricité et symbolique sacrée.
La psyché crucifiée, entre trauma et culpabilité archaïque
Dès les premières minutes, le joueur est confronté à un univers saturé d’images de souffrance : statues mutilées, anges déchus, prêtres fous, enfants mort-nés. L’univers de Custodia n’est pas simplement hostile, il est en deuil. Le joueur ne reçoit aucune explication directe. Il progresse dans un monde où la narration se murmure à travers des fragments cryptés, des reliques à décrypter, des prières corrompues. Cette fragmentation narrative est à l’image de la fragmentation psychique post-traumatique.
Le monde de Custodia fonctionne comme une trace mnésique fossilisée. Rien ne change vraiment. Tout se répète. Le sang sèche mais ne disparaît pas. Chaque niveau agit comme un flash-back visuel et sonore. Les cloches, les gémissements, les voix éthérées rappellent les symptômes de reviviscence traumatique : le joueur revit, encore et encore, une chute originelle dont il ignore parfois la cause. Le Pénitent est mutique. Il ne ressent rien. Il agit sans affect apparent, comme s’il avait couvert ses émotions d’une armurerituelle. Il est le survivant dissocié, dont le mouvement n’est plus expression mais protection. On peut y voir une figure typique du traumatisme complexe : un corps en action pour ne pas s’effondrer.
Dans la logique du jeu, la souffrance n’est pas une conséquence, elle est un devoir. Le monde n’est pas à sauver mais à purifier par la douleur. C’est ici que se déploie une psychodynamique mélancolique, où l’individu internalise une faute originelle (souvent sans objet clair) qu’il tente de réparer sans fin. On entre dans une logique sacrificielle, proche de celle décrite par Freud dans le masochisme moral : le sujet trouve dans l’autopunition la seule forme de paix possible.
Corps brisé, gestes figés, une clinique psychomotrice du sacré
Sur le plan psychomoteur, Blasphemous constitue un support d’une rare richesse pour penser le rapport au corps, à l’espace, au geste et au tonus dans des contextes de douleur, de rigidité ou de répression. Le corps du Pénitent est constamment contraint, entravé, ritualisé. Il ne court pas : il avance avec une lourdeur cérémonielle. Il ne frappe pas : il exécute un geste sacrificiel.
Le gameplay impose des mouvements précis, codifiés, parfois lents, comme s’ils étaient dictés par une loi extérieure (morale ? divine ? sociale ?). Le corps est en dette : chaque mouvement semble s’arracher à une immobilité douloureuse, comme dans certains tableaux cliniques d’inhibition psychomotrice (états dépressifs sévères, inhibition névrotique, tensions post-traumatiques).
De nombreuses figures rencontrées dans le jeu sont mutilées, hybrides, sans membres ou avec des organes hypertrophiés. Ces représentations évoquent des angoisses primitives de morcellement, connues dans la clinique des psychoses et des troubles du schéma corporel. Le corps n’est plus unifié : il est dispersé, exhibé, sacrifié. Certains ennemis ou personnages secondaires présentent des mouvements anormaux, des postures figées ou désorganisées, des gestes parasites. Cela peut faire écho à des manifestations cliniques observées dans des troubles neurologiques ou dans des pathologies du tonus : spasmes, raideurs, hypertonie émotionnelle.
Le gameplay incite à la répétition. Refaire un même passage, recommencer, échouer, persister. Le joueur répète les mêmes séquences motrices, comme un mantra psychomoteur. Ce temps suspendu, ritualisé, peut rappeler certains cadres thérapeutiques où la motricité répétée (via le jeu symbolique, le modelage, le dessin) permet de réintégrer le corps et d’apaiser la tension interne.
Le Pénitent n’est jamais récompensé. Plus il souffre, plus il progresse. C’est une foi sans salut, qui rappelle certaines configurations psychiques de soumission perverse à une autorité toute-puissante, où le sujet renonce à tout désir propre pour s’annihiler dans la volonté supposée de l’Autre (parent, société…).
Le plaisir semble absent du monde de Blasphemous… ou plutôt, il est déplacé vers la douleur. Ce que Lacan appelle la jouissance s’incarne ici dans le sang, le sacrifice, la perte. La chair est brûlée pour être sanctifiée. C’est une logique où le corps est à la fois objet d’offrande et outil de pénitence. De plus, plusieurs personnages féminins dans le jeu incarnent des maternités empêchées, mortifères ou sacrificielles. On y lit une figuration symbolique du maternel dévasté, thème central dans de nombreuses pathologies du lien précoce. La femme n’est plus source de vie mais de dette, de culpabilité, de silence.
Le jeu vidéo comme outil projectif et clinique
En tant que médium, Blasphemous devient un support projectif puissant. Il parle au corps autant qu’à l’inconscient, aux affects autant qu’à l’intellect. En cela, il peut être mobilisé dans une approche thérapeutique ou éducative :
- Surface d’identification pour des patients en souffrance : Le Pénitent est une figure à laquelle peuvent s’identifier des sujets marqués par le silence, la honte, l’exclusion ou la douleur chronique. Il devient un avatar de leurs propres vécus.
- Support à médiation corporelle : Travailler sur les gestes du Pénitent, leur lenteur, leur raideur, leur beauté tragique, permet d’ouvrir un espace de parole autour du ressenti corporel, de la douleur, du geste empêché. En psychomotricité, ce jeu pourrait servir de point de départ à des explorations corporelles ou expressives, à condition d’être accompagné.
- Langage symbolique pour explorer l’impensable : Enfin, les images oniriques, religieuses, déformées du jeu agissent comme un réservoir d’associations libres. Elles permettent d’aborder des thématiques taboues (la mort, la violence, la culpabilité) à travers un détour métaphorique.
Un purgatoire interactif, miroir du psychisme humain
Blasphemous n’est pas simplement un jeu, c’est une expérience rituelle, clinique et esthétique. Il mobilise les affects, les représentations, les tensions corporelles et les croyances archaïques du joueur pour créer une immersion dans la structure même de la souffrancehumaine. Il touche aux zones muettes du psychisme : là où le langage échoue, là où le corps parle, là où le symbole vacille.
C’est une œuvre qui questionne notre rapport au mal, à la douleur, à la foi, au corps et à la réparation. Un exutoire sacré pour les damnés modernes. Un pèlerinage vidéoludique au cœur de la psyché blessée. Et peut-être qu’au fond, Blasphemous ne se joue pas.
Il se confesse.
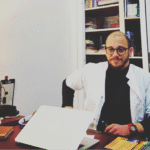
Saad Chraibi
Psychomotricien
• Diplômé de l’Université Mohammed VI à Casablanca, exerçant en libéral dans son propre cabinet à Casablanca (Maroc).
• Adopte une approche globale et intégrative, prenant en compte les dimensions corporelle, psychique, émotionnelle et relationnelle de la personne.
• Ancien étudiant en médecine (4 années), disposant d’une solide formation biomédicale et d’une rigueur clinique intégrée à sa pratique psychomotrice.
• Expérience professionnelle diversifiée : structures associatives, exercice libéral, travail interdisciplinaire avec orthophonistes, psychologues, neuropsychologues.
• Spécialisé dans l’adaptation des prises en charge à des profils variés, avec une forte orientation vers le travail en réseau.
• Investi dans des projets thérapeutiques personnalisés, fondés sur des évaluations précises et respectueux du rythme, de l’histoire et du potentiel de chaque patient, quel que soit son âge.