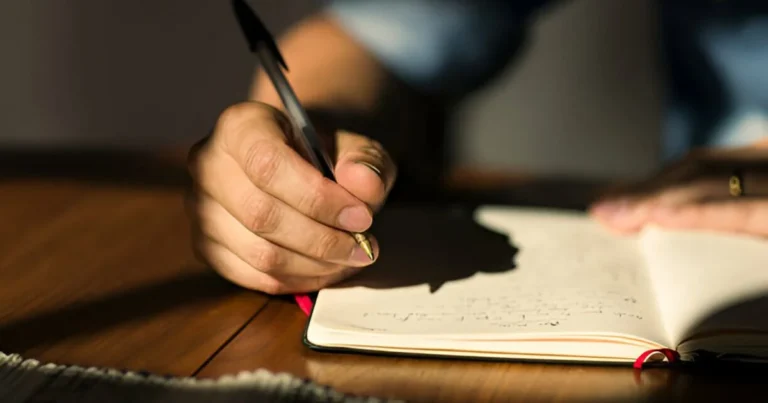Les échos du dedans : Quand l’imaginaire parle à voix haute
Chaque fois qu’il ferme les yeux, l’image de son père surgit. Un visage dur, figé dans la mémoire de l’enfance. Et avec lui, une voix sèche et violente. Pourtant, personne ne parle. Il est seul dans la pièce. Cette voix, il l’entend distinctement, elle insulte, accuse, répète des phrases qui semblent jaillir non du monde extérieur, mais de l’image mentale elle-même.
Ce type d’expérience n’est pas rare. Il s’agit d’un exemple typique d’hallucination auditive verbale (HAV), un phénomène dans lequel le cerveau traite une représentation interne comme s’il s’agissait d’une perception réelle. Cette confusion, entre une image issue de notre propre activité cognitive et une expérience sensorielle, constitue l’un des mécanismes les plus intrigants du fonctionnement cérébral. Longtemps considérées comme un signe distinctif des troubles psychotiques, les hallucinations auditives verbales sont aujourd’hui reconnues comme des expériences pouvant survenir dans des contextes bien plus larges. On les observe également chez des personnes souffrant de troubles anxieux, de stress post-traumatique ou de troubles de l’humeur, et même chez des individus sans aucun diagnostic psychiatrique. Cette diversité soulève de nouvelles questions sur leur origine et leur nature.
Depuis plusieurs années, la recherche s’efforce de comprendre ce qui pousse le cerveau à “entendre” ce qui n’a jamais été dit. Comment une image intérieure, un souvenir, une scène ou un visage, peut-elle se transformer en expérience auditive ? Pourquoi certaines personnes en font-elles l’expérience de manière répétée, parfois envahissante ? L’hypothèse qui émerge actuellement est que ces hallucinations ne sont pas simplement dues à un dysfonctionnement de la perception auditive, mais résultent d’une interaction plus complexe entre mémoire, émotion et imagerie mentale. Une revue systématique récente apporte un éclairage nouveau sur cette question, en distinguant clairement les rôles respectifs de l’imagerie émotionnelle et de l’imagerie neutre dans l’apparition de ces phénomènes auditifs.
🔗 À lire aussi : Le visage du sosie : L’énigme du syndrome de Capgras
Peut-on réellement entendre ce que l’on imagine ?
La question paraît étrange, presque paradoxale. Et pourtant, elle engage une hypothèse fondamentale. Certaines images mentales, en particulier lorsqu’elles sont fortement chargées émotionnellement, pourraient non seulement activer les circuits perceptifs du cerveau, mais aussi façonner des expériences auditives en l’absence de toute stimulation sonore réelle. C’est précisément ce lien qu’examine une étude récente menée par Janssen et ses collègues, publiée en 2024. Réalisée en collaboration entre les universités de Maastricht, Radboud et Oxford, cette recherche apporte des éléments clés pour mieux comprendre comment l’imagerie mentale émotionnelle peut contribuer à l’émergence des hallucinations auditives verbales.
Les résultats de l’analyse montrent clairement que les images mentales neutres, comme la simple visualisation d’objets ou de scènes sans contenu émotionnel particulier, ne sont pas associées à l’apparition d’hallucinations auditives verbales. En revanche, les images fortement chargées émotionnellement, souvent intrusives et liées à des souvenirs traumatiques ou à des représentations négatives de soi, jouent un rôle central. Près de 70 % des patients concernés déclarent avoir ce type d’imagerie mentale au moment où surviennent les hallucinations.
À l’inverse, certaines images mentales positives, lorsqu’elles sont évoquées de manière intentionnelle, semblent exercer un effet apaisant. Elles pourraient même contribuer à atténuer certains symptômes, en particulier ceux liés à la dépression. Ces résultats suggèrent que ce ne sont pas les images mentales en elles-mêmes qui favorisent l’émergence des hallucinations, mais bien leur charge émotionnelle, et surtout, la manière dont elles s’imposent à la conscience, souvent de façon involontaire et intrusive.
🔗 Découvrez également : Le cerveau piégé : Comment Mona Lisa crée l’illusion du vivant
Aux origines cérébrales des voix intérieures
Les hallucinations auditives verbales ne résultent pas d’une simple erreur sensorielle localisée. Elles émergent d’un déséquilibre fonctionnel au sein de plusieurs réseaux cérébraux qui, en interaction, assurent habituellement la distinction entre une pensée, une image mentale et une perception sensorielle réelle. Ce dérèglement touche notamment les systèmes liés à la mémoire, au langage, à l’émotion et au monitoring de la réalité. Au cœur de ce processus se trouve le gyrus temporal supérieur, une région du cortex auditif impliquée dans la reconnaissance des sons, de la parole et du langage. En temps normal, cette zone s’active en réponse à des stimuli externes (voix humaines, bruits, phonèmes). Mais dans le cadre des hallucinations, elle peut s’activer de façon autonome, en l’absence de toute stimulation auditive réelle. Cette activation spontanée suggère que le cerveau ne se contente pas de percevoir passivement, il peut aussi produire des contenus sensoriels de manière endogène.
Cependant, ce phénomène devient problématique lorsque le système chargé d’évaluer l’origine de ces contenus, en particulier le cortex préfrontal médian, présente des altérations de fonctionnement. Cette région est essentielle pour l’auto-surveillance cognitive et permet de juger si une information mentale provient de l’environnement ou a été générée en interne. Si ce mécanisme de « reconnaissance de la source » est affaibli, les images auditives issues de la mémoire, du langage intérieur ou de l’imagerie émotionnelle peuvent être prises pour des perceptions réelles. Autrement dit, le cerveau entend ce qu’il produit lui-même, mais sans en avoir conscience.
Ce déficit de monitoring de la source s’aggrave lorsque d’autres structures cérébrales, comme l’hippocampe ou l’amygdale, amplifient la charge émotionnelle des représentations mentales. Une image liée à un souvenir douloureux ou à une expérience marquante, réactivée dans un contexte de stress, de solitude ou de remémoration traumatique, gagne alors en intensité. Elle devient saillante, envahissante, jusqu’à franchir le seuil de la conscience perceptive.
🔗 À lire aussi : Le monde déformé : Le syndrome d’Alice au pays des merveilles
Dans ces conditions, elle ne se manifeste plus comme une simple pensée ou une évocation intérieure, mais prend la forme d’une voix, avec une texture sonore, un timbre distinct, parfois même une localisation spatiale. Le cerveau, ne disposant pas d’indices suffisants pour en reconnaître l’origine interne, traite alors cette image mentale comme s’il s’agissait d’un stimulus auditif réel, engageant les mêmes circuits neuronaux que ceux activés lors de l’audition.
Ce phénomène illustre une rupture dans le filtrage interne entre perception et imagination. Ce qui, chez la plupart des individus, reste contenu dans l’espace mental privé, dialogue intérieur, souvenirs sonores, scénarios anticipés, se transforme ici en événement perçu, irréductible au simple produit de l’imaginaire. Le cerveau ne distingue plus l’image mentale de la perception réelle : ce qu’il imagine, il le prend pour une expérience sensorielle. Ainsi, les voix hallucinées ne surgissent pas de nulle part ; elles s’élaborent à partir de matériaux internes, émotionnellement chargés, auxquels l’appareil perceptif attribue, à tort, une réalité objective. L’imagerie mentale devient alors réalité vécue, non pas par faiblesse perceptive, mais par excès de crédibilité accordée à ses propres constructions.
Ces mécanismes cérébraux révèlent une dynamique bien connue en psychologie : notre état émotionnel influence ce que nous percevons. Une personne traversant un épisode de stress intense, de culpabilité ou de solitude peut voir ses pensées internes se teinter d’images mentales plus vives, plus envahissantes, parfois verbales. Si ces images émotionnelles ne sont pas clairement reconnues comme telles, elles peuvent franchir un seuil où elles deviennent confondues avec des voix. La perception se construit alors à partir de l’intérieur, mais dans un format que le cerveau traite comme s’il provenait de l’extérieur.
Il convient toutefois de distinguer les hallucinations auditives verbales observées dans cette étude de celles typiquement rencontrées dans les troubles psychotiques chroniques, comme la schizophrénie. Dans le cadre transdiagnostique exploré par Janssen et ses collegues, les voix rapportées apparaissent le plus souvent de manière contextuelle, en lien avec une charge émotionnelle intense, un traumatisme non résolu ou un état de vulnérabilité affective. Elles sont généralement intermittentes, partiellement reconnues comme issues de l’activité mentale propre, et modulables par des interventions psychothérapeutiques ciblées. À l’inverse, les hallucinations psychotiques persistantes tendent à être plus rigides, fréquentes et intégrées dans un système délirant, avec une perte marquée de la capacité à en remettre en question l’origine.
Plutôt que de les interpréter systématiquement comme les marqueurs d’une rupture radicale avec la réalité, ces voix peuvent être envisagées comme le reflet d’un fonctionnement cérébral porté à son extrême, une forme d’activité mentale où les frontières entre l’interne et l’externe deviennent momentanément perméables. Elles peuvent ainsi résulter d’une interaction entre des capacités mentales tout à fait ordinaires (comme imaginer, se souvenir ou ressentir) et des circuits de régulation qui, momentanément, cessent d’assurer leur fonction de filtrage et de distinction entre l’interne et l’externe. En cela, les travaux récents contribuent à une déstigmatisation progressive des hallucinations auditives verbales, en particulier chez les personnes ne présentant pas de trouble psychotique. En les replaçant dans un cadre neuropsychologique compréhensible, ces recherches montrent qu’il ne s’agit pas nécessairement de manifestations irrationnelles ou insensées, mais d’expériences perceptives issues de mécanismes cognitifs et émotionnels identifiables.
Dans les contextes non psychotiques, cette distinction est essentielle pour concevoir des interventions qui ne visent plus à faire taire les voix par principe, mais à en explorer les origines internes, affectives et cognitives. Plutôt que de supprimer le symptôme, il s’agit de travailler sur les images mentales, les souvenirs émotionnels, les croyances associées, et les processus d’attribution erronée de la source. En modulant ces représentations internes, en réduisant leur vivacité, en altérant leur contenu émotionnel, ou en aidant la personne à les reconnaître comme issues d’elle-même, certaines voix peuvent perdre leur force persuasive ou leur caractère intrusif.
🔗 Découvrez également : Inception : Et si l’idée ne venait pas de vous ?
C’est à cette condition que la recherche pourra progresser vers des thérapies plus fines, adaptées aux mécanismes internes spécifiques à chaque cas clinique. Il ne s’agit plus de traiter les hallucinations comme des entités isolées, mais comme le reflet d’un déséquilibre dans l’organisation des représentations mentales. Ce miroir émotionnel dans lequel les voix prennent forme devient alors le véritable objet du soin, un espace malléable, traversé par des images issues de l’histoire personnelle du sujet, de ses vulnérabilités affectives, de ses stratégies de régulation. En s’adressant à cette dynamique sous-jacente, les interventions pourront viser non seulement une réduction des symptômes, mais aussi une meilleure compréhension et intégration de l’expérience vécue.
Référence
Janssen, H., van den Berg, K. C., Paulik, G., Newman-Taylor, K., Taylor, C. D. J., Steel, C., Keijsers, G. P. J., & Marcelis, M. C. (2024). Emotional and non-emotional mental imagery and auditory verbal hallucinations (hearing voices): A systematic review of imagery assessment tools. Clinical Psychology & Psychotherapy, 31(1), e2920.

Sara Lakehayli
Docteur en neuroscience cliniques et santé mentale, PhD
Membre associée au Laboratoire des Maladies du Système Nerveux, Neurosensorielles et du Handicap, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca.
Professeur à l'école supérieure de psychologie