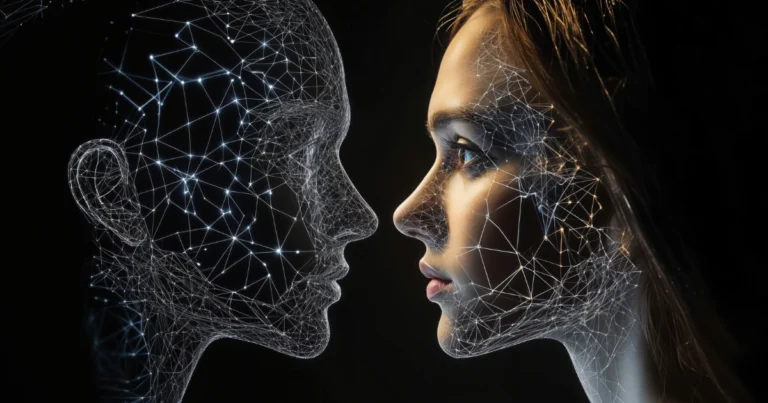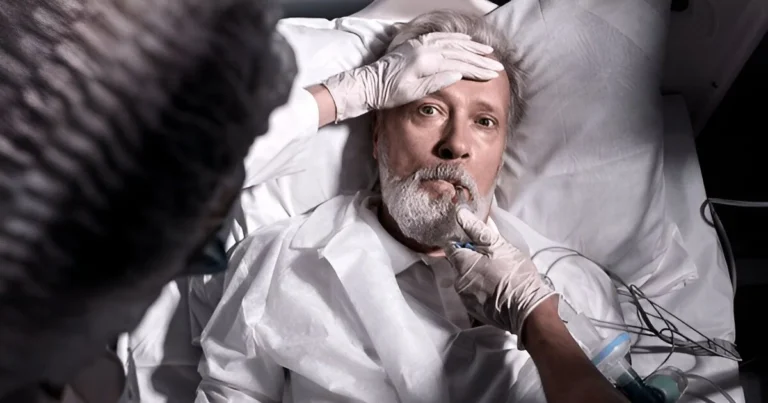Psychomotricité : L’histoire d’un corps en quête de sens
La psychomotricité est une discipline singulière qui articule le corps, la pensée, les émotions et la relation à l’autre. À la croisée des sciences médicales, humaines et de l’éducation, elle se situe dans un entre-deux fécond : celui du psychique et du corporel, de l’objectif et du subjectif. Cet article propose une relecture approfondie de l’histoire de la psychomotricité selon cinq prismes complémentaires — historique, psychomoteur, neurologique, psychologique et sociologique — afin de montrer comment cette discipline a émergé, évolué et s’est institutionnalisée, tout en restant fondamentalement transversale et humaine.
Prisme historique : De la philosophie antique à la reconnaissance institutionnelle
Les premières traces de pensée intégrant corps et esprit remontent à l’Antiquité. Platon, dans ses dialogues, évoque déjà l’idée que l’âme et le corps sont intimement liés, même si l’âme y est vue comme supérieure. Aristote, plus empiriste, développe une conception plus unifiée : le corps et l’âme forment une seule entité, une âme incarnée.
Cependant, au Moyen Âge puis à l’époque moderne, le dualisme cartésien (Descartes, XVIIe siècle) introduit une séparation radicale entre le corps (objet mesurable) et l’âme ou esprit (réalité immatérielle). Cette rupture freine pendant longtemps l’émergence d’une pensée holistique de l’être humain.
Le XIXe siècle constitue un tournant. Avec l’essor de la médecine expérimentale (Claude Bernard), la naissance de la neurologie (Charcot), de la psychiatrie (Pinel, Esquirol) et de l’éducation spécialisée (Édouard Séguin, Maria Montessori, Ovide Decroly), les chercheurs commencent à étudier les liens entre développement moteur, cognition et comportement. Ces travaux ouvrent la voie à une approche thérapeutique du mouvement, en lien avec les troubles du développement.
La Seconde Guerre mondiale marque une période cruciale. Les séquelles neurologiques et psychiques des soldats blessés (traumatismes crâniens, névroses de guerre) obligent les soignants à repenser la relation entre corps et psyché. En France, des figures comme Juliande Ajuriaguerra, Henri Wallon, André Bullinger ou Jean Bergès vont poser les premières pierres de la psychomotricité moderne, en intégrant des données neurodéveloppementales, psychodynamiques et pédagogiques.
La reconnaissance officielle de la profession de psychomotricien en 1974, avec la création du diplôme d’État en France, constitue une étape majeure de son institutionnalisation, qui se poursuit aujourd’hui avec la recherche universitaire, les pratiques cliniques et la formation professionnelle.
🔗 À lire aussi : Grandir par le mouvement : La psychomotricité comme socle éducatif
Prisme psychomoteur : Le corps vécu comme espace de médiation
La psychomotricité se fonde sur une idée centrale : le corps n’est pas un simple objet biologique, mais un corps vécu, porteur de sens, de mémoire, de relations. Il est à la fois support de l’identité et interface avec le monde.
Les concepts fondamentaux de la psychomotricité incluent :
- Le schéma corporel : représentation mentale que l’individu a de son propre corps.
- L’image du corps (Dolto) : manière subjective, affective et symbolique de se vivre dans son corps.
- Le tonus : niveau de tension musculaire, souvent en lien avec l’émotionnel.
- La latéralité, l’espace-temps, la rythmicité, la motricité fine et globale, etc.
Les médiations psychomotrices (relaxation, parcours moteurs, jeux sensoriels, expression corporelle, théâtralisation, etc.) visent une harmonisation psychocorporelle, où le geste devient symbolisation. L’enfant, par exemple, exprime souvent ses émotions et conflits à travers son corps avant même d’avoir accès au langage verbal.
La psychomotricité intervient donc à la fois dans une visée éducative, thérapeutique etpréventive, selon le contexte et les besoins du sujet.
Prisme neurologique : De la motricité au cerveau plastique
Sur le plan neurologique, la psychomotricité s’appuie sur les neurosciences développementales qui montrent que le cerveau est plastique, c’est-à-dire capable de se modifier en fonction de l’expérience.
Les mouvements volontaires, les ajustements posturaux, la coordination sensorimotrice sont rendus possibles par des circuits neuronaux complexes impliquant :
- Le cortex moteur et prémoteur.
- Le cervelet (coordination, régulation du mouvement).
- Les ganglions de la base.
- Le système vestibulaire (équilibre).
- Les aires associatives (intégration multisensorielle).
Des troubles comme la dyspraxie, les TSA, ou le TDAH relèvent souvent d’une altération dans cette organisation. La psychomotricité propose ici un accompagnement global, où la répétition du geste, dans un cadre signifiant, permet une réorganisation neuronale fonctionnelle.
Contrairement à la kinésithérapie, qui vise principalement la fonction motrice, ou à l’ergothérapie, qui vise l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne, la psychomotricité inclut l’émotion, la relation et le vécu corporel subjectif.
🔗 Découvrez également : Charcot, le maître des corps muets : Aux origines de la neurologie moderne
Prisme psychologique : Le corps porteur de conflits et de symboles
Le corps, en psychomotricité, est aussi un espace psychique. La psychanalyse (notamment Dolto, Anzieu, Winnicott), la psychologie du développement (Piaget, Wallon), et la psychologie clinique ont profondément influencé la pratique psychomotrice.
Les enfants, par exemple, vivent des conflits intrapsychiques qui peuvent s’exprimer corporellement : troubles de la coordination, inhibition, agitation, douleurs somatiques, etc. Le symptôme corporel devient alors une forme de langage.
La psychomotricité offre un cadre contenant, à travers le jeu corporel, les médiations symboliques, la parole accompagnée du geste, où les affects peuvent circuler et se transformer.
Chez l’adulte, notamment en cas de traumatisme, de maladie chronique, ou de troubles psychiatriques, le corps peut être vécu comme étranger, morcelé ou abandonné. Le travail psychomoteur permet alors une réappropriation de soi, une réconciliation avec son enveloppe corporelle, et un réinvestissement narcissique.
Prisme sociologique : Le corps face aux normes et aux exclusions
La psychomotricité interroge aussi les normes sociales, les représentations du corps et les formes d’exclusion. Dans nos sociétés contemporaines, valorisant la performance, l’efficacité, l’esthétique, certains corps sont mis à l’écart : les corps différents, handicapés, vieillissants, en souffrance.
La psychomotricité permet de redonner une voix au corps silencieux, de visibiliser l’invisible, de valoriser les potentialités expressives même chez des sujets lourdement atteints (polyhandicap, démence, autisme sévère…).
Elle s’inscrit dans une logique d’inclusion, d’humanité, et parfois même de résistance face à une société néolibérale qui instrumentalise le corps. Elle prend aussi en compte les contextesde vie : pauvreté, migration, violences, isolement, précarité.
De plus, les pratiques psychomotrices se déclinent en fonction du genre, de la culture, et des valeurs propres à chaque individu, ce qui implique une adaptation constante et une posture d’ouverture.
🔗 À lire aussi : Le magnétisme animal de Mesmer : Une esquisse vers l’inconscient
Une discipline en tension créative
La psychomotricité est une discipline carrefour, en constante évolution. Elle refuse les dichotomies simplistes (corps/esprit, soin/éducation, normal/pathologique) pour proposer une lecture complexe, intégrée et incarnée du sujet humain.
Dans un monde de plus en plus fragmenté, médicalisé et technicisé, la psychomotricité rappelle une chose essentielle : nous sommes des corps pensants, ressentant, et agissants. Elle œuvre pour une clinique du mouvement habité, du temps vécu, et de la subjectivité incarnée, dans une visée profondément humaniste.
Référénces
Anzieu, D. (1985). Le Moi-peau. Paris : Dunod.
Bullinger, A. (2004). Le développement sensori-moteur de l’enfant. Toulouse : Érès.
Le Breton, D. (2010). La sociologie du corps. Paris : Presses Universitaires de France.
Panksepp, J. (1998). Affective neuroscience: The foundations of human and animal emotions. New York, NY: Oxford University Press.
Varela, F. J. (1993). L’inscription corporelle de l’esprit: Sciences cognitives et expérience humaine. Paris : Seuil.
Wallon, H. (1942). De l’acte à la pensée. Paris : Flammarion.
Winnicott, D. W. (1971). Jeu et réalité : L’espace potentiel. Paris : Gallimard, 1975. (Éd. originale : Playing and Reality, 1971)
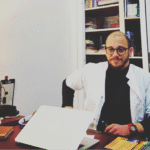
Saad Chraibi
Psychomotricien
• Diplômé de l’Université Mohammed VI à Casablanca, exerçant en libéral dans son propre cabinet à Casablanca (Maroc).
• Adopte une approche globale et intégrative, prenant en compte les dimensions corporelle, psychique, émotionnelle et relationnelle de la personne.
• Ancien étudiant en médecine (4 années), disposant d’une solide formation biomédicale et d’une rigueur clinique intégrée à sa pratique psychomotrice.
• Expérience professionnelle diversifiée : structures associatives, exercice libéral, travail interdisciplinaire avec orthophonistes, psychologues, neuropsychologues.
• Spécialisé dans l’adaptation des prises en charge à des profils variés, avec une forte orientation vers le travail en réseau.
• Investi dans des projets thérapeutiques personnalisés, fondés sur des évaluations précises et respectueux du rythme, de l’histoire et du potentiel de chaque patient, quel que soit son âge.