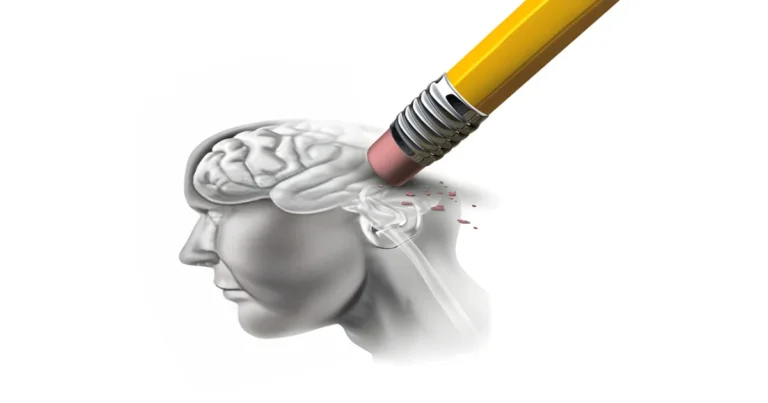Psychanalyse et Neurosciences : Vers une alliance raisonnée
À l’encontre des positions dogmatiques (souvent assorties de rejets mutuels) émanant de camps retranchés d’inconditionnels partisans, il existe des passerelles et des possibilités de coopération fructueuse entre neurosciences et psychanalyse.
Une condition essentielle pour ce dialogue est que soit redéfini ce qui n’aurait jamais dû cesser de les inspirer : la démarche scientifique, considérée à la fois :
- dans ses variantes adaptées aux sciences de la nature et aux sciences humaines ;
- dans son souci de démonstration et de réfutation, aussi bien pour ce qui concerne le cas particulier que la loi générale.
I) Les dogmatiques s’affrontent
On fait état de « grand débat parfois meurtrier » entre partisans de l’homme comme machine et de l’homme comme étant uniquement esprit et idées ». On parle aussi de « lutte fratricide » etc.
Il y a du côté des neurosciences les réductionnistes de « l’homme neuronal » : l’architecture cérébrale rendrait à elle seule compte de tout le fonctionnement psychique. « Le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile », la circulation des médiateurs chimiques dans le cerveau suffirait à expliquer tout fonctionnement mental.
Ces réductionnistes qui pensent que le cerveau secrète la pensée peuvent faire penser à l’erreur du pharaon Psammétique qui, privant deux nouveaux-nés de tout contact verbal pour savoir quelle langue émergerait, n’obtint qu’un mot, et encore… Les très rares enfant sauvages authentifiés (tel « Joseph Ursini ») n’ont pas parlé, ce qui semble bien indiquer que l’architecture cérébrale ne saurait à elle seule rendre compte de tout le fonctionnement psychique…
Les tenants du matérialisme philosophique refusent l’existence d’un principe immatériel, et l’esprit est conçu comme la manifestation de phénomènes physiologiques régis par les lois de la physique.
Ce en quoi ils se trompent : ils sont dans la dénégation de ce fait avéré que le langage (en laissant de côté la question métaphysique de l’esprit) n’est pas du tout « un principe immatériel ». Il s’inscrit dans le monde physique puisqu’à l’oral il peut s’enregistrer (j’ai eu l’occasion de travailler avec les phonéticiens du prestigieux Institut de phonétique d’Aix, devenu le LPL, et l’on y constate que le matériau sonore du langage – le signifiant – peut se visualiser, s’enregistrer et s’analyser acoustiquement), de même qu’à l’écrit il peut visuellement se noter, s’imprimer et se photographier. Bien sûr l’effet de sens ne peut pas être matérialisé dans le matériau linguistique lui-même, à l’inverse de sa trace réceptive (imagerie cérébrale).
🔗 À lire aussi : De Platon à Freud : Comment la philosophie a façonné la psychologie moderne
L’éliminativisme, de son côté, considère que notre compréhension quotidienne du mental est une erreur radicale et que les neurosciences montreront un jour que les états mentaux ne se réfèrent à rien de réel. Pour certains, le concept de conscience sera éliminé par les progrès des neurosciences.
En fait, la question de la conscience, y compris celle que pourraient acquérir les machines, est pour l’instant bien loin d’être résolue…
L’éliminativisme a été supplanté par le computationalisme, théorie qui conçoit l’esprit comme un système de traitement de l’information et compare la pensée à un calcul, plus précisément, à l’application d’un système de règles.
La conception du computationnalisme est déjà plus sur une piste pertinente. Son modèle de la pensée évoque en Intelligence Artificielle le système-expert, lequel existe matériellement… « sur le papier » ! Doté d’une « tête bien faite » (le moteur d’inférence) et d’une « tête bien pleine » (la base de règles et de faits), il est implanté dans l’ordinateur (qui sert uniquement à l’effectuer), mais il a bien une forme d’existence propre dans le monde des langages de l’informatique logique (ex: langage PROLOG).
Un détour méthodologique peut alors s’avérer éclairant, en prenant appui sur cinq des six approches recensées par Jacques Herman dans son Que sais-je ? intitulé Les langages de la sociologie :
- l’approche (ou paradigme) positiviste,
- les approches compréhensives,
- l’approche dialectique,
- l’approche fonctionaliste,
- l’approche structuraliste,
- et l’approche praxéologique. (non abordée dans ma conférence)
Pour chacune des cinq approches traitées, je présente brièvement leur objet (respectivement : le fait social, la totalité sociohistorique, le monde humain, le système social, le Code culturel), puis leur contexte socio- culturel, les sciences pilotes, les méthodes, et enfin le type d’explication qu’elles proposent.
[ Jacques Herman, Que-sais-je, , sa description étant extensible aux autres sciences humaines, et clarifiant l’usage des paradigmes de recherche dans l’abord de la Subjectivité Artificielle. Ce remarquable petit ouvrage, est « Les langages de la sociologie »malheureusement épuisé… ]
Précision : Le positivisme doit se reconnaître comme une des branches du matérialisme
Il est donc utile d’évoquer ici le positivisme de Freud. À ses débuts, la psychanalyse se présente en effet comme positiviste, utilisant des métaphores biologiques d’une part, et énergétiques (inspirées du physicien Ernst Mach) d’autre part. Puis, sa découverte s’est peu à peu teintée d’éléments de l’ « approche compréhensive ». Quant à la psychanalyse moderne (Lacan), où « l’inconscient est structuré comme un langage », elle n’est ni positiviste, ni « compréhensive » ; elle a longtemps côtoyé le structuralisme (dont la science pilote est la linguistique), pour s’en éloigner partiellement ensuite…
Il existe d’autre part des réductionnistes parmi ceux qui travaillent en psychanalyse, des psychanalystes se réfugiant dans les sphères éthérées d’un psychisme désincarné, rejoignant par là le mysticisme et les pseudo-sciences.
II) Ces deux attitudes réductionnistes, dogmatiques, sont vaines.
Faut-il alors se tourner vers les tenants de la convergence entre neurosciences et psychanalyse ? Ce sont en fait, semble-t-il, de pseudoconvergences :
- Celle de F. Ansermet et P. Magistretti (neuroplasticité) qui considèrent qu’aujourd’hui la biologie doit savoir se mettre au service de la psychanalyse et la psychanalyse au service de la biologie. Ils veulent « réintroduire le sujet dans la biologie ».
- Celle de la neuropsychanalyse, pseudoconvergence fort bien réfutée par Laurent Vercueil.
III) Notre position :
Il y a deux objets différents et complémentaires explorés par deux modalités différentes et complémentaires de la démarche scientifique
- de laisser toute la partie « étude du fonctionnement cérébral » aux neurosciences, puis la partie « simulation du cerveau » (avec entre autres les réseaux neuronaux) à des chercheurs tournés vers l’électronique et le « hardware »,
- pour nous occuper de la fonction et des effets du langage (venu de l’extérieur) dans le psychisme de l’enfant puis de l’adulte, et tenter ensuite de juxtaposer à l’Intelligence Artificielle (versant cognitif) une Subjectivité Artificielle explorant au moyen de simulations le versant subjectif du « software » mental.
En effet, on va schématiquement rencontrer une combinatoire de positions sur la question :
A) Retour sur le computationalisme :
Cette théorie conçoit l’esprit comme un système de traitement de l’information et compare la pensée à un calcul et, plus précisément, à l’application d’un système de règles. Le computationalisme ne prétend pas que toute pensée se réduit à un calcul de ce style, mais qu’il est possible d’appréhender certaines fonctions de la pensée selon ce modèle. C’est une synthèse entre le réalisme intentionnel qui affirme l’existence et la causalité des états mentaux (approche compréhensive) et le physicalisme qui affirme que toute entité existante est une entité physique (approche positiviste).
Donc cette théorie n’est pas nécessairement un matérialisme : même si la pensée s’appuie sur un support matériel (le cerveau), on peut l’étudier sans se soucier de ce support (contrairement à une certaine approche matérialiste réductionniste courante dans les neurosciences) : une même idée peut être exprimée sur des supports physiques très différents (par la voix, sur papier, sur un mur, sur un ordinateur, etc.). Dans cette mesure, le computationalisme s’apparente à un behaviorisme méthodologique : contrairement au behaviorisme ontologique, il n’affirme pas qu’il n’y a pas d’états mentaux.
🔗 Découvrez également : Wilhelm Wundt : Le père de la psychologie scientifique
« Une même idée peut être exprimée sur des supports physiques très différents (par la voix, sur papier, sur un mur, sur un ordinateur, etc.) », est-il dit plus haut. Nous nous proposons, à l’aide d’une méthode originale d’analyse de discours (donc linguistique), l’Analyse des Logiques Subjectives (cliquer), de décrire « sur le papier », ou mieux dans l’écriture d’articles et de programmes de simulation, le monde des idées qui peuplent l’humaine pensée, non pas dans son fonctionnement rationnel mais dans son fonctionnement fantasmatique qui, tout irrationnel qu’il puisse paraître, n’en obéit pas moins à une logique que nous reconstituons pour la tester en la simulant.
B) Vygotski élabore une théorie des fonctions psychiques supérieures grâce à la méthode génétique, conçue comme une « histoire sociale » c’est-à-dire (théorie sur l’ « excentration » de Leontiev) : « les transmissions ne sont pas simplement d’ordre héréditaire mais aussi culturelles ». L’intelligence se développe grâce aux outils psychologiques que l’enfant trouverait dans son environnement, dont le langage (outil fondamental). L’activité pratique serait intériorisée en activités mentales de plus en plus complexes grâce aux mots, source de la formation des concepts. Le langage « égocentrique » de l’enfant a un caractère social et se transformera ensuite en langage « intérieur » chez l’adulte. Il serait un médiateur nécessaire dans le développement et le fonctionnement de la pensée.
Vygotski appelle sa méthode « génétique » et parle d’ « histoire sociale », donc il introduit le temps, la diachronie, comme le fait la psychanalyse tant classique que moderne pour analyser la genèse de la personnalité. Il insiste, comme le fera la psychanalyse moderne, sur le langage – outil fondamental, et les mots – précédant les idées et concepts, sur la culture venue de l’autre (l’ « excentration »). Seule différence : nous insistons du rôle fondamental de la cellule familiale comme courroie de transmission et antichambre décisive avant l’immersion dans « la société en général »…
Le langage (mal nommé « égocentrique ») de l’enfant vient de l’autre, puisque c’est l’adulte qui le persuade qu’il a un ego … … et quant à la transformation de la parole adressée par l’autre en langage « intérieur », nous la décrirons dans des articles dont nous donnerons les références au fur et à mesure. Nous adhérons complètement à l’énoncé : « Le langage est un médiateur nécessaire dans le développement et le fonctionnement de la pensée », et c’est bien pour cette raison que nous introduisons, à côté de la psychanalyse, la linguistique comme second pilier de notre « Subjectivité Artificielle ».
C) Argument fourni par les neurosciences elles-mêmes : « les fonctions supérieures du cerveau exigent des interactions avec le monde et avec d’autres personnes. ». Le phénomène d’attrition consiste dans le fait que les neurones présents à la naissance dégénèrent s’ils ne sont pas utilisés. Un « branchement » sur l’extérieur est nécessaire, et tout particulièrement pour l’être humain qui ne peut se développer hors le langage et la culture.
Même adhésion totale au constat de la nécessité « des interactions avec le monde et avec d’autres personnes », « du branchement sur l’extérieur nécessaire » et « de l’impossibilité pour l’être humain de se développer hors le langage et la culture ». Un philosophe des sciences a dit : « La moitié de l’homme, c’est le langage ». Sans lui nous sommes bien – biologiquement parlant – des « Homo » de Cro-Magnon, dotés d’une forme supérieure de pensée animale, mais nullement « sapiens »… juste des mammifères primates supérieurs comparables aux hypothétiques « enfants sauvages » et « enfants loups »…
D) Notre analogie de l’ordinateur, limitée et contestable, mais éclairante :
L’esprit est au corps ce que le programme (« software ») est à l’ordinateur (« hardware »).
De même que l’ordinateur à sa sortie d’usine est quasiment vide, et ne pourra donc assurer une diversité de fonctions que si on lui apporte différents programmes, de même le corps à la naissance est pourvu de fonctions psychiques minimales, mais l’esprit avec sa diversité de fonctions ne lui viendra que des apports de l’entourage.
- À sa sortie d’usine l’ordinateur est muni de sa seule électronique. Des ordinateurs identiques acquerront des compétences différentes (traitement de texte, dessin, calcul, musique, etc.) en fonction des programmes que leurs propriétaires choisiront d’y implanter.
- À sa naissance, le corps est muni de son seul équipement héréditaire. Des enfants indemnes de toute pathologie héréditaire ou congénitale, éventuellement « identiques » (vrais jumeaux), acquerront des compétences différentes (langage, connaissances concrètes et abstraites, régulation des affects, structure de personnalité…) en fonction des formes et contenus que leurs « parents » (au sens large) implanteront chez eux, en majeure partie à leur insu.
De même que la conception, la fabrication, l’entretien et la réparation de l’ordinateur relèvent du métier d’électronicien, et n’ont rien à voir avec la conception, la rédaction, la maintenance et la correction des programmes, qui relèvent du métier d’informaticien, de même l’entretien et les thérapeutiques du corps relèvent de la médecine, mais l’esprit dans son fonctionnement normal ou perturbé relève de métiers (psychologue et psychanalyste) qui ne doivent rien à la médecine, sauf par métaphores relevant de fantasmes faciles à mettre en évidence.
🔗 À lire aussi : Plus fort qu’un atome : Anatomie d’un préjugé
« La circulation des médiateurs chimiques dans le cerveau suffirait à expliquer tout fonctionnement mental » ? Non, cette circulation permet et accompagne, sans plus, l’effectuation des programmes mentaux venus de l’extérieur. La possibilité d’entendre sur haut-parleur le bruit du programme qui s’effectue dans l’ordinateur (cf E.E.G, imagerie cérébrale) n’enlève rien au fait que le programme soit à l’origine extérieur à l’ordinateur, construit sur d’autres règles, et remodelable indépendamment de son implémentation.
Il y a bien sûr des limites à cette analogie… Notre analogie, avec les limites qu’on peut déjà lui supposer, fera l’objet de nos propres critiques, en vertu de l’adage bien connu « Comparaison n’est pas raison » (et « métaphore » et « analogie » non plus). Elle a néanmoins un mérite : nous permettre de délimiter le champ d’action de ce que nous nommons « Subjectivité Artificielle » dans notre séminaire public, de dire de quoi nous allons nous occuper : uniquement du software, du « programme subjectif » verbal, en laissant à la biologie le soin d’explorer le hardware : le corps et le cerveau…
IV) Comment travailler de façon complémentaire : en se partageant les tâches complémentaires
Il y a accord sur l’existence du déterminisme entre les neurosciences et la psychanalyse, laquelle postule le déterminisme de la vie psychique (expériences en neurosciences telles que celles de Benjamin Libet).
A) L’aveugle et le paralytique (fable de Florian)
- La science moderne (science galiléenne) combine empiricité et formalisation (Alexandre Koyré). Son histoire est celle d’un mouvement vers l’écriture logico-mathématique du Réel tel que l’explorent empiriquement les « sciences exactes ».
- Le discours psychanalytique apparaît branché en dérivation sur celui de la science moderne qui, en effet, permet l’apparition de la psychanalyse. Comme la science le fait pour le Réel du monde physique, il dément certes les énoncés unifiants quand à la description du psychisme humain (subjectivité), mais Imaginaire, inconscient et fantasme continuent de l’imprégner. La psychanalyse, permise par la science, est une discipline désimaginarisante, mais ce n’est pas une science.
- La psychanalyse moderne n’a aucune critique pertinente à adresser à la démarche scientifique. Elle dit seulement que la science a jusqu’à présent eu besoin, pour fonctionner, de tourner le dos à la subjectivité, donc de s’interdire, par construction même, de la prendre pour objet d’étude.
- Disons que la science est ici « l’aveugle ». Elle s’aveugle pour avancer, et y réussit. La psychanalyse, elle, « voit » la subjectivité mais « manque de jambes ». Les disciples ne s’intéressent qu’aux maîtres auxquels ils vouent un culte anachronique. Ils se reposent sur les lauriers de leurs initiateurs. Non-transmissibilité et secret des dieux font de la psychanalyse actuelle « le paralytique » puisqu’elle manque de « jambes » méthodologiques pour faire avancer ses hypothèses.
- Or science et psychanalyse ont en commun le non-tout, le non-sens, la dissolution de la notion d’être. Elles vont contre l’Imaginaire. Mais elles se comportent en sœurs ennemies (aînée et cadette), dans une intercritique stérile parfois d’allure idéologique. La nécessité d’une négociation et de passerelles se fait sentir.
… voir mon article, postérieur intitulé : « PSYCHANALYSE ET SCIENCE : (RE)FAIRE DIALOGUER LES SŒURS ENNEMIES »
Nous plaidons ici modestement pour une coopération entre l’aveugle et le paralytique.
Notre comparaison avec la solution trouvée dans la fable de Florian « L’aveugle et le paralytique » est au principe de ces passerelles nommées « analysciences » que nous proposons et décrivons plus loin. Un exemple en est l’Analyse des Logiques Subjectives :
• en tant qu’analyse de discours, elle utilise l’outil linguistique, la linguistique étant à l’interface des Sciences exactes et des Sciences humaines ;
• cet outil, elle le met au service de l’exploration d’un objet spécifique à la psychanalyse : le fantasme ;
• et elle en dégage des logiques subjectives, la logique (mot dérivé du grec « LOGOS » : parole, discours) étant dans notre modèle à trois termes, non-dichotomique, ce qui irrigue – de façon différente – aussi bien le rationnel que l’irrationnel.
*** L’IRRATIONNEL n’est pas ILLOGIQUE, loin de là ! ***
La science négligeait l’inconscient. Plus maintenant avec l’inconscient cognitif, mais ce n’est pas le même que l’inconscient subjectif (décrit en détail dans ma conférence sur « Psychanalyse et propagande »).
Exemple : les expériences avec perceptions infraliminales favorisant la résolution d’un problème, sans passage par la conscience. Entre autres, celle de Benjamin Libet en 1983 : l’activation cérébrale précède la décision consciente de plusieurs centaines de millisecondes), expérience améliorée en 2008 (une activité cérébrale préparatoire existe 7 à 10 secondes avant que le sujet ne prenne sa décision).
En France le livre de Lionel Naccache en 2006, « Le nouvel inconscient », pose la question des rapports entre la perspective psychanalytique et la perspective « neurocognitive ». Or ses arguments sont en partie réfutables.
- Naccache commence par rendre hommage à Freud. Il reconnaît que la conscience n’est pas tout le psychisme, mais pense que l’inconscient de Freud est une réattribution de fonctions qui relèvent en fait de la conscience. Il nie le refoulement, sans envisager que celui-ci pourrait être le fait du programme venu de l’extérieur et non des circuits parcourus par l’inconscient cognitif.
- Comme la police dans « La lettre volée » d’Edgar Poe, Naccache ne cherche peut-être pas au bon endroit, donc ses « quatre inconscients » ne peuvent coïncider avec celui de Freud.
- Si l’inconscient de Freud semble fonctionner d’après les lois du conscient, c’est peut-être parce que ce sont les énoncés consciemment émis par l’entourage familial qui, intériorisés, font sentir leurs effets hors conscience du sujet
- Comment Naccache explique-t-il la résurgence sous hypnose ou en analyse de souvenirs très anciens, « oubliés » ?
- Comment Naccache explique-t-il l’oubli « en direct » des rêves ? Par l’inconscient cognitif ? Cet oubli incoercible, comparable à l’oubli des consignes dictées sous hypnose, est un argument en faveur du refoulement et de l’inconscient subjectif.
- L’inconscient subjectif, en rapport avec la complexité du langage, repose sur d’autres bases que l’inconscient cognitif.
Nous commencerons dans quelque temps, dans un autre article, une énumération des différences et des ressemblances entre l’inconscient cognitif et l’inconscient subjectif
1) La démarche scientifique avec ses variantes
Il semble opportun de renvoyer dos à dos deux défauts caricaturaux :
- L’impérialisme des Sciences Exactes prétendant coloniser les Sciences Humaines : 1- « nombre-roi », et 2- positivisme des faits.
- Le flou artistique, voire « autistique » de ceux qui en Sciences Humaines et en psychanalyse rejettent toute formalisation.
Point 1 : Le « nombre-roi ». La statistique est critiquable (exemples détaillés ci-dessous : les hiéroglyphes, le mot « régime ») car le langage humain n’est pas un code biunivoque.
- Chaque hiéroglyphe peut prendre quatre valeurs en contexte : figurative, symbolique (par métaphore, métonymie, etc.), phonétique, déterminative (signe muet permettant le classement sémantique des signes précédents en cas d’ambiguïté). La statistique appliquée à un texte en égyptien pharaonique, ne distinguant pas ses valeurs contextuelles, échoue à apporter la moindre information utile. (Détails dans mon article « Traduction et interprétation« )
- Même chose pour les langues modernes, où 90% du vocabulaire est polysémique et ne prend sens qu’en contexte : Une exhortation formulée hors-contexte telle que « Changeons de régime ! » parle-t-elle de régime politique ? alimentaire ? d’un régime de bananes ? du régime d’un moteur ? du régime direct ou indirect d’un verbe en grammaire ? En compter les occurrences comme équivalentes entre elles ne fonctionnera pas.
« Nous nous séparons donc d’un point de vue largement répandu, selon lequel il n’y a de science que du quantifiable. Nous dirons plutôt : il n’y a de science que du mathématisable, et il y a mathématisation dès qu’il y a littéralisation et fonctionnement aveugle. » Milner, J.-C. (1989). Introduction à une science du langage. Des Travaux. Seuil, Paris.
L’Analyse des Logiques Subjectives a créé une terminologie littérale (comme en phonologie, ou en syntaxe chomskyenne), donc non-quantifiable à la base. Elle utilise par moments le comptage des « atomes » et « molécules » sémantiques, donc le quantitatif, mais en rend compte au cas par cas sans « sommation statistique ».
Point 2 : Redéfinition du terme « fait » en science : la linguistique travaille sur des corpus transcrits ou enregistrés, donc bien matériels.
La solution pourrait venir de la linguistique, critère extérieur pour mettre d’accord les psychanalystes et les neurobiologistes, puisque les uns parlent d’inconscient-langage et que les autres ne peuvent nier qu’il y ait langage, et que la science elle-même passe par le langage.
Imaginons un Huron face à un ordinateur allumé : pas besoin d’avoir repéré où résident et comment tournent les programmes pour constater qu’ils tournent, les utiliser et s’interroger sur leurs principes logiques … ! Les descriptions et analyses linguistiques sur corpus fonctionnent très bien sans qu’il soit besoin de savoir comment ça se passe dans le cerveau !
L’analyse logiciste de Gardin et Molino : c’est une modélisation logique aussi rigoureuse que celle des maths, avec :
- Validation interne des modèles théoriques et des analyses d’experts
- Validation externe de ces analyses par la fabrication de simulacres.
L’Analyse des Logiques Subjectives s’efforce de mettre en œuvre le protocole de validation recommandé ci-dessus par Gardin et Molino pour les recherches en Sciences humaines :
• La validation interne de la méthode se fait en fabriquant des programmes qui reproduisent son analyse sur des échantillons de texte représentatifs de l’argumentation subjective plutôt que de l’argumentation rationnelle ;
• La validation externe se fait par la fabrication de simulacres de « dialectes subjectifs » indiscernables de ceux parlés par leurs locuteurs, et suscitant les mêmes réactions subjectives de la part des locuteurs d’autres « dialectes ».
Le structuralisme, enterré trop tôt, est à réhabiliter à condition de le débarrasser des funestes effets de mode.
L’approche structuraliste résout l’opposition entre approche positiviste à la recherche de faits et approche compréhensive fondée sur l’introspection: il y a une objectivité, une matérialité logicisable du discours de l’acteur social, ou du locuteur, ou du patient indépendamment de l’exactitude de ce à quoi il se réfère. J.-C. Milner parle de « Galiléisme étendu » :
« À sa manière, le structuralisme en linguistique est lui aussi une méthode de réduction des qualités sensibles. Les langues naturelles ne touchent à la matière sensible que pour la forme phonique. Mais dans ce domaine, la méthode a des effets évidents.
On peut parler ici d’une mathématisation étendue, rigoureuse et contrainte, mais aussi autonome relativement à l’appareil mathématique. La linguistique devint dans les années 50 une discipline aussi littérale que l’algèbre ou la logique, mais indépendante d’elles, avec des succès empiriques pour l’ensemble des langues naturelles. Elle se comportait strictement en science galiléenne. Galiléisme étendu fondé sur une mathématique étendue, et étendu à des objets inédits. Cet objet était le langage, qui sépare l’espèce humaine du règne de la nature. De même, l’anthropologie lévi-straussienne obtenait, avec des méthodes comparables appliquées à des objets non naturels – les systèmes de parenté –, une présentation exhaustive, exacte et démonstrative des fonctionnements. L’appui que Lévi-Strauss trouvait dans la linguistique résidait dans une analogie des procédures et surtout des points de vue constituants. Sur ce fondement, linguistique et anthropologie, s’est déployé un mouvement de pensée dont l’unité méthodologique et l’importance épistémologique ne font aucun doute. Que Lacan, dont le rapport au galiléisme est principiel, et qui saisit son objet plus du côté de la culture que de la nature, ait été compté au rang des structuralistes, cela est éminemment explicable. »
L’éloquente plaidoirie du très grand linguiste qu’est Jean-Claude Milner sur le structuralisme, si prometteur et enterré trop tôt parce qu’entraîné malgré lui dans des effets de mode volatiles, parle d’elle-même. Nous y souscrivons sans réserve.
Le galiléisme étendu est une des bases de l’A.L.S. et de notre conception de la Subjectivité artificielle, avec une « mathématisation étendue », non quantitative mais littérale.
2) Le cas particulier et la loi générale
- Une des critiques que font les Sciences Exactes à la psychanalyse repose sur l’idée fausse qu’il n’y a de science que du général (Aristote).
- Or la loi statistique résultant de la méthode inductive peut se révéler, on l’a vu, non pertinente quand le langage est en jeu.
- Inversement, une analyse exhaustive d’un cas, si elle est matériellement communicable, est tout aussi généralisable et vaut tout autant qu’une collection de cas traités par la méthode inductive.
3) Les « analysciences » et l’Analyse des Logiques Subjectives (A.L.S).
« Analyscience » est un terme proposé par l’auteur de l’A.L.S. (Jean-Jacques Pinto) en 2008.
Une analyscience serait, selon une définition encore provisoire, une discipline hybride entre psychanalyse et science. Pour justifier la création de ce terme, il convient de se référer à la possibilité d’un dialogue entre la science moderne et la psychanalyse.
L’A.L.S. pourrait ainsi être candidate au label d’analyscience. Si on la définit schématiquement comme une « micro-sémantique du fantasme », ce dernier ;
- est un concept qui résulte d’une expérience en amont (séances d’analyse) ;
- il a une ébauche de formalisation : il peut recevoir une définition linguistique ;
- le fait que ce concept subsume une série d’occurrences verbales est prouvable en aval par l’A.L.S. dont le matériel est montrable, donc testable. Les procédures d’analyse de l’A.L.S. sont par ailleurs testables et reproductibles par quiconque manuellement, et simulables informatiquement.
L’A.L.S. permet d’analyser en partie les dogmatismes précités, sous-tendus par des fantasmes qu’il est possible de modéliser.
Nous proposons, pour conclure, non pas d’opposer les sciences dures de la nature aux sciences molles de l’homme, mais d’associer les sciences du dur, du hardware aux sciences du doux, du software dans l’étude complémentaire des deux pôles de l’interface caractéristique de l’humain, de la « condition humaine », ces deux pôles étant :
- le cerveau comme machine biologique (le « bio-ordinateur »)
- le logiciel verbal humain (le « verbiciel », subdivisé en « cogniciel » et « subjiciel »).
L’interfaçage a lieu durant l’enfance, c’est le processus d’identification avec ses deux versants : identification cognitive (« cogniciel« ) et identification subjective (« subjiciel« ). On peut, pour les étudier en les simulant, fabriquer de toutes pièces :
- des « cogniciels » relevant de l’Intelligence Artificielle et simulant le résultat de l’identification cognitive, par exemple par des systèmes-experts, qui différent des réseaux d’apprentissage neuronaux (que l’on pourrait nommer des « interfaciels » !!!)
- et des « subjiciels » inaugurant la Subjectivité Artificielle et simulant le résultat de l’identification subjective.
Il n’y a pas, comme le croient les positivistes ou leurs adversaires amateurs de paranormal, une opposition binaire rationnel/irrationnel, mais trois termes : rationnel, irrationnel, logique,… le logique (du grec : logos !) structurant de façon différente le rationnel et l’irrationnel. Et la logique de l’irrationnel, c’est principalement la psychanalyse, quand toutefois elle veut bien être logique !!!
Nous invitons tout chercheur animé par l’esprit scientifique à contribuer au développement de ces analysciences.
N.B. ::
- À propos de nos néologismes (« bio-ordinateur », « verbiciel », »cogniciel » et « subjiciel », ajoutons que dans notre projet de Subjectivité Artificielle nous fabriquons depuis pas mal d’années des subjiciels avec de simples techniques de linguistique informatique, mais celles-ci vont être au fur et à mesure relayées par l’Intelligence Artificielle Générative (le troisième pilier de notre approche).
- La mise en question de l’opposition binaire « rationnel »/ »irrationnel » et la proposition d’un modèle à trois termes « rationnel »/ »irrationnel »/ »logique », se retrouvent énoncées dans chacune nos trois conférences de l’année 2023. Dire « La logique de l’irrationnel, c’est la psychanalyse… quand elle veut bien être logique », c’est une des bases de la Subjectivité Artificielle.
- Enfin, le lecteur aura également compris que les analysciences et l’Analyse des Logiques Subjectives sont consubstantielles à notre projet de Subjectivité Artificielle.
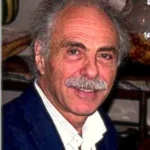
Jean-Jacques Pinto
Médecin-psychiatre, psychanalyste et psychothérapeute
Plusieurs décennies de pratique 1° de la psychanalyse classique et de la psychothérapie d'inspiration psychanalytique, et 2° de l'enseignement en psychiatrie, psychanalyse, psychologie, argumentation, rhétorique.
Séminaires, conférences, rédaction d'ouvrages et d'articles sur des thèmes en rapport avec la psychanalyse, la psychothérapie des psychoses, l'Analyse des Logiques Subjectives (A.L.S.) et la Subjectivité Artificielle.