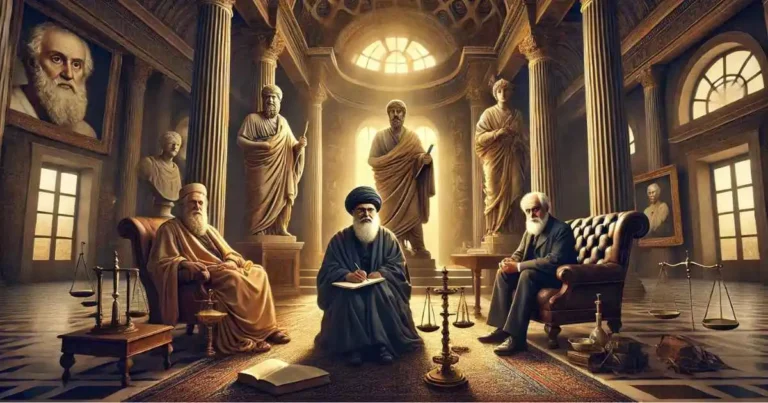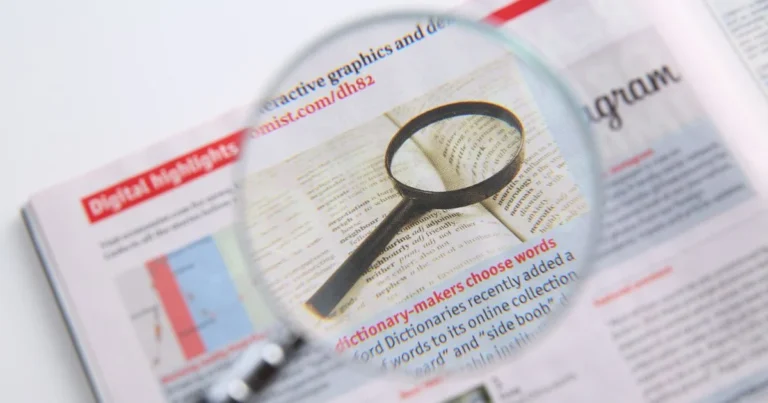Les Himba : Quand les mots peignent les couleurs
Nous croyons tous que notre perception des couleurs est universelle : le bleu est bleu et le vert est par tout un vert. Pourtant, ce que nous voyons est façonné par notre langue, notre culture et notre environnement. Chez les Himba, une tribu vivant en Namibie, le spectre chromatique ne se découpe pas comme dans les langues occidentales. Leur vocabulaire distinct classe les couleurs différemment, influençant leur façon de les percevoir et de les distinguer.
Ce phénomène fascinant interroge la relation entre langage et perception : voyons-nous réellement les mêmes couleurs ? En nous appuyant sur des études de psychologie cognitive et de neurosciences, explorons comment les Himba nous offrent une clé pour comprendre la diversité de l’expérience visuelle humaine.
La couleur, une construction culturelle et cognitive
« Nous voyons le monde non pas tel qu’il est, mais tel que notre cerveau le découpe. »
Ce concept, qui pourrait paraître abstrait, trouve pourtant des fondements concrets dans la biologie et la psychologie cognitive. La perception des couleurs, que nous considérons comme une évidence, n’est pas un simple reflet de la réalité physique ; elle est modelée par notre système nerveux, notre langage et notre culture.
D’un point de vue neuroscientifique, la lumière qui atteint notre rétine est transformée en signaux électriques, traités ensuite par le cortex visuel. Ce processus est universel, mais l’interprétation des couleurs ne l’est pas. Nos catégories chromatiques ne sont pas innées : elles dépendent du langage que nous parlons et des distinctions qu’il impose. Stanislas Dehaene, dans ses travaux sur la psychologie cognitive, souligne que la perception est une construction active du cerveau, influencée par notre environnement et notre éducation. Contrairement à l’idée d’une perception passive où l’œil capterait le monde tel qu’il est, nos circuits neuronaux filtrent, sélectionnent et interprètent les stimuli en fonction des schémas appris dès l’enfance. Nos catégories perceptives ne sont pas figées biologiquement, mais se façonnent à travers les expériences culturelles et linguistiques. Ainsi, un enfant exposé à une langue catégorisant finement certaines couleurs développera une sensibilité accrue à ces distinctions, tandis qu’un autre, issu d’une culture où ces nuances sont regroupées sous un même terme, les percevra différemment, voire les assimilera comme identiques.
Les études sur les Himba de Namibie illustrent ce phénomène : leur langue ne distingue pas le bleu du vert comme le font les langues occidentales. Pourtant, ils perçoivent des nuances de vert que nous avons du mal à différencier. Cette variabilité perceptive suggère que le langage agit comme un filtre qui façonne ce que nous sommes capables de voir.
Loin d’être un simple phénomène linguistique, cette interaction entre perception et langage ouvre une réflexion plus large sur la relativité cognitive : jusqu’à quel point notre cerveau s’adapte-t-il aux structures culturelles qui l’entourent ?
Les Himba : une vision du monde en nuances différentes
« Et si nous ne voyions pas tous le même arc-en-ciel ? » Chez les Himba, un peuple de Namibie, la perception des couleurs suit une logique radicalement différente de celle qui est courante. Alors que dans les autres langues, la classification des couleurs est faite selon des distinctions précises – bleu, vert, rouge –, leur langue segmente le spectre chromatique d’une manière unique. Par exemple, ils n’ont pas de mot spécifique pour le bleu, mais en revanche, ils possèdent de nombreuses nuances pour le vert, ce qui modifie leur capacité à discriminer ces couleurs.
Les recherches en psychologie expérimentale ont démontré que cette classification linguistique influe directement sur leur perception visuelle. Lorsqu’on leur demande d’identifier une teinte légèrement différente au sein d’une série de nuances vertes, ils y parviennent plus rapidement que les personnes issues d’une autre culture. À l’inverse, face à une nuance de bleu isolée, ils peinent à la distinguer du vert, là où un observateur étranger à leur langue y verrait immédiatement une différence évidente.
Cette singularité ne se limite pas à un simple vocabulaire : elle illustre comment notre cerveau s’adapte aux structures linguistiques et culturelles qui l’entourent. Les Himba ne perçoivent pas « moins » de couleurs, mais les organisent différemment, révélant que notre perception n’est pas uniquement dictée par notre biologie, mais aussi par le cadre culturel dans lequel nous évoluons. Une question fascinante se pose alors : si notre langue structurait différemment les couleurs, notre monde visuel en serait-il transformé ?
L’impact de la langue sur la perception des couleurs
« Les limites de mon langage sont les limites de mon monde. »
Cette célèbre phrase de Wittgenstein prend tout son sens lorsqu’on s’intéresse à la perception des couleurs. Depuis plusieurs décennies, les chercheurs en neurosciences cognitives et en linguistique s’interrogent : voyons-nous vraiment les couleurs de la même manière si notre langue ne les nomme pas de la même façon ? Les études sur les Himba apportent des éléments de réponse troublants.
Les expériences menées en psychologie cognitive montrent que la catégorisation linguistique influence directement la perception. Une célèbre expérience consistait à présenter aux Himba un cercle composé de 12 nuances de vert, dont l’une était légèrement différente. Contrairement aux Occidentaux, qui peinaient à repérer cette variation subtile, les Himba la distinguaient instantanément. En revanche, face à un cercle où figurait une nuance de bleu parmi des verts, ils éprouvaient de la difficulté, car leur langue ne distingue pas nettement ces deux teintes.
Ceci s’explique par un phénomène bien documenté en neurosciences : l’effet Whorfien, selon lequel le langage structure notre pensée et notre perception. Lorsque nous nommons une couleur, nous activons des catégories conceptuelles spécifiques qui facilitent son identification et sa mémorisation. Chez les Himba, le manque d’un mot distinct pour le bleu limite leur capacité à l’isoler rapidement, tandis que leur richesse lexicale pour le vert affine leur discrimination visuelle dans ce spectre.
Mais cette influence du langage sur la perception ne concerne pas uniquement les Himba. Des études ont montré que dans certaines langues asiatiques, qui ne différencient pas le bleu du vert, les locuteurs perçoivent ces couleurs comme une seule entité. À l’inverse, les Russes, qui ont deux termes distincts pour le bleu clair et le bleu foncé, repèrent plus rapidement ces différences chromatiques.
Ainsi, la langue n’est pas seulement un outil de communication : elle façonne notre manière de voir le monde.
Couleurs et significations culturelles chez les Himba
Les couleurs ne sont pas qu’une question de perception, elles racontent une histoire, un mode de vie, une identité. Chez les Himba, la couleur ne se limite pas à un simple phénomène visuel : elle joue un rôle fondamental dans leur culture, leur tradition et même leur bien-être physique.
L’ocre rouge en est un parfait exemple. Mélangée à du beurre et appliquée sur la peau, cette teinte caractéristique n’est pas qu’un choix esthétique : elle protège du soleil brûlant du désert namibien et symbolise la fertilité et la vie. Ce lien entre couleur et fonction est omniprésent dans leur quotidien. Les teintes utilisées dans la peinture corporelle, les vêtements et même l’architecture ont une signification spécifique, bien souvent liée à la nature et aux croyances spirituelles du groupe.
De plus, certaines couleurs sont investies de propriétés médicinales. Comme le montrent les recherches de M. Buratti, les teintes naturelles extraites de minéraux ou de plantes sont utilisées pour soigner ou apaiser, suivant des traditions transmises oralement de génération en génération.
Cette perception des couleurs diffère radicalement de l’approche occidentale, souvent dominée par une classification utilitaire et industrielle des teintes. Chez les Himba, la couleur est un langage, un vecteur d’émotions et de savoirs ancestraux. Elle illustre la manière dont chaque culture projette sur le spectre lumineux sa propre vision du monde, reliant ainsi perception, symbolisme et identité.
Le regard scientifique sur les Himba et leurs couleurs
Le cas des Himba a suscité un grand intérêt chez les chercheurs en psychologie cognitive et en neurosciences, car il remet en question l’idée d’une perception des couleurs universelle. Si nos yeux captent la lumière de la même manière, pourquoi ne voyons-nous pas tous le monde chromatique de façon identique ?
Loin d’être figée, notre perception des couleurs illustre la plasticité cognitive, cette capacité du cerveau à s’adapter aux contraintes linguistiques et environnementales. Les études menées sur les Himba montrent que leur façon de catégoriser les couleurs influence leur manière de les percevoir, mais ces résultats doivent être interprétés avec nuance.
D’un point de vue neuroscientifique, La perception visuelle repose sur un équilibre entre le traitement sensoriel primaire (cortex visuel) et les fonctions cognitives supérieures (langage, mémoire, attention, etc.). Cette interconnexion explique pourquoi un système linguistique distinct peut influencer la perception et la discrimination des couleurs en structurant la façon dont nous les catégorisons et en orientant notre attention vers certaines nuances plutôt que d’autres. En d’autres termes, la langue que nous parlons façonne les distinctions que nous faisons entre les couleurs, car nos circuits neuronaux s’adaptent aux catégories lexicales disponibles. Par exemple, si une langue ne dispose pas de termes précis pour certaines couleurs, ses locuteurs peuvent avoir plus de difficulté à les distinguer. Cela illustre comment notre cerveau organise et traite l’information visuelle en fonction des outils linguistiques dont nous disposons, influençant ainsi notre perception du monde qui nous entoure.
Cependant, les critiques des études sur les Himba soulignent que ces différences perceptives pourraient aussi être influencées par des facteurs environnementaux et développementaux. Vivre dans un environnement où la végétation est omniprésente entraîne une exposition constante à un large éventail de nuances de vert. Cette plasticité perceptive ne dépend donc pas uniquement du langage, mais aussi d’un entraînement cognitif spécifique. De la même manière, les distinctions chromatiques établies par les langues occidentales sont renforcées par l’éducation et l’apprentissage précoce, modelant ainsi nos circuits neuronaux dès l’enfance.
Ainsi, l’étude des Himba illustre une réalité plus vaste : la perception des couleurs n’est ni purement biologique, ni strictement culturelle. Elle résulte d’un dialogue entre nos structures cérébrales et les expériences qui façonnent notre monde visuel. Cette interaction dynamique entre biologie et culture montre à quel point notre cerveau est un organe malléable, capable de réorganiser ses circuits pour s’adapter aux exigences de son environnement cognitif.
L’universalité et la relativité de la perception des couleurs
Si la lumière et les longueurs d’onde sont universelles, la manière dont nous percevons les couleurs ne l’est pas. Les recherches menées à travers différentes populations montrent que certaines distinctions chromatiques sont partagées par de nombreuses cultures, suggérant une base biologique commune. Par exemple, le rouge est souvent associé à l’alerte ou au danger, probablement en raison de sa forte saillance visuelle et de son lien avec des stimuli biologiques comme le sang ou le feu. Cette idée d’universalité a été défendue par des chercheurs en neurobiologie, soulignant que les mécanismes fondamentaux du cortex visuel sont similaires chez tous les humains.
Pourtant, les études sur les Himba, les locuteurs de certaines langues asiatiques qui ne distinguent pas le bleu du vert, ou encore les Russes qui font une distinction nette entre bleu clair et bleu foncé, remettent en question cette vision universaliste. L’effet Whorfien, qui postule que la langue influence notre pensée et notre perception, suggère que le langage structure profondément notre manière d’organiser le monde visuel, entraînant des différences notables dans le traitement cognitif des couleurs.
Ce phénomène ne se limite pas aux Himba. Une étude menée chez les Berinmo, une tribu de Papouasie-Nouvelle-Guinée, a révélé qu’ils catégorisent différemment les teintes que nous regroupons sous le terme « jaune ». Leur langue possède des distinctions chromatiques qui n’existent pas en anglais, ce qui leur permet de discriminer certaines nuances que des anglophones percevraient comme identiques. Inversement, ils rencontrent des difficultés à différencier le bleu et le vert, faute de distinction lexicale claire.
Un autre exemple frappant vient des Inuits, dont le vocabulaire pour désigner la neige est d’une richesse qui dépasse largement celle des langues occidentales. De la même manière, certaines langues africaines comme le Bassa, parlé au Liberia, possèdent seulement deux catégories chromatiques principales, l’une englobant les couleurs chaudes et l’autre les couleurs froides, réduisant ainsi la distinction fine des teintes que nous effectuons dans les langues européennes.
Ainsi, bien que la perception des couleurs repose sur des bases biologiques communes, le langage façonne nos frontières perceptives, définissant ce qui est saillant et ce qui passe inaperçu. Ce phénomène témoigne de la plasticité cognitive, qui nous permet d’adapter nos schémas de pensée et notre perception sensorielle aux contraintes imposées par notre environnement linguistique et culturel. Si les études sur les Himba ne montrent une chose, c’est qu’entre universalité neurologique et relativité cognitive, notre cerveau s’adapte aux distinctions culturelles et linguistiques, illustrant sa plasticité. Ainsi, voir n’est pas seulement un acte sensoriel, mais une interprétation du monde influencée par notre histoire, notre environnement et notre langage.
Références
Dehaene, S. (2020). Psychologie cognitive expérimentale. Annuaire du Collège de France, (119), 25-38.
Dubois, D., & Cance, C. (2011). Mises en discours de l’expérience visuelle et cognition située : couleurs et espace. Corela – Cognition, Représentation, Langage.
Mollard-Desfour, A. (2019). La couleur garde-t-elle son secret ?. Sigila, 47(1), 25-39.
Preuil, S. (2021). Le tourisme ethnique des Himbas en Namibie. Tourisme & Sociétés, (29), 75-92.

Amine Lahhab
Réalisateur
Master en Réalisation- Ecole Supérieur de l'AudioVisuel (ESAV), Université de Toulouse.
License en Histoire- Université Hassan 2 de Casablanca.
DEUG en Philosophie- Université Hassan 2 de Casablanca.