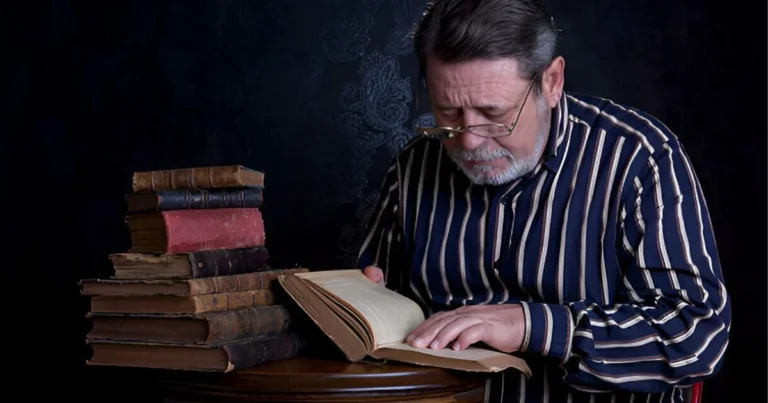Labubu : Le petit monstre à la mode
Dans certaines villes, les files d’attente commencent avant même que le soleil ne se lève. Devant les boutiques Pop Mart, on patiente des heures pour espérer repartir avec une petite boîte scellée. En ligne, les stocks s’évaporent en quelques secondes, pendant que les réseaux sociaux s’emplissent de photos, de « hauls » enthousiastes et de figurines minutieusement mises en scène.
L’objet tant convoité est Labubu, une créature étrange aux dents acérées, au sourire désaxé et au regard à la fois vide et pénétrant. Ni véritablement effrayant, ni franchement attendrissant, il semble tout droit sorti d’un rêve fiévreux d’enfant, quelque part entre le monstre de dessin animé et le doudou maltraité par l’imagination.
Né sous la plume de l’artiste Kasing Lung, Labubu est devenu bien plus qu’une simple figurine, un phénomène mondial, une pièce de collection recherchée, un marqueur culturel. Certains campent toute une nuit pour en obtenir un exemplaire ; d’autres scrutent les plateformes de revente à la recherche de la « version rare ». Pour les uns, c’est une icône de l’esthétique « ugly-cute », ce charme étrange du dérangeant. Pour les autres, c’est un simple objet de hype, vidé de son sens par la frénésie.
Mais derrière l’enthousiasme, une question mérite d’être posée, que dit cet engouement sur notre époque ?Pourquoi un personnage aussi volontairement dissonant suscite-t-il une telle obsession ? Notre goût est-il en train de se transformer, ou de s’effacer au profit d’une adhésion à la tendance ? Labubu, dans son silence figé, nous renvoie peut-être une image plus large, celle d’une génération en quête de singularité dans un marché qui uniformise jusqu’à la bizarrerie.
🔗 À lire aussi : L’identité confisquée
Quand l’étrange devient tendance
Labubu attire d’abord parce qu’il dérange. Loin des visages ronds et des lignes rassurantes des icônes kawaii classiques aux visages ronds et aux couleurs pastel, il affiche un visage asymétrique, des dents pointues, une posture instable. Il n’est ni totalement mignon, ni franchement effrayant. Il est dans cet entre-deux visuel qui interpelle.
Cette esthétique de l’étrange rompt avec les normes. Elle propose une forme de singularité. Mais cette bizarrerie est-elle encore un acte subversif, ou devient-elle elle-même une norme codifiée, reproductible, consommable ? La question mérite d’être posée.
Labubu semble incarner une figure de l’anti-conformisme. Ce que l’on appelle parfois le « cute ugly » ou le « bizarre attachant » repose sur une tension cognitive : un stimulus qui semble a priori menaçant ou repoussant, mais qui est enrobé d’éléments infantiles, tendres ou désarmants. Ce mélange crée une dissonance qui intrigue et parfois captive. L’étrangeté, dans ce cas, devient un vecteur d’attention. Elle sort de la norme, stimule la curiosité, et peut même susciter un sentiment d’exclusivité chez celui qui y adhère. Ainsi, l’étrange est devenu un style. Et ce style, une tendance.
Ce qui interroge, ce n’est pas que Labubu soit populaire. C’est la rapidité avec laquelle son étrangeté est devenue désirable, avant même d’être comprise ou assimilée. L’adhésion précède souvent le jugement : on achète parce que « tout le monde en parle », parce que « c’est original », parce que « c’est dans l’air du temps ». L’esthétique devient un signe social avant d’être une expérience sensible. Le plaisir vient après l’acte d’achat, voire après la validation sociale. Cela reflète un conformisme mimétique, une tendance à aligner ses préférences sur celles du groupe, parfois à l’encontre de ses intuitions initiales. Ce glissement interpelle : sommes-nous encore guidés par nos préférences intimes, ou absorbés par la dynamique collective du goût partagé ? Et plus largement : notre attirance pour le bizarre est-elle encore un geste de liberté, ou une nouvelle forme d’obéissance à la norme déguisée ?
🔗 En lien avec ce sujet : Le fétiche : Quand les hommes créent le sacré
Entre regard et miroir : quand le goût devient visible
Aimer un objet pour ce qu’il est, ou pour ce qu’il dit de nous ? Voilà une question que pose en filigrane le succès fulgurant de Labubu. Car au-delà de son apparence, c’est sa visibilité qui le rend désirable. Rarement un jouet ou une figurine n’aura été autant photographié, mis en scène, exposé dans des décors soignés ou des story Instagram millimétrées. Labubu n’est plus seulement un objet ; il devient un support narratif, un accessoire de construction identitaire.
Cette mise en scène permanente n’est pas anodine. Elle transforme l’objet en signe social, un indice silencieux de ce que l’on consomme, de ce que l’on comprend, et surtout de ce que l’on partage avec un collectif. Ainsi, afficher Labubu dans un post, c’est aussi s’inscrire dans un récit collectif, affirmer qu’on est à la page, connecté, sensible à la « bonne » esthétique.
Mais ce processus n’est pas sans effet sur notre manière de ressentir les choses. À force de rendre visible nos préférences, le regard des autres finit par précéder notre propre perception. Le plaisir esthétique se trouve peu à peu déplacé, il ne vient plus du rapport intime à l’objet, mais de la validation externe. Est-ce que Labubu me plaît ? Ou est-ce le fait qu’il soit désirable aux yeux d’autrui qui me fait croire qu’il me plaît ? En d’autres termes, ce que nous trouvons beau ou intéressant est parfois dicté, inconsciemment, par l’approbation collective. Et dans le cas de Labubu, il est difficile d’ignorer l’impact de cette dynamique virale.
Cela ne veut pas dire que l’on n’a pas le droit d’aimer Labubu. Mais cela invite à prendre un temps de recul. Car le bizarre, aujourd’hui, ne dérange plus, il donne l’illusion d’une différence assumée. La surprise devient un produit, et l’originalité, une tendance parmi d’autres. Labubu agit donc comme un miroir culturel. Il reflète à la fois un désir sincère de sortir des sentiers battus, et une forme de précipitation à posséder ce qui nous distingue parfois avant même de comprendre ce que cela signifie. Il montre comment le goût personnel peut se diluer dans une esthétique partagée, absorbée par l’effet de groupe et l’urgence d’un désir socialement façonné. Mais une question demeure : le simple fait que « tout le monde le veuille » suffit-il vraiment à nous convaincre que nous le voulons aussi ?
🔗 Découvrez également : Psychologie des foules : Une analyse visionnaire du comportement collectif
A-t-on encore un goût personnel, ou juste des tendances ?
Labubu n’est ni une menace pour la culture, ni un chef-d’œuvre incompris. Il n’incarne ni la décadence esthétique, ni une révolution silencieuse. Il est, avant tout, le produit d’un moment socioculturel particulier, où s’entrelacent plusieurs forces : une consommation marquée par l’émotion et l’instantanéité, un désir croissant de se distinguer dans des environnements numériques saturés, une fascination pour le non-conventionnel, et une esthétique de l’étrangeté devenue tendance.
À ce carrefour, Labubu agit comme un révélateur. Il cristallise des tensions bien plus larges que sa petite taille ne le laisse penser. D’un côté, il répond à ce besoin contemporain de singularité, cette envie de posséder quelque chose de différent, de s’éloigner des standards attendus. Mais de l’autre, il circule au sein d’un système qui réduit cette singularité à un motif répétable, un style vendable, une différence standardisée. Le paradoxe est là : Labubu est censé incarner la marginalité, tout en étant reproduit à grande échelle.
Dans ce contexte, ce n’est plus l’objet qui est en question, mais la manière dont nous nous y rapportons. Ce n’est pas tant la figurine qui interroge, mais ce qu’elle déclenche, ce qu’elle reflète, ce qu’elle mobilise en nous : un goût parfois brouillé par les flux sociaux, une envie de paraître original dans un monde où l’originalité elle-même devient un produit de masse.
Face à ce phénomène, il ne s’agit ni de condamner ceux qui l’aiment, ni de s’en moquer. Le débat ne se situe pas entre admiration aveugle et rejet moqueur. L’enjeu est ailleurs : déplacer notre regard, passer de l’objet lui-même aux dynamiques symboliques qui l’entourent.
Car Labubu n’est pas qu’une simple figurine. Il cristallise une série de questions : que révèle-t-il de notre rapport au goût, à la norme, à l’influence, à l’identité construite par l’esthétique ? Dans un monde saturé d’images et de tendances, il devient de plus en plus difficile de distinguer ce que nous aimons vraiment de ce que nous consommons parce que c’est à la mode. En ce sens, Labubu n’est pas tant un phénomène qu’un miroir de nos pratiques esthétiques. Et c’est en prenant ce miroir au sérieux que nous pouvons commencer à comprendre ce qui, dans ce petit personnage étrange, nous concerne en profondeur.
En posant ces questions, on ne cherche pas à accuser, mais à comprendre. Et peut-être, à travers cette compréhension, à retrouver un peu de lucidité esthétique, un regard plus libre, plus attentif, plus personnel, dans un monde où le goût devient parfois un simple effet de propagation.