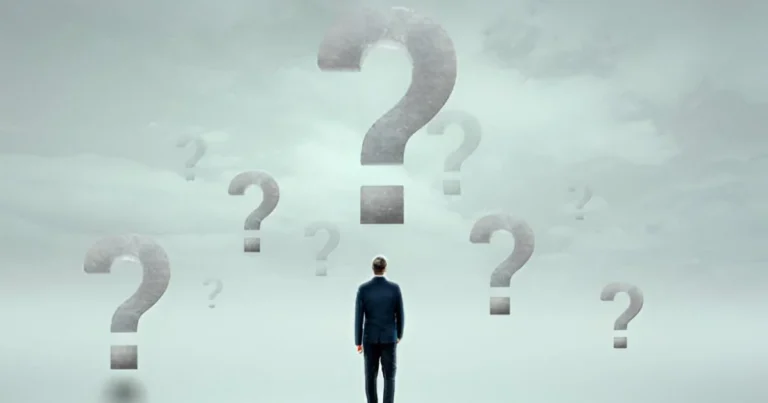Idéologie : Une métamorphose existentielle des structures mentales
Dans la cellule humide où il fut enfermé pendant la Terreur, Destutt de Tracy, aristocrate révolutionnaire, philosophe et militaire, s’enfonce dans la lecture de Condillac. Nous sommes en 1793, au cœur de la période la plus sombre de la Révolution française : la Convention montagnarde, les exécutions quotidiennes, la méfiance généralisée. Là où tant d’autres cédaient à la peur ou au cynisme, lui cherche une clarté dans le tumulte, une méthode pour comprendre comment naissent les idées.
Officiellement suspect pour avoir appartenu à la noblesse, emprisonné sans procès comme tant d’autres, il résiste à l’effondrement politique par un acte de foi philosophique. Car si le monde s’effondre dehors, une autre révolution s’organise en lui : celle de la pensée qui se regarde penser. C’est dans cette tension, entre la terreur extérieure et la lucidité intérieure, qu’il conçoit un mot nouveau : « idéologie ». Non pas comme dogme, mais comme science. Une manière d’étudier les idées comme on étudie les plantes, les minéraux ou les systèmes nerveux : avec rigueur, avec distance, avec la volonté de comprendre ce qui détermine les constructions de l’esprit.
« L’idéologie » naît donc dans une cellule, au bord de l’abîme, mais avec le souffle des Lumières encore vivant. Elle ne vise ni le pouvoir ni la conversion. Elle est d’abord une tentative de cartographier les ressorts invisibles des représentations humaines.
Aux origines d’un mot en révolution
Mais très vite, le mot glisse. Sous Napoléon, « idéologue » devient une insulte. L’esprit abstrait opposé à la volonté politique. L’idéologie, dès lors, n’est plus science. Elle devient soupçon, doctrine, instrument.
Et pourtant, elle persiste. Elle survit, mute, contamine. L’idéologie n’est pas une pensée ; c’est une structure mentale, une vision du monde habitable. Elle agit en profondeur, dans les représentations, les affects, les choix. Ce n’est pas seulement ce que l’on pense, c’est ce qui fait penser.
Pendant deux siècles, des édifices colossaux se sont construits sur ces visions : le libéralisme, le socialisme, le nationalisme, le fascisme, le communisme, le féminisme historique, le panarabisme, le panislamisme, le sionisme, l’anarchisme. Tous se présentent comme des réponses à une fracture. Tous veulent réparer l’histoire. Tous veulent réconcilier l’homme avec une vérité, un sens, un avenir.
Mais qu’est-il resté de ces chapiteaux ? Pourquoi, aujourd’hui, avons-nous le sentiment d’habiter les ruines ?
La question est moins rhétorique qu’existentielle. Pourquoi ces systèmes si puissants, si nourris de philosophie, si galvanisants, ont-ils perdu leur puissance d’action ? Pourquoi ces récits, portés par tant d’enthousiasme, ont-ils cessé d’être crédibles ? Et que reste-t-il, dans nos vies ordinaires, de leur souffle ?
🔗 À lire aussi : Plus fort qu’un atome : Anatomie d’un préjugé
Ruines d’espérance : que reste-t-il des grands récits ?
La première réponse est historique. Ces idéologies se sont effondrées sous le poids de leurs contradictions. Le marxisme a produit des bureaucraties déshumanisantes. Le nationalisme a enfanté des guerres et des exclusions. Le libéralisme a accouché d’inégalités massives. Même les révolutions dites culturelles ont déçu : le féminisme institutionnel s’est dilué dans le marketing ; l’écologie s’est muée en label.
Mais il y a aussi une fatigue symbolique. Nous vivons, selon le mot de Lyotard, la « fin des grands récits ». Le soupçon s’est généralisé. Toute idéologie est perçue comme un masque, une stratégie de pouvoir. Nietzsche, Marx et Freud ont forgé les outils de ce soupçon. Derrida, Foucault, Deleuze l’ont prolongé. Toute vérité cache une volonté. Toute promesse d’émancipation produit une norme. Toute utopie est une fabrique à exclusions.
Ainsi, le déclin des idéologies n’est pas une mort brutale. C’est une métamorphose lente. Une décomposition organique. Ce n’est pas que les idéologies ont disparu. C’est que nous avons déplacé leur énergie ailleurs.
Le monde post-idéologique n’est pas vide. Il est saturé. Saturé de fragments. De micro-engagements. De causes ponctuelles. De croyances molles. Le récit global a été remplacé par des narrations locales, identitaires, communautaires. Le militant d’autrefois est devenu influenceur, hacktiviste, vegane, survivaliste, ou coach. Les ZAD, les cryptocommunautés ou les tribus écospirituelles en sont devenues les nouveaux sanctuaires.
🔗 Découvrez également : Psychologie des foules : Une analyse visionnaire du comportement collectif
Ce morcellement n’est pas sans danger. Il produit une perte de lisibilité historique. Une difficulté à penser le long terme. Un basculement dans l’immédiat. L’urgence écologique, la crise des inégalités, les dérives numériques, exigeraient une pensée systémique. Mais nous répondons par des patchs moraux, des indignations réactives, des récits tronqués.
Et pourtant, les idéologies continuent d’habiter notre inconscient. Elles n’ont pas disparu ; elles se sont dissoutes dans le quotidien. Le désir d’ordre (conservatisme), la foi dans le mérite (libéralisme), la haine de la décadence (fascisme), l’appel à l’égalité (socialisme), tout cela ressurgit, dans les discours, les slogans, les algorithmes.
L’inconscient connecté : quand les idéologies deviennent algorithmiques
Les plateformes numériques, en particulier, ont réinventé l’art de l’orientation idéologique. Elles ne produisent pas des thèses. Elles modèlent des affects. Elles tracent des régimes d’attention. Elles renforcent des bulles cognitives. Elles deviennent des matrices de croyance.
La société du spectacle, décrite par Debord, s’est métamorphosée en société de l’influence. Là où l’on cherchait jadis la vérité, on cherche maintenant la visibilité. Le récit idéologique est devenu narratif marketing. La vision politique, storytelling.
La question qui se pose n’est donc plus : « Quelles idéologies avons-nous perdues ? » mais : « Quelles idéologies opèrent en nous, à bas bruit, sans que nous en ayons conscience ? »
Dans le silence d’une salle de classe, un adolescent se demande pourquoi certaines causes le bouleversent, alors que d’autres le laissent indifférent. Il lit un mot, un slogan, une phrase d’accroche. Il ressent avant de comprendre. Là commence l’idéologie : non pas comme raisonnement, mais comme résonance.
Les idées, disait Spinoza, ne sont pas nues. Elles circulent par les affects. Elles s’ancrent dans des corps, des histoires, des peurs, des espoirs. On n’adhère pas à une vision du monde par pure délibération. On y entre comme dans une maison familière, parce qu’elle réchauffe une blessure, comble un manque, ou ordonne un chaos.
Le cerveau humain, rappellent les neurosciences, ne cherche pas tant la vérité que la cohérence. Il filtre, associe, simplifie. Antonio Damasio a montré que toute décision, même apparemment rationnelle, passe d’abord par l’émotion. Une idéologie opère lorsqu’elle apaise une tension interne, propose une cause où inscrire sa peur ou sa colère, un avenir où déplacer son angoisse.
Ce que l’on appelle aujourd’hui « biais cognitifs » ne sont pas des accidents de pensée. Ils sont la structure même de nos jugements spontanés. Leon Festinger, dès les années 1950, décrit la dissonance cognitive : ce malaise qu’on ressent quand nos actes contredisent nos croyances. Pour le soulager, on ajuste notre perception du monde. Ainsi, l’idéologie sert souvent de réassurance : elle stabilise le sens, même au prix du réel.
🔗 À lire aussi : L’expérience de Stanford : Une descente troublante dans la psychologie du pouvoir
Mais l’adhésion n’est pas qu’une affaire de confort psychique. C’est aussi une affaire d’appartenance. Martha Nussbaum rappelle que nos émotions collectives — honte, fierté, colère — sont les vecteurs d’une citoyenneté sensible. On se sent de gauche, de droite, d’un mouvement ou d’un autre, non seulement parce qu’on y pense, mais parce qu’on y vibre. Une idéologie réussit lorsqu’elle donne le sentiment d’être vu, reconnu, relié.
Mais pourquoi certaines visions du monde s’effondrent-elles, alors que d’autres s’imposent ? La réponse est parfois culturelle. Pierre Bourdieu l’avait pressenti : toute croyance s’ancre dans un habitus, un style de vie incorporé, un langage du quotidien. Une idéologie trop abstraite, trop technique, trop déconnectée de l’expérience ordinaire, échoue à convaincre. A contrario, une vision du monde simple, manichéenne, narrative, trouve prise dans un monde complexe.
Le populisme, le complotisme, les récits identitaires — tous prospèrent sur cette faille. Ils offrent une carte mentale rassurante : des héros et des ennemis, des causes claires, une temporalité apocalyptique. Ce sont des scripts émotionnels, plus que des doctrines.
L’idéologie, en ce sens, n’est pas une idée que l’on choisit, mais un monde que l’on habite. Elle touche moins la raison que l’épaisseur affective et cognitive de l’existence. Elle est, selon les mots de Cornelius Castoriadis, une « création imaginaire sociale », à la fois besoin d’ordre et désir de sens.
Et c’est sans doute pourquoi nous n’en finirons jamais avec les idéologies : parce qu’elles sont des réponses humaines à la démesure du monde. Elles offrent un abri, une structure, une orientation. Mais cet abri, pour ne pas devenir prison, doit être interrogé, mis à jour, arpenté sans relâche.
Il est temps d’interroger ces nouvelles croyances : la foi dans la technologie salvatrice, dans l’optimisation de soi, dans l’intelligence artificielle comme solution à l’humain trop humain. Ce ne sont pas des idéologies revendiquées, mais elles produisent des effets massifs : hiérarchies, exclusions, nouvelles formes de soumission symbolique.
À 3 heures du matin, la lumière bleutée d’un écran illumine un bureau silencieux de San Francisco. Un homme, front penché sur le clavier, paufine les dernières lignes d’un manifeste interne sur les potentialités éthiques de l’intelligence artificielle. Sam Altman, PDG d’OpenAI, y parle de responsabilité, de sauvegarde civilisationnelle, d’alignement des machines sur les valeurs humaines. Il croit penser le futur. Il croit anticiper des risques. Mais il fait bien plus que ça : il échafaude un récit du monde. Une idée de ce que nous sommes, et de ce que nous devrions devenir.
Comme Destutt de Tracy en son temps, Altman ne se pense pas « idéologue ». Il est rationnel, prospectif, à la croisée de la science et de la morale. Mais derrière le langage technologique, on retrouve les mêmes briques anciennes : une anthropologie implicite, une vision du progrès, une grammaire du salut. Autre siècle, mêmes gestes. L’idéologie n’a pas disparu. Elle a changé de peau.
La philosophe Nancy Fraser le souligne : la critique de l’idéologie doit aujourd’hui s’étendre aux dispositifs de subjectivation. Comment les systèmes fabriquent-ils du « moi » compatible avec le capitalisme de plateforme ? Comment les croyances sont-elles internalisées sous forme de développement personnel, de wellness, de coaching, de lifestyle ?
🔗 Découvrez également : Prise de décision : et si le cerveau ne suivait pas un seul itinéraire ?
L’idéologie, dans ce cadre, n’est plus un programme. C’est une ambiance. Une humeur sociale. Une grille implicite. Elle n’a plus besoin de manifeste. Elle s’insinue dans les pratiques.
Mais peut-on vivre sans idéologie ? Peut-on penser sans échafauder de vision du monde ? Peut-on agir sans horizon symbolique ? Sans projet collectif ?
Ce serait croire que l’homme peut s’extraire de la culture. Or, tout langage est déjà un choix. Tout récit, une exclusion. Tout regard, un angle. L’idéologie est la condition même de la pensée collective. Le problème n’est pas qu’elle existe, mais qu’elle s’impose sans conscience critique.
Habiter ses croyances : pour une lucidité partagée
Il ne s’agit donc pas de se libérer de toute idéologie. Mais d’en reprendre la maîtrise. D’oser une cartographie de nos croyances. De remettre en chantier l’imaginaire collectif. De redonner à la pensée sa fonction prospective.
Car ce que nous appelions hier « grands récits » n’étaient pas que des instruments de pouvoir. Ils étaient aussi des échafaudages de sens, des laboratoires d’éthique, des appels à transformer le monde.
Nous n’avons pas besoin de revenir à des dogmes. Mais nous avons besoin de visions. De sens partagés. De boussoles. Car sans cela, nous restons livrés à la pulsion du moment, à l’immédiat permanent, à l’atomisation symbolique.
Repenser l’idéologie aujourd’hui, ce n’est pas la réhabiliter. C’est la ressaisir comme outil de résistance mentale. Comme force de création collective. Comme espace de médiation entre le désir et le réel. Entre le soi et le monde.
Une idéologie qui n’enferme pas. Qui n’impose pas. Mais qui aide à voir. À choisir. À relier. À agir.

Ahmed El Bounjaimi
Concepteur-rédacteur
Master en communication des organisations, université Hassan II.
Licence en philosophie de communication et champs publics, université Hassan II.