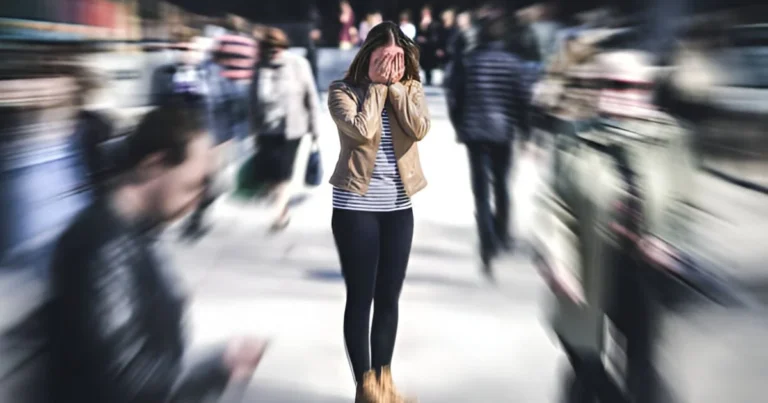La femme qui ne pouvait pas oublier : L’étrange cas de l’Hyperthymésie
Le 8 juin 2000, une lettre atterrit sur le bureau du professeur James McGaugh, neuroscientifique à l’Université de Californie à Irvine. Elle provient d’une femme, Jill Price, qui y décrit une mémoire dont elle ne peut se défaire. Depuis l’âge de 14 ans, affirme-t-elle, chaque jour de sa vie est gravé dans sa mémoire avec une précision chirurgicale. Pas seulement les anniversaires ou les événements marquants, mais aussi les détails les plus ordinaires : ce qu’elle portait un certain lundi de mai, la couleur du ciel un dimanche de 1987, la date exacte d’un épisode de série télévisée. Chaque jour de sa vie passée refait surface avec une précision implacable. À chaque date se rattachent des souvenirs qui émergent d’eux-mêmes, sans qu’elle les appelle, sans effort. Ils surgissent, insistants, ininterrompus. Ce n’est pas une capacité qu’elle contrôle, mais un flot continu qui l’envahit.
À l’époque, ce phénomène n’apparaît dans aucune classification médicale. Intrigué, James McGaugh met alors en place une série d’évaluations neuropsychologiques approfondies afin de comprendre cette mémoire hors norme. Tests de mémoire à long terme, datation d’événements historiques, analyses de souvenirs personnels croisés avec des journaux intimes : Jill réussit à chaque fois avec une exactitude impressionnante.
Lorsque l’équipe de McGaugh publie son étude dans la revue Neurocase en 2006, elle donne un nom à cette singularité : Highly Superior Autobiographical Memory (HSAM), que l’on traduit par hyperthymésie. Il s’agit d’une mémoire autobiographique exceptionnelle, qui permet de se rappeler de manière vivace, ordonnée et détaillée les événements de sa propre vie, jour après jour, parfois sur des décennies. Mais très vite, l’équipe de recherche comprend que cette performance mnésique n’a rien d’un superpouvoir. Pour Jill Price, ce n’est ni un talent ni une source de plaisir. C’est un poids.
« Ma mémoire est comme une pellicule de film qui ne s’arrête jamais », expliquera-t-elle plus tard.
Ce qu’elle vit, ce n’est pas une mémoire intentionnelle, comme celle des champions de mémorisation, mais une mémoire involontaire, automatique, intrusive. Elle ne convoque pas ses souvenirs, ils surgissent, s’imposent, souvent au détriment de sa tranquillité psychique.
🔗 À lire aussi : La mémoire des Hypocrites
Dans le cerveau d’un hypermnésique
L’un des aspects les plus troublants de l’hyperthymésie concerne la charge émotionnelle de ces souvenirs. Un événement douloureux ne s’efface jamais. Un souvenir humiliant, même vieux de vingt ans, peut encore déclencher les mêmes émotions intenses qu’au moment où il a été vécu. Comme si le temps n’avait pas opéré sa fonction d’adoucissement. En neuropsychologie, on parle ici de vividness ou vivacité, cette qualité d’un souvenir à rester sensoriellement et émotionnellement présent. Chez Jill, cette vivacité ne faiblit jamais. C’est cette fidélité émotionnelle au souvenir qui finit par épuiser. Ainsi, se souvenir de tout n’est pas toujours un don. Pour Jill Price, c’est un fardeau. Chaque souvenir douloureux, chaque honte ancienne revient avec la vivacité du présent. L’oubli, ce mécanisme que l’on juge si souvent défaillant, apparaît ici dans toute sa nécessité.
Les premières analyses publiées en 2006 sur Jill Price, le premier cas décrit d’hyperthymésie, n’avaient pas encore mis en évidence d’anomalie cérébrale précise ; elles évoquaient simplement la possibilité d’un trouble affectant les circuits fronto-striataux, souvent impliqués dans les tendances obsessionnelles. Ce n’est qu’avec les études d’imagerie réalisées quelques années plus tard, sur Jill Price et d’autres personnes atteintes d’hyperthymésie, que des particularités anatomiques ont été objectivement documentées. L’une des plus marquantes concerne le noyau caudé, une structure en forme de C située en profondeur dans les hémisphères cérébraux, dont le volume apparaît significativement plus élevé que chez les sujets témoins. Traditionnellement, cette région est surtout connue pour son rôle dans l’apprentissage procédural, la formation des habitudes et la régulation des comportements routiniers, en interaction avec le cortex préfrontal. Mais son rôle dépasse les automatismes moteurs : le noyau caudé intervient aussi dans la sélection et la régulation des réponses cognitives, en particulier lorsque des informations sont réactivées de façon répétitive. C’est ce qui explique qu’il soit souvent étudié dans les troubles obsessionnels compulsifs (TOC), où il favorise la récurrence de pensées ou d’images mentales intrusives. Dans l’hyperthymésie, la présence d’un noyau caudé hypertrophié pourrait donc contribuer à la réactivation incessante de souvenirs autobiographiques, ceux-ci étant intégrés dans un circuit de répétition qui échappe en partie au contrôle volontaire.
🔗 Découvrez également : La mémoire au bout des doigts : Les vertus oubliées de l’écriture
Ainsi, la mémoire de Jill Price ne se contente pas d’enregistrer les événements, elle s’ancre dans une véritable structuration temporelle. Chaque date évoquée est automatiquement reliée à des faits vécus, comme si son cerveau avait construit un calendrier autobiographique en continu. Ce système de datation spontané est exceptionnel, voire unique, et diffère fondamentalement de la mémoire épisodique classique, souvent morcelée et sujette à reconstruction. Les chercheurs avancent l’hypothèse qu’un volume accru du noyau caudé et du putamen antérieur pourrait favoriser le renforcement de schémas cognitifs rigides, où les associations temporelles entre les dates et les souvenirs deviennent automatiques et persistantes. Autrement dit, chaque date agirait comme un déclencheur systématique, activant une séquence mémorielle quasi compulsive. Une fois installée, cette boucle rendrait difficile, voire impossible, la mise à distance des souvenirs.
L’hyperthymésie défie ainsi les modèles traditionnels de la mémoire humaine, fondés sur l’oubli progressif des informations au fil du temps. Depuis les premiers travaux d’Ebbinghaus au XIXe siècle, la mémoire est généralement décrite comme un processus dynamique, soumis à l’oubli, à la déformation et à la reconstruction. Or, dans le cas de Jill Price, cette mécanique naturelle semble suspendue. Les souvenirs ne s’estompent pas. Ils persistent avec une acuité constante, comme s’ils avaient échappé à l’érosion du temps.
Le paradoxe de la mémoire parfaite
La mémoire humaine n’est pas conçue pour tout retenir. Elle sélectionne, hiérarchise, réorganise : certains événements demeurent, d’autres s’effacent peu à peu, ce qui permet d’éviter la saturation cognitive et émotionnelle. L’oubli, loin d’être une défaillance, est une fonction protectrice. Chez Jill Price, ce mécanisme semble absent. Rien ne s’atténue, rien ne disparaît. Chaque souvenir conserve son intensité émotionnelle d’origine. Ce n’est pas seulement se rappeler, c’est revivre, sans cesse, les moindres détails de son passé parfois sans le vouloir, toujours sans pouvoir y échapper. La mémoire autobiographique, qui devrait orienter et donner du sens, se transforme alors en un système d’enfermement où les jours écoulés se rejouent indéfiniment.
Le cas de Jill Price met ainsi en évidence un paradoxe. Ce n’est pas la quantité de souvenirs qui fonde une mémoire saine, mais sa souplesse. Une mémoire trop rigide, trop fidèle, trop présente devient un fardeau. Dans l’hyperthymésie, le filtre qui sélectionne et module l’accès aux souvenirs paraît affaibli. Chaque information personnelle reste disponible, vive et insistante, comme si le seuil d’activation des souvenirs avait été abaissé de manière irréversible. Il ne s’agit donc pas simplement d’une mémoire amplifiée, mais d’un système dont le mécanisme de régulation est défaillant. C’est précisément l’absence de modulation, cet équilibre entre activation et inhibition, qui rend ce fonctionnement pathologique. Le système de rétrocontrôle interne, censé filtrer et moduler les traces mnésiques, devient inopérant. Privé de ce régulateur, le cerveau bascule dans une logique de répétition automatique. Ainsi, le trouble ne réside pas dans une performance excessive, mais dans une dérégulation profonde, un seuil de tolérance émotionnelle déplacé, une mémoire devenue autonome, indifférente au contexte et au temps. C’est ce que vivent les personnes atteintes d’hyperthymésie, des souvenirs qui ne s’effacent plus, une vie intérieure sans pause, saturée d’un passé toujours actif.
Or, ce constat amène à reconsidérer la valeur de l’oubli. Dans l’imaginaire collectif, il est souvent perçu comme une faiblesse, une défaillance du cerveau. Mais en psychologie cognitive comme en neurosciences, l’oubli est reconnu comme une fonction vitale. Il ne s’agit pas seulement de perdre des informations, mais de réguler leur accessibilité, de protéger l’équilibre mental et d’éviter que la mémoire ne se transforme en une charge incessante.
🔗 À lire aussi : La Mémoire du poisson rouge : Mythe ou réalité ?
Loin d’être une défaillance, l’oubli joue donc un rôle adaptatif crucial. Il permet de hiérarchiser les informations selon leur pertinence, d’atténuer la charge émotionnelle liée aux souvenirs difficiles, de réorganiser notre histoire personnelle de manière à la rendre cohérente et supportable. Il protège et rend possible l’oubli partiel sans effacement complet, une forme d’édition continue de notre passé. Ce mécanisme de tri semble malheureusement désactivé chez Jill Price. Sa mémoire autobiographique fonctionne sans filtre ni pondération. Tout, du plus trivial au plus traumatisant, est conservé sur le même plan, avec la même intensité émotionnelle. Cette absence de hiérarchisation transforme sa mémoire en un système rigide, presque mécanique. Une simple date, une image, une odeur suffisent à réactiver, avec une précision intacte, des scènes entières du passé. Elle ne se souvient pas, elle revit. Et c’est précisément cette reviviscence permanente qui rend le présent si difficile à habiter.
Ce que montre son expérience, c’est que la valeur d’une mémoire ne tient pas à sa capacité brute à tout enregistrer, mais à sa souplesse et sa capacité à remodeler les traces du passé, à en atténuer certaines pour faire place au présent et préparer l’avenir. Sans ce travail d’oubli, la mémoire cesse d’être une ressource et se transforme en fardeau. Comme tout organisme vivant, le cerveau a besoin de mécanismes d’ajustement pour rester en équilibre, et l’oubli en est l’un des plus vitaux. C’est peut-être là que se joue une part essentielle de notre liberté intérieure dans cette faculté à laisser s’effacer ce qui entrave, afin de transformer la mémoire en un allié plutôt qu’en une contrainte. Car oublier, ce n’est pas effacer ni renoncer à son histoire, mais rendre possible l’écriture de la suite : une mémoire qui choisit, qui libère et qui ouvre l’avenir.
Références
LePort, A. K., Mattfeld, A. T., Dickinson-Anson, H., Fallon, J. H., Stark, C. E. L., Kruggel, F., … & McGaugh, J. L. (2012). Behavioral and neuroanatomical investigation of Highly Superior Autobiographical Memory (HSAM). Memory, 20(2), 110–132.
Parker, E. S., Cahill, L., & McGaugh, J. L. (2006). A case of unusual autobiographical remembering. Neurocase, 12(1), 35–49.
Price, J. (2008). The Woman Who Can’t Forget: The Extraordinary Story of Living with the Most Remarkable Memory Known to Science. Free Press.

Sara Lakehayli
Docteur en neuroscience cliniques et santé mentale, PhD
Membre associée au Laboratoire des Maladies du Système Nerveux, Neurosensorielles et du Handicap, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca.
Professeur à l'école supérieure de psychologie