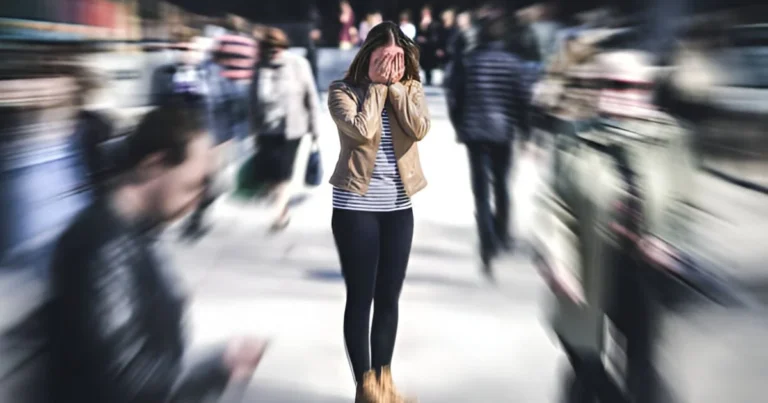Le pouvoir thérapeutique du mouvement
Il y a des soirs où l’âme se tait et où le corps, dans ses frémissements discrets, raconte l’histoire entière : les épaules lourdes des chagrins passés, le souffle pressé des peurs muettes, la lenteur des gestes où s’égare l’espérance. Et c’est peut-être là, dans cette langue silencieuse de la chair, que réside la vérité la plus intime de nous-mêmes.
On parle souvent de santé mentale en termes de pensées, d’émotions, de troubles anxieux ou dépressifs. Mais on oublie parfois un acteur discret, silencieux, et pourtant central : le corps.
En effet, notre équilibre psychique ne se joue pas seulement dans les réseaux neuronaux ou dans la chimie cérébrale. Il s’enracine aussi dans la manière dont nous habitons notre corps, dont nous percevons ses signaux et dont nous l’utilisons dans nos interactions avec le monde. La posture que nous adoptons, la fluidité de nos gestes, le rythme de notre respiration, ou encore la qualité de notre tonus musculaire sont autant d’indices de notre état psychique, mais aussi de leviers thérapeutiques potentiels.
Les recherches récentes en neurosciences affectives confirment ce que les praticiens du corps observent depuis longtemps : les émotions ne sont pas uniquement des phénomènes cérébraux abstraits, elles s’inscrivent et se régulent aussi à travers le corps. Par exemple, l’anxiété s’accompagne d’une accélération cardiaque et d’une hyperventilation, tandis que la tristesse se traduit souvent par un ralentissement moteur et une diminution de l’énergie tonique. Ces manifestations corporelles ne sont pas de simples « conséquences » : elles participent activement à la construction et à l’entretien de l’expérience émotionnelle.
Or, dans un monde où l’on vit de plus en plus « dans sa tête », le risque est grand de se déconnecter de ses sensations corporelles. Beaucoup de personnes ignorent qu’elles sont crispées, contractées, essoufflées, jusqu’à ce que ces signaux se transforment en douleurs chroniques, en troubles du sommeil, ou en épuisement psychique. C’est précisément là qu’intervient la psychomotricité.
Cette discipline, encore méconnue du grand public, place le corps au cœur du soin psychique. Elle s’appuie sur un constat fondamental : le bien-être mental ne peut être durable si le rapport au corps reste conflictuel, figé ou fragmenté. Le psychomotricien ne traite pas seulement les « symptômes » physiques, mais il accompagne le patient à retrouver une unité entre ses perceptions corporelles, ses émotions et ses représentations mentales.
🔗 À lire aussi : Psychomotricité : L’histoire d’un corps en quête de sens
Concrètement, cela signifie travailler sur des axes aussi variés que la prise de conscience corporelle (ressentir son ancrage, son tonus, sa posture), la qualité du mouvement (fluidité, coordination, expressivité), la gestion du rythme et de l’espace (se situer, s’orienter, structurer ses repères), ou encore la résonance émotionnelle (identifier comment une émotion se traduit corporellement et apprendre à la réguler).
En plaçant le corps comme médiateur entre l’intériorité et le monde extérieur, la psychomotricité propose une approche globale. Elle ne vise pas uniquement à « soigner l’esprit », mais à réconcilier l’individu avec son vécu corporel, afin de lui redonner des appuis stables pour son équilibre psychique.
Quand le corps raconte la vie intérieure
Il suffit d’observer : une personne anxieuse a les épaules contractées, respire vite, se tortille parfois. Quelqu’un de triste, lui, marche plus lentement, parle d’une voix monotone, le regard baissé. Le corps exprime l’état intérieur, souvent avant même que les mots ne le traduisent. Depuis les travaux du physiologiste William James au XIXᵉ siècle, jusqu’aux recherches contemporaines en neurosciences affectives et en psychologie incarnée (embodied cognition), de nombreuses études montrent que les émotions ne sont pas séparées du corps, mais qu’elles s’y inscrivent et s’y manifestent.
L’anxiété, par exemple, active le système nerveux sympathique, responsable de l’accélération cardiaque, de la respiration rapide et de la tension musculaire — des réactions héritées de notre évolution, destinées à préparer l’organisme à fuir ou à se défendre.
À l’inverse, la tristesse s’accompagne d’un ralentissement du tonus et d’une baisse de l’énergie motrice : le corps se replie, les gestes se font rares, la voix perd de son dynamisme.
Quant à la colère, elle se manifeste par une tension musculaire généralisée, un visage rougi, des mouvements brusques et une respiration plus forte — autant de signes d’un corps prêt à l’action et à l’affirmation.
Ces manifestations corporelles ne sont pas de simples conséquences « visibles » : elles participent activement à l’expérience émotionnelle elle-même. Le psychologue Antonio Damasio a montré, à travers sa théorie des marqueurs somatiques, que le cerveau utilise les signaux corporels (rythme cardiaque, tensions, respiration) comme des repères pour « ressentir » et décider. En d’autres termes, sans le corps, l’émotion serait incomplète.
Mais la relation n’est pas à sens unique : agir sur le corps peut aussi transformer l’état intérieur. Plusieurs approches thérapeutiques s’appuient sur ce principe. La respiration abdominale ou la cohérence cardiaque, par exemple, ralentissent le rythme cardiaque et envoient au cerveau un signal de sécurité, réduisant ainsi l’anxiété. De même, adopter des postures corporelles ouvertes — se redresser, respirer profondément, étirer ses bras — favorise un sentiment de confiance et de vitalité, tandis que les postures fermées entretiennent l’abattement. Enfin, le mouvement rythmé, qu’il s’agisse de la marche, de la danse ou de simples balancements, contribue à réguler les émotions en sollicitant les circuits cérébraux impliqués dans la régulation tonico-émotionnelle.
En psychomotricité, ce principe est fondamental : le corps devient un levier thérapeutique. Observer les signes corporels, c’est accéder à l’état psychique du patient ; travailler sur le tonus, la respiration ou le rythme, c’est l’aider à retrouver un équilibre émotionnel. Ainsi, le miroir corps-esprit fonctionne dans les deux sens : il traduit nos états internes, mais il peut aussi nous donner les moyens de les transformer.
🔗 Découvrez également : Quand la souffrance devient divertissement: De Rhythm 0 au trash streaming
Le schéma corporel, la carte intérieure de soi-même
Pour comprendre ce lien entre corps et santé mentale, il faut parler d’un concept central en psychomotricité : le schéma corporel.
Le schéma corporel correspond à la représentation que chacun a de son corps, en mouvement ou au repos. C’est une sorte de carte intérieure, je sais instinctivement où commencent mes jambes, jusqu’où s’étendent mes bras, comment je peux tendre ma main pour attraper un objet sans avoir besoin de regarder. Ce savoir implicite, ancré dans le système nerveux, nous permet de nous orienter dans l’espace, d’ajuster nos gestes, mais aussi de nous sentir présents et cohérents dans notre propre corps.
Cette carte ne naît pas toute faite : elle se construit progressivement dès la petite enfance, à travers les expériences sensorielles et motrices. Le bébé qui découvre ses mains, l’enfant qui tombe puis se relève, celui qui court, grimpe, danse ou joue à la marelle : toutes ces expériences enrichissent peu à peu la perception de son corps. Cette construction repose sur l’intégration de plusieurs systèmes sensoriels : le toucher et la proprioception, qui permettent de percevoir la position et la tension des muscles ; le système vestibulaire, qui informe sur l’équilibre, la gravité et l’orientation dans l’espace ; la vue, qui confirme ou corrige les mouvements ; et même l’ouïe, en aidant l’enfant à ajuster sa voix à la résonance de son propre corps. Lorsque ce schéma est clair et stable, l’individu se sent ancré et sécurisé. Il a confiance dans ses appuis corporels, ce qui favorise l’autonomie, l’équilibre émotionnel et la relation à l’autre.
En revanche, quand ce schéma est flou, lacunaire ou perturbé, les conséquences peuvent être profondes. Cela peut arriver à la suite d’un trouble neurologique (lésions cérébrales, maladies neurodégénératives), mais aussi dans le cadre d’une anxiété chronique, d’un traumatisme psychique ou d’une carence d’expériences corporelles (par exemple chez certains enfants surexposés aux écrans, moins engagés dans le jeu moteur). Dans ces cas, le corps cesse d’être un repère rassurant : il devient parfois étranger, incertain, source de malaise ou de fragilité identitaire. En clinique, cela peut se manifester par des difficultés de coordination, des maladresses, mais aussi par un rapport distordu à soi-même, ne pas se sentir « bien dans son corps », avoir du mal à se situer, ou encore ressentir une insécurité diffuse. Les troubles de l’image corporelle observés dans certaines pathologies (anorexie, troubles anxieux, états dissociatifs) trouvent souvent leur racine dans un schéma corporel instable.
La psychomotricité intervient ici comme un outil de réajustement. Par des activités motrices (parcours moteurs, jeux d’équilibre, coordination), par des médiations sensorielles (relaxation, toucher thérapeutique, expériences rythmiques), le psychomotricien aide le patient à reconstruire une carte corporelle fiable. En retrouvant une perception claire et cohérente de son corps, la personne regagne aussi un sentiment de stabilité psychique et relationnelle.
🔗 En lien avec ce sujet : Grandir par le mouvement : La psychomotricité comme socle éducatif
Le vécu corporel, sentir pour exister
À côté du schéma corporel, qui constitue la carte objective de notre corps dans l’espace, il existe une dimension tout aussi essentielle mais plus subjective et intime : le vécu corporel. Là où le schéma corporel renvoie à une construction neurologique et perceptive, le vécu corporel relève de la façon dont nous ressentons notre corps de l’intérieur.
Est-ce que je me sens lourd ou léger ? Mon corps m’apparaît-il comme un lieu de sécurité ou comme une contrainte ? Ai-je l’impression d’être tendu, enfermé, oppressé, ou au contraire détendu et libre ? Ces impressions peuvent sembler abstraites, mais elles sont au cœur de notre rapport au monde et à nous-mêmes.
Ce vécu ne se limite pas aux sensations physiologiques : il est intimement lié à l’histoire personnelle, aux émotions et aux relations interpersonnelles. Chaque expérience vécue — un câlin apaisant dans l’enfance, une chute douloureuse, un regard moqueur sur l’apparence, une expérience traumatique — laisse une empreinte corporelle qui influence la manière dont on habite son corps. Les cliniciens parlent parfois de tonus de fond émotionnel : une personne anxieuse perçoit son corps comme tendu, « prêt à exploser » ; une personne dépressive le ressent comme ralenti, engourdi, « plombé » ; un adolescent en crise peut éprouver une forme d’« étrangeté » ou d’« étroitesse », comme si son corps n’était plus en accord avec son identité en construction. Ces perceptions ne sont pas de simples images mentales : elles traduisent de véritables expériences sensorielles qui influencent directement la santé psychique. Ainsi, une personne qui se sent enfermée ou lourde dans son corps aura plus de difficultés à s’ouvrir aux autres et à entrer en relation. De même, un patient qui vit son corps comme un foyer de tensions permanentes risque de développer des troubles anxieux ou somatiques, tels que des maux de ventre, des migraines ou des insomnies. À l’inverse, retrouver un vécu corporel plus fluide et plus léger favorise la confiance en soi, la disponibilité affective et la capacité à faire face au stress.
Dans ce domaine, la psychomotricité agit comme un véritable laboratoire d’expériences corporelles. À travers des exercices de relaxation, de respiration, de mobilisation douce ou d’exploration sensorielle, le patient redécouvre des sensations souvent oubliées : le poids du corps qui se relâche, le plaisir d’un geste fluide, la respiration qui devient un appui. Ces expériences, simples en apparence, transforment en profondeur la relation au corps et, par ricochet, l’équilibre intérieur.
Le but n’est pas d’atteindre une performance physique, comme dans le sport, ni de corriger mécaniquement un geste, mais de permettre à chacun de se réapproprier son corps. En apprenant à le ressentir, à le mobiliser, à l’écouter, la personne cesse de le vivre comme un poids ou une contrainte pour le percevoir comme une ressource, un appui, un allié.
Discipline encore méconnue du grand public, la psychomotricité propose d’utiliser le corps comme médiateur du soin. Elle repose sur une idée simple mais essentielle : nos gestes, notre tonus, notre respiration et nos postures ne sont pas de simples automatismes, ils traduisent notre état intérieur. En agissant sur ces dimensions, il devient possible de transformer durablement notre rapport à nous-mêmes et au monde. Ainsi, la psychomotricité agit comme un pont entre le corps et la vie psychique : elle aide chacun à restaurer une unité intérieure, à retrouver de la fluidité dans ses mouvements comme dans ses pensées, et à renouer avec une forme d’harmonie personnelle.
Le rôle du psychomotricien consiste alors à observer et à accompagner la manière dont une personne habite son corps : sa façon de bouger, la qualité de son tonus — trop tendu ou trop relâché —, sa présence dans l’espace et dans le temps. Ces éléments, en apparence ordinaires, constituent pourtant des clés essentielles pour comprendre et restaurer l’équilibre psychique.
Vers une approche intégrative de la santé mentale
La psychomotricité rappelle une évidence que les sciences redécouvrent peu à peu : nous ne sommes pas qu’un cerveau pensant, mais un corps vivant. Loin d’être un simple support biologique, le corps participe activement à notre équilibre intérieur. Chaque tension musculaire, chaque posture, chaque respiration traduit un état émotionnel, mais peut aussi influencer en retour la sphère psychique. Prendre en compte le schéma corporel — la représentation que nous avons de notre propre corps — et le vécu corporel — la manière dont nous l’habitons au quotidien — ouvre une voie complémentaire dans la prise en charge psychologique et psychiatrique. Là où la psychothérapie s’appuie sur la parole, la psychomotricité invite à passer par le mouvement, la sensation et l’expérience incarnée. Les deux approches se renforcent : travailler sur le corps soutient les processus psychiques, et inversement.
Dans notre monde contemporain, cette perspective devient essentielle. Le stress chronique maintient le corps en état d’alerte permanente, empêchant toute détente. La sédentarité appauvrit les expériences motrices, tandis que la surconnexion numérique mobilise surtout l’attention visuelle et cognitive, au détriment des sensations internes. Peu à peu, nous perdons le lien avec notre corporéité. Face à ce constat, la psychomotricité propose une vision intégrative de la santé mentale, où corps et vie psychique cessent d’être séparés. Elle rejoint des approches convergentes, comme la psychosomatique, la pleine conscience, ou certaines thérapies cognitives enrichies de techniques corporelles.
Cette approche permet de diversifier les points d’appui thérapeutiques : lorsque la parole est difficile — chez l’enfant, la personne âgée ou le patient en grande souffrance —, le corps devient un canal d’expression et de régulation. Elle renforce aussi l’efficacité des prises en charge psychiatriques : les exercices corporels réguliers améliorent le sommeil, réduisent les effets secondaires des traitements et soutiennent l’adhésion au suivi. Enfin, elle aide à s’ancrer dans le présent : sentir ses appuis, respirer, bouger en conscience, c’est déjà contrer la dissociation, l’anxiété ou l’éparpillement mental.
En réintroduisant le corps au cœur du soin, la psychomotricité offre une clé précieuse pour restaurer équilibre, bien-être et présence à soi. Elle ne remplace pas les autres approches, mais les complète, rappelant que la santé mentale est avant tout une affaire d’unité retrouvée — celle d’un psychisme incarné dans un corps reconnu comme ressource.
Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à lutter contre vos pensées, laissez votre corps vous souffler une autre voie : un étirement, une marche, une respiration profonde. Vous serez surpris de voir à quel point le chemin du mieux-être peut aussi passer par ce dialogue intime et discret avec votre propre chair.
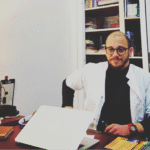
Saad Chraibi
Psychomotricien
• Diplômé de l’Université Mohammed VI à Casablanca, exerçant en libéral dans son propre cabinet à Casablanca (Maroc).
• Adopte une approche globale et intégrative, prenant en compte les dimensions corporelle, psychique, émotionnelle et relationnelle de la personne.
• Ancien étudiant en médecine (4 années), disposant d’une solide formation biomédicale et d’une rigueur clinique intégrée à sa pratique psychomotrice.
• Expérience professionnelle diversifiée : structures associatives, exercice libéral, travail interdisciplinaire avec orthophonistes, psychologues, neuropsychologues.
• Spécialisé dans l’adaptation des prises en charge à des profils variés, avec une forte orientation vers le travail en réseau.
• Investi dans des projets thérapeutiques personnalisés, fondés sur des évaluations précises et respectueux du rythme, de l’histoire et du potentiel de chaque patient, quel que soit son âge.