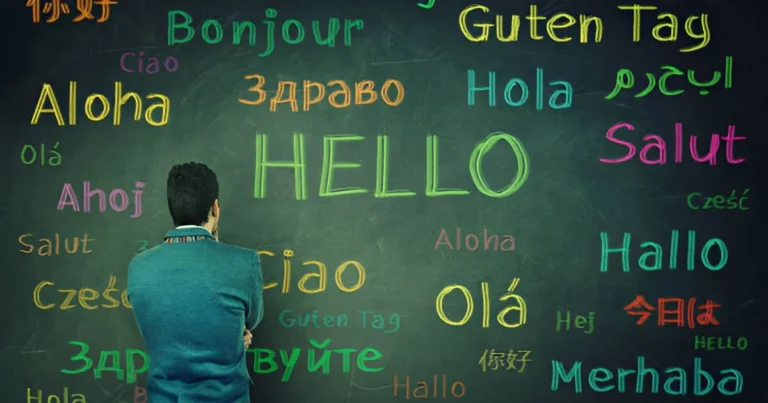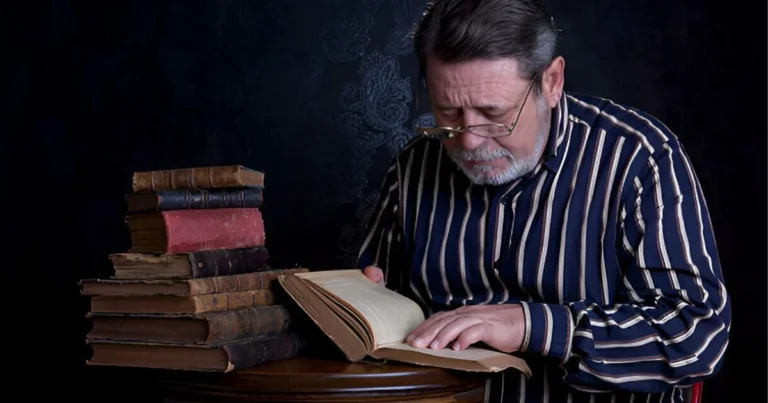Quand la souffrance devient divertissement: De Rhythm 0 au trash streaming
Le 18 août 2025, Jean Pormanove s’éteint sous l’œil des caméras, après près de trois cents heures de diffusion continue sur la plateforme Kick. À 46 ans, il incarne malgré lui le symbole d’un basculement inquiétant de notre société numérique. Depuis plusieurs mois, il subissait des humiliations publiques, des insultes, des privations de sommeil et des violences physiques infligées par ses comparses streamers. Sa mort ne peut être considérée comme un simple fait divers, car elle cristallise l’érosion progressive de l’empathie dans un univers où la souffrance devient spectacle et où l’humiliation se convertit en marchandise. L’affaire Pormanove interroge notre capacité à préserver une réponse empathique face à des logiques économiques et médiatiques qui transforment la douleur en ressource lucrative et la dignité humaine en divertissement numérique.
Le trash streaming : La douleur comme marchandise
Le cas Pormanove s’inscrit dans un phénomène baptisé « trash streaming ». Cette pratique, apparue dans les années 2010 en Russie et en Pologne, consiste à diffuser en direct des actes humiliants, choquants ou violents, destinés à attirer l’attention et à générer des revenus. Le spectateur n’est plus seulement un témoin passif : il interagit, incite les streamers à repousser les limites et finance ces scènes par des dons. La douleur d’autrui devient alors une ressource, l’humiliation un moteur de performance, la dignité un objet de transaction.
Guy Debord, dès 1967 dans La Société du spectacle, mettait en garde contre la marchandisation des existences humaines transformées en représentations. Aujourd’hui, le numérique donne à ce mécanisme une intensité inédite. Diffusion planétaire, immersion en temps réel et interaction directe transforment ce qui relevait d’un avertissement théorique en une réalité économique, amplifiée par des plateformes dont la modération reste minimale.
🔗 À lire aussi : Labubu : Le petit monstre à la mode
Cruauté et empathie : Ce que l’art avait déjà montré
Bien avant l’ère numérique, l’artiste Marina Abramović avait pressenti ce basculement. En 1974, lors de sa performance Rhythm 0, elle s’installe immobile sur scène, offrant au public 72 objets à utiliser sur elle : une rose, une plume, du pain… mais aussi une lame de rasoir, des ciseaux, et même un revolver chargé. Pendant six heures, chacun est libre d’agir à sa guise. Au début, les gestes sont bienveillants. Mais rapidement, la curiosité se mue en cruauté : on déchire ses vêtements, on entaille sa peau, on pointe l’arme sur elle. Lorsque la performance prend fin et qu’Abramović reprend ses mouvements, les spectateurs, soudain confrontés à la réalité de leurs actes, détournent le regard.
Cette scène met en lumière des mécanismes que la psychologie sociale décrit avec précision. La désindividuation, d’abord, fait disparaître le sentiment de responsabilité dans un contexte collectif. La désensibilisation progressive conduit ensuite à franchir des seuils de violence de plus en plus élevés. La déshumanisation transforme enfin la personne en simple objet d’expérimentation. Et le clivage empathique explique pourquoi l’absence de réaction de la victime suspend la compassion, jusqu’à ce qu’un signe de subjectivité ramène brutalement le malaise.
Ce qui s’est joué dans un théâtre napolitain en 1974 se rejoue aujourd’hui dans l’espace numérique. Comme les spectateurs de Rhythm 0, les internautes du trash streaming se retrouvent happés par une dynamique où la souffrance devient divertissement et où la dignité humaine se dissout dans le spectacle. L’art avait déjà mis en scène, à échelle réduite, ce que le numérique allait amplifier à l’échelle mondiale : l’érosion de l’empathie lorsque la douleur se transforme en marchandise.
🔗 Découvrez également : Identité sous influence : Le soi social à l’ère numérique
Le cerveau face à la souffrance
Si ces contenus extrêmes séduisent un public croissant, c’est qu’ils s’appuient sur des ressorts profondément enracinés dans la psychologie humaine. Le chercheur Coltan Scrivner, de l’Université de Chicago, a développé la Morbid Curiosity Scale pour mesurer l’attirance des individus envers des scènes macabres. Observer la douleur ou le danger avait autrefois une valeur adaptative : anticiper les menaces, mieux se préparer à survivre. Dans le monde moderne, cette curiosité s’exprime le plus souvent à travers la fiction : séries criminelles, documentaires macabres, films d’horreur. Mais transposée à des situations où la souffrance est réelle et vécue en direct, elle franchit une frontière éthique et psychologique.
Les travaux de Marvin Zuckerman sur les personnalités « en quête de sensations », ainsi que ceux de la chercheuse Suzanne Oosterwijk à Amsterdam, permettent de mieux comprendre pourquoi certaines personnes sont attirées par des images choquantes. Pour Zuckerman, certains individus ont un besoin constant de nouveauté, d’intensité et de stimulation. Ce profil psychologique les pousse à rechercher des expériences fortes, qu’il s’agisse de sports extrêmes, de conduites à risque ou de contenus violents. Leur cerveau réclame davantage de stimulation que celui d’autres personnes, un peu comme si leur seuil d’excitation était plus élevé.
Cette recherche d’intensité est liée au système de la dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir, à la récompense et à la motivation. Lorsqu’on est exposé à une expérience intense, le cerveau libère de la dopamine, produisant une forme de « pic » émotionnel qui donne envie de recommencer. C’est ce mécanisme qui peut transformer certains comportements en habitudes, voire en dépendances.
Les travaux d’Oosterwijk montrent que le visionnage d’images choquantes active deux régions précises du cerveau. Le striatum est impliqué dans le désir d’obtenir une expérience : il agit comme un moteur qui pousse à regarder, même si l’expérience est désagréable. L’insula antérieure, quant à elle, joue un rôle clé dans l’anticipation émotionnelle et la gestion de l’incertitude, elle nous prépare à ressentir des émotions fortes, positives ou négatives. Ce mélange de désir et d’incertitude explique pourquoi certaines personnes reviennent vers des contenus dérangeants. Ce n’est pas malgré le malaise qu’ils provoquent, mais justement à cause de lui. L’inconfort devient une source d’excitation, parce qu’il bouscule, surprend et intensifie l’expérience. Pour certains spectateurs, le malaise est donc recherché, presque comme une forme de frisson addictif.
🔗 À lire aussi : Quand l’IA pense comme un cerveau
Le problème surgit lorsque cette dynamique s’applique à des souffrances réelles. Plusieurs études ont montré que l’exposition répétée à des violences vécues et diffusées en direct entraîne une baisse progressive de l’empathie. La douleur devient un élément banal du paysage visuel. Cette désensibilisation pousse les streamers à repousser sans cesse les limites, intensifiant la brutalité pour capter l’attention d’un public saturé. La question n’est pas seulement individuelle, mais collective. Les plateformes, par leur modération minimale, favorisent la diffusion de contenus extrêmes. Les spectateurs, par leurs dons et leurs commentaires, participent activement à ce système. L’humiliation n’est plus seulement vue, elle est financée, encouragée et transformée en produit interactif.
Préserver l’empathie face à l’économie de l’humiliation
L’affaire Pormanove constitue un signal d’alarme. Elle révèle la fragilité de l’empathie dans un monde où la douleur est monétisée. Elle rappelle que la compassion est une construction mentale, sociale et culturelle qu’il faut protéger. Préserver l’empathie n’est donc pas un simple idéal moral, c’est une nécessité pour maintenir le socle de la vie en commun.
À l’ère du numérique, où tout peut devenir spectacle, l’enjeu est d’empêcher que le voyeurisme prenne le pas sur la compassion. Le drame de Jean Pormanove doit servir de catalyseur pour repenser nos pratiques, éduquer aux images et rappeler que la dignité humaine n’est pas négociable. C’est à cette condition seulement que la vie pourra continuer à être perçue comme ce qu’elle est : un bien inestimable, digne de respect et de protection.
Références
Oosterwijk, S., Snoek, L., Tekoppele, J. et al. Choosing to view morbid information involves reward circuitry. Sci Rep 10, 15291 (2020).
Scrivner, C. (2021). The psychology of morbid curiosity: Development and initial validation of the Morbid Curiosity Scale. Personality and Individual Differences, 183, Article 111139.