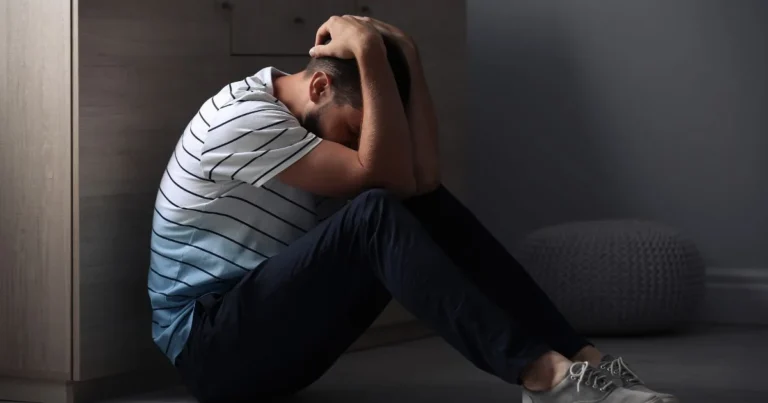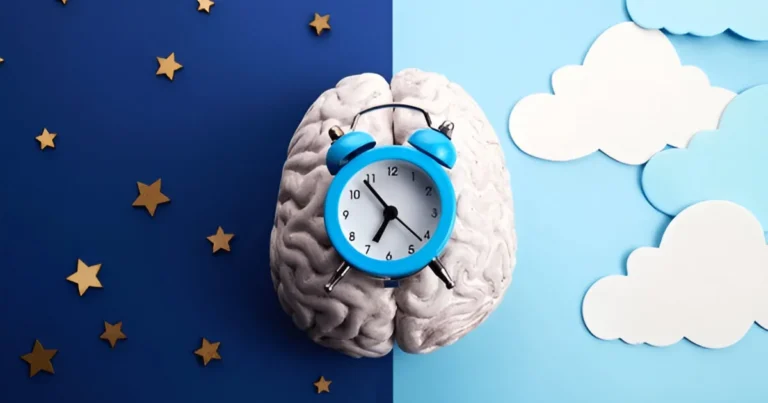Et si le bonheur retardait le déclin cognitif ?
La prévention du déclin cognitif s’impose aujourd’hui comme un enjeu majeur de santé publique. Avec l’allongement de l’espérance de vie, les cas de démence progressent et les chercheurs cherchent à identifier les leviers capables de protéger le cerveau. Les facteurs de risque, tels que la dépression ou l’anxiété, sont désormais bien établis. En revanche, les effets protecteurs du bien-être psychologique restent encore dans l’ombre.
Ce bien-être ne se limite pas à l’absence de troubles mentaux : il reflète un état positif, nourri par l’autonomie, le sentiment de contrôle, le plaisir et la capacité à trouver un sens à ses activités. Plusieurs études suggèrent qu’il pourrait influencer directement le vieillissement cognitif, réduisant la vulnérabilité aux troubles de mémoire et, à plus long terme, à la démence. Pourtant, rares étaient jusqu’à récemment les recherches menées sur de larges cohortes et sur une durée suffisamment longue pour en mesurer l’impact réel.
Bien-être et cognition : un lien longtemps sous-estimé
En 2025, une équipe internationale dirigée par Amber John, à l’University College London et à l’Université de Liverpool, a publié une étude majeure dans la revue Aging & Mental Health afin d’évaluer l’influence du bien-être psychologique sur la mémoire au fil du temps. S’appuyant sur la cohorte de l’English Longitudinal Study of Ageing (ELSA), les chercheurs ont suivi plus de 10 700 personnes âgées de 50 ans et plus, sans diagnostic initial de démence, pendant seize ans. À neuf reprises, les participants ont été invités à répondre à l’échelle CASP-19, qui mesure différents aspects du bien-être tels que l’autonomie, le plaisir, le sentiment de contrôle et l’épanouissement personnel, et à réaliser des exercices de mémoire consistant à rappeler immédiatement puis après un délai une liste de mots.
Les données ainsi recueillies ont été analysées grâce à des modèles statistiques capables de tester la direction du lien entre bien-être et mémoire, tout en contrôlant l’influence de variables comme l’âge, le sexe, l’éducation, l’origine ethnique et les symptômes dépressifs. Les résultats de cette étude montrent qu’un niveau élevé de bien-être est associé de façon constante à de meilleures performances mnésiques ultérieures, avec un effet certes modeste mais robuste et observé sur toute la durée de l’étude. En revanche, de bonnes performances de mémoire n’entraînent pas nécessairement une amélioration du bien-être par la suite, ce qui suggère que le bien-être agit davantage comme un facteur protecteur de la mémoire, tandis que l’influence inverse n’apparaît clairement que dans le contexte d’un déclin cognitif pathologique.
🔗 À lire aussi : Synapses en souffrance : Comprendre la dégénérescence fronto temporale
Pourquoi le bien-être protège-t-il la mémoire ?
Plusieurs mécanismes peuvent expliquer l’effet protecteur du bien-être sur la mémoire. Sur le plan biologique, un état psychologique positif est associé à une meilleure santé cardiovasculaire et à une réduction de l’inflammation, deux facteurs intimement liés au maintien des fonctions cérébrales. Sur le plan comportemental, les personnes qui se sentent bien dans leur vie adoptent plus volontiers des habitudes favorables : activité physique régulière, relations sociales stimulantes, sommeil de qualité. Autant d’éléments qui soutiennent directement les capacités cognitives et participent à leur préservation avec l’âge.
Une autre hypothèse mérite d’être prise en compte : un faible niveau de bien-être pourrait être l’un des premiers signaux d’une vulnérabilité cognitive encore silencieuse, se manifestant avant même l’apparition de troubles objectivables. Cette possibilité souligne l’importance d’examiner le bien-être non seulement comme un facteur protecteur, mais aussi comme un indicateur précoce de risque.
🔗 Découvrez également : Le coût invisible de la fatigue cognitive
En définitive, l’étude ELSA met en lumière un message simple mais puissant : le bien-être psychologique compte dans la santé du cerveau. Vivre avec un sentiment de satisfaction, d’autonomie et de plaisir ne garantit pas l’absence de déclin cognitif, mais augmente les chances de préserver sa mémoire au fil des années. Ce constat invite à repenser la prévention : au-delà des marqueurs biologiques et des habitudes de vie, c’est aussi la qualité subjective de l’existence qui soutient la résilience cognitive.
Référence
John, A., Desai, R., Eshetu, A., Willroth, E., Marchant, N., Woodward-Carlton, B., … Stott, J. (2025). Wellbeing and memory function: Testing bidirectional associations in the English Longitudinal Study of Ageing (ELSA). Aging & Mental Health. Advance online publication.