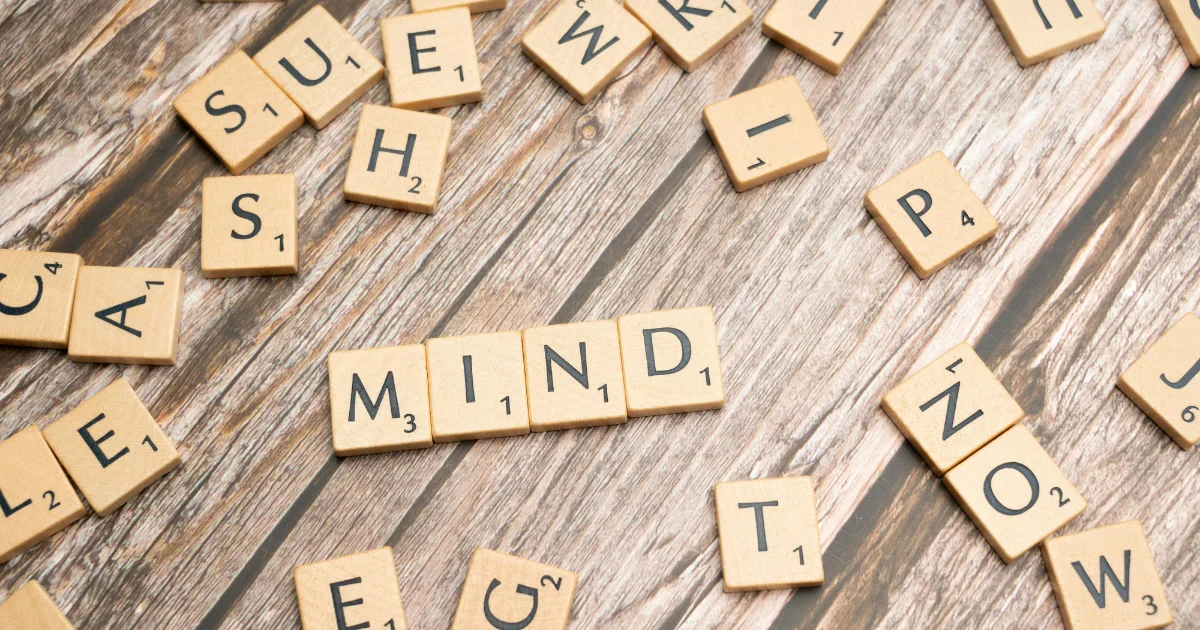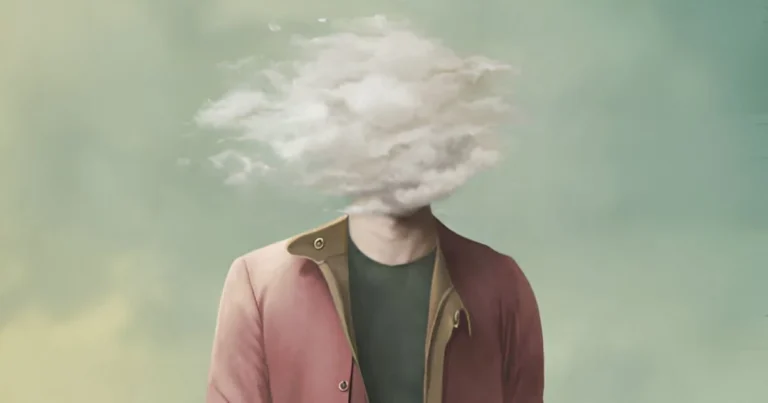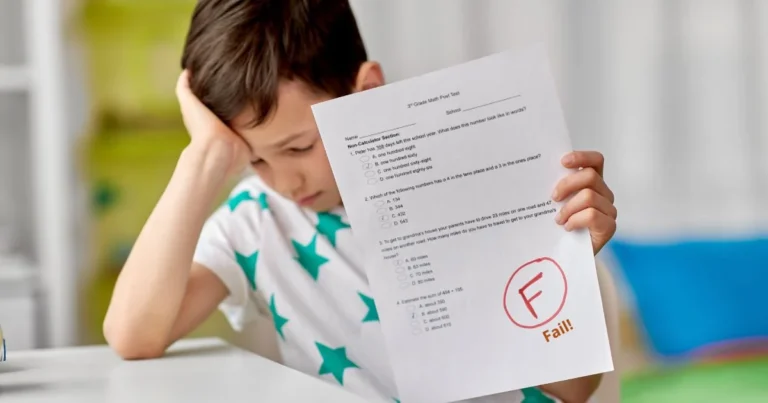Lire sans parler : La littératie invisible des autistes
L’absence de parole fonctionnelle chez certaines personnes autistes entraîne souvent une sous-estimation globale de leurs capacités cognitives et linguistiques. Cette perception repose sur une confusion entre langage et production orale, comme si l’absence de mots prononcés équivalait à une absence de langage intérieur ou de compréhension. Pourtant, plusieurs travaux récents invitent à éviter cette vision réductrice. Des compétences en lecture et en orthographe peuvent bel et bien se développer en dehors de l’usage fluide de la parole. Dès lors, une interrogation majeure se pose : comment évaluer la littératie lorsque les voies traditionnelles de communication sont inaccessibles, et quelles conséquences une telle évaluation peut-elle avoir pour l’éducation et l’inclusion sociale ?
En 2024, une équipe dirigée par Vikram K. Jaswal, à l’Université de Virginie, publie dans la revue Autism une recherche qui change la donne. Les scientifiques s’intéressent à 31 adolescents et adultes autistes, âgés de 15 à 52 ans, tous sans parole fonctionnelle malgré de longues années de rééducation orthophonique. Beaucoup utilisent un tableau de lettres avec l’aide d’un assistant, une méthode controversée mais courante pour communiquer.
Pour contourner les biais liés à la production orale ou écrite, les chercheurs mettent au point un test simple sur iPad. Les participants doivent appuyer rapidement sur des lettres ou des symboles qui s’illuminent en séquence. Certaines séries de lettres forment de véritables phrases, prononcées à voix haute juste avant la tâche, tandis que d’autres ne correspondent à rien de lisible. Ce dispositif permet de mesurer si les réactions sont plus rapides face à des séquences ayant du sens, ce qui indiquerait une reconnaissance orthographique.
L’analyse des données confirme cette hypothèse. Les participants réagissent plus vite aux lettres qui composent des phrases qu’aux séquences dépourvues de logique. Ils appuient également plus rapidement sur les combinaisons de lettres fréquentes dans l’anglais écrit, ce qui témoigne d’une sensibilité aux régularités orthographiques. Enfin, un léger ralentissement apparaît au début de chaque mot, comme si leur cerveau marquait spontanément la frontière entre deux unités lexicales. Pris ensemble, ces trois indices montrent que de nombreuses personnes autistes sans parole possèdent bel et bien des bases en littératie, même si elles ne peuvent pas les manifester de façon traditionnelle.
🔗 À lire aussi : Réveiller le cerveau par les mots : Les effets insoupçonnés du bilinguisme tardif
Ce que la science nous dit du cerveau
Ces observations montrent que les circuits cérébraux liés à la lecture peuvent se développer indépendamment des réseaux moteurs de la parole. Le gyrus fusiforme, une région du lobe temporal spécialisée dans la reconnaissance des mots, semble fonctionner normalement, même en l’absence de communication orale. Autrement dit, la limite n’est pas dans la compréhension du langage écrit, mais dans la capacité à l’exprimer par la voix.
Un autre aspect qui renforce cette idée, est la sensibilité aux associations fréquentes de lettres. Le cerveau apprend à repérer des régularités statistiques dans les séquences de lettres, un mécanisme fondamental de l’acquisition de la lecture. Le fait qu’il soit présent chez les personnes autistes non parlantes montre qu’elles intègrent ces régularités, comme tout lecteur en devenir.
Ces données ont un impact direct sur la manière d’enseigner. Trop souvent, l’absence de parole conduit à limiter l’accès à des contenus scolaires avancés. Les élèves sont orientés vers des activités simplifiées, alors qu’ils pourraient bénéficier d’une stimulation plus riche si leurs compétences étaient reconnues. Les travaux de Jaswal et de son équipe rappellent l’importance d’évaluer autrement, avec des méthodes qui ne reposent pas sur l’expression orale.
Cela suppose d’élargir l’éventail d’outils pédagogiques. Tablettes tactiles, logiciels de lecture silencieuse ou entraînements progressifs à la saisie de mots peuvent offrir des alternatives précieuses. L’enjeu est de ne pas réserver ces outils à un usage thérapeutique isolé, mais de les intégrer aux parcours scolaires, afin de permettre un véritable accès au savoir.
🔗 Découvrez également : Du spectre à la chute : L’étrange fil rouge entre autisme et Parkinson
La reconnaissance d’une littératie cachée ne se limite pas à une découverte académique. Elle remet en cause des décennies de présupposés éducatifs et cliniques. Elle invite aussi à repenser la place des personnes autistes non parlantes dans la société. Pouvoir lire et écrire, même de manière partielle, ouvre la voie à de nouvelles formes d’autonomie et de participation sociale.
Les prochaines étapes pour la recherche consistent à comprendre comment ces compétences émergent, quelles conditions les favorisent et comment les technologies peuvent aider à les transformer en moyens de communication autonomes. Mais le message essentiel est déjà là : le silence ne signifie pas l’absence de langage. Reconnaître et exploiter cette littératie invisible n’est pas seulement une avancée scientifique, c’est un impératif éducatif et social.
Référence
Jaswal, V. K., Lampi, A. J., & Stockwell, K. M. (2024). Literacy in nonspeaking autistic people. Autism, 28(10), 2503-2514.