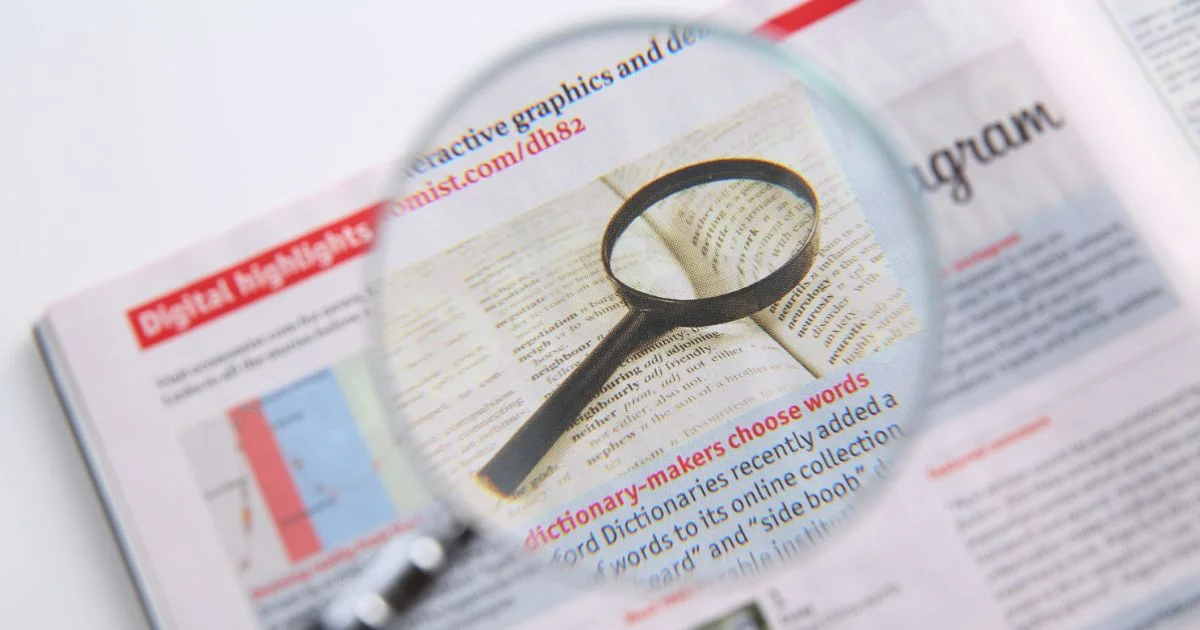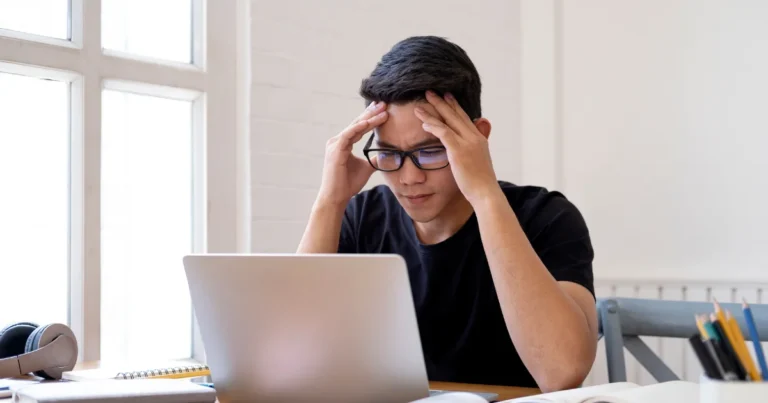L’information : Du chant de la huppe au chaos numérique
“Il existe, loin d’ici, un vaste royaume régi par une reine vénérée par son peuple. Mais ce royaume, s’il baigne dans l’opulence, baigne aussi dans l’obscurité ». Telle est l’information rapportée par la huppe, en réponse au roi-prophète Soulaymen qui s’étonnait de son absence. Elle n’apporte ni plume ni offrande. Elle livre un récit. Une donnée, apparemment banale, mais lourde de conséquences. Dès lors, l’information n’est plus un détail. Elle est dévoilement, déclenchement et acte.
Ce que la tradition raconte, les siècles suivants vont le décliner en silence, en rumeur, en codage. L’information devient message, puis signal, puis arme. En 1961, un haut responsable soviétique, figure du GRU, franchit la ligne et communique avec le FBI et la CIA. Ce qu’il livre n’est pas un acte de trahison, c’est une bascule idéologique. Il dévoile. Il fracture. L’information ici n’est plus passive. Elle agit. Elle transforme. Elle annonce la fin d’une époque où l’information était bulletin, et l’ouverture d’une autre où elle devient arme et stratégie.
Ainsi, derrière chaque information se dissimule une réorganisation du monde. Une donnée, en apparence anodine, interroge, reconfigure, ébranle, et peut suffire pour tout faire vaciller. l’information, loin d’être un simple contenu, est un acte. Un acte qui interpelle, un acte qui bouleverse l’ordre.
De la trace intérieure à l’instrument de pouvoir
Depuis ces scènes originelles, l’information n’a cessé de se métamorphoser. Elle fut d’abord chuchotement sacré, puis ordre royal, puis nouvelle imprimée. Aujourd’hui, elle est pixel, flux, données. Elle ne frappe plus à la porte, elle surgit de partout. Une notification, un scroll, un flash. Mais qu’est-ce que l’information, au juste ? Un message ? Un signal ? Un artefact ? Une illusion ? Toutes ces définitions coexistent, se croisent, se contredisent parfois. L’information est à la fois donnée et résultat, message et mise en scène, neutre et subjective.
Le mot vient du latin « informatio », désignant à l’origine l’action de donner forme, de modeler. Avant d’être un contenu, elle était empreinte. Formation de l’esprit. Ce glissement — de la structuration intérieure à la transmission — éclaire son ambiguïté. Car l’information est à la fois ce que l’on reçoit et ce qui nous transforme. Une empreinte et un pouvoir discret.
Ce mot que l’on consomme, que l’on produit, que l’on brandit, sans jamais l’épuiser, est tour à tour contenu, vecteur, signal, illusion. Elle est donnée, mais aussi un produit fini. Réception, mais aussi interprétation. Ce que Gilbert Simondon exprime avec élégance : l’information n’est pas une chose, mais l’opération d’une chose dans un système. Une altération signifiante. Une brèche dans la continuité.
🔗 À lire aussi : Brain Rot : L’effet insidieux du contenu instantané sur notre fonctionnement mental
On l’oublie souvent : l’information n’existe jamais seule. Elle est produite par un œil, reçue par un cerveau, traitée par une conscience, interprétée par une culture. Elle est donc toujours sociale, subjective, contextuelle. Comme le rappelait Foucault, elle est filtrée. Ce que l’on voit, ce que l’on dramatise, ce que l’on efface : tout participe d’une architecture de pouvoir.
Informer, c’est ordonner le réel. Hiérarchiser. Choisir. Et donc exclure. L’information n’est jamais neutre. Elle est toujours chargée.
Saturation numérique et brouillage cognitif
Longtemps, elle fut privilège : espion, diplomate, homme d’État, politicien et stratège. Ce n’était pas tant la vérité qui comptait, que son usage. Aujourd’hui, elle est partout. Elle surgit en push sur nos écrans, déguisée en post, notification, suggestion. Elle ne nous attend plus. Elle nous devance. Et pourtant, elle reste insaisissable. Car ce n’est pas la quantité qui libère, c’est la capacité à discerner.
Le cerveau humain, disait Kahneman, oscille entre deux systèmes : l’un rapide, émotionnel ; l’autre lent, analytique. Dans un monde saturé, c’est le premier qui réagit. Il veut du connu, du confirmé. Il consomme l’information comme un anxiolytique : pour être rassuré, non pour comprendre.
Les neurosciences le confirment : sous stress cognitif, l’humain ne pense pas. Il répète. Il simplifie. Il se raccroche à des schémas. L’information devient un miroir déformant, non plus ouverture, mais confirmation de ses peurs.
Dans ce brouillard, l’information peut devenir poison. Les fake news prospèrent sur la fatigue, sur l’abandon de l’effort critique. Les bulles cognitives deviennent des forteresses. Le récit devient identité. Les algorithmes renforcent ce biais. Ils montrent ce que nous aimons déjà. Ils effacent le doute. Et le doute, pourtant, est le cœur même de la connaissance.
🔗 Découvrez également : L’identité confisquée
Ce n’est donc plus seulement de médias qu’il faut parler, mais d’écologie mentale. L’information devient enjeu de bien-être. Elle pénètre notre cortex, module nos croyances, affecte notre perception du monde. Informer, c’est agir sur l’émotion, sur la représentation.
L’information et le cerveau : Surcharge et survie
S’informer, ce n’est pas seulement recevoir un fait. C’est l’accueillir, le filtrer, le digérer. C’est lui accorder une place, là, dans les replis de notre émotion, de nos peurs, de notre fatigue. Car l’information ne touche pas que l’intellect : elle pénètre l’être.
Ce que les neurosciences confirment aujourd’hui, la sagesse populaire le pressentait déjà : trop d’information tue l’information. Trop de sons, trop d’images, trop d’avis. Trop d’urgences numériques. Bref, trop de tout épuise.
La loi de Miller nous le rappelle : notre mémoire de travail ne peut contenir que sept éléments, plus ou moins deux. Au-delà, le système déborde, sature, puis cède. La charge cognitive devient trop lourde. On perd en clarté, en logique, en discernement.
Le cerveau bascule alors dans le rapide, l’automatique, ce que Kahneman nomme le « système 1 ». On ne vérifie plus. On réagit. On partage. Les applications le savent, les plateformes s’y adaptent. Chaque notification est une secousse : dopamine si elle plaît, cortisol si elle inquiète. Les deux, en excès, fatiguent. L’attention devient fragment. L’émotion devient marchandise.
On croyait l’information objet de liberté. Elle devient outil d’usure. Loin de déployer notre pensée, elle l’épuise. On parle d’infobésité, de stress informationnel. L’écran veille, l’esprit flâne, mais le corps encaisse.
Alors, on cherche des raccourcis. Des récits simples. Des coupables. Des signes. Là encore, l’information glisse : de la vérité vers la croyance. Non plus ce qui est, mais ce qui rassure. Le complotisme n’est pas seulement une pathologie sociale : c’est une médecine de la peur, un anxiolytique narratif.
Et pourtant, l’information peut également soigner. Quand elle éclaire sans asséner. Quand elle révèle sans harceler. Quand elle laisse place au doute, à la nuance, à l’inachèvement. Il y a une éthique de l’information, comme il y a une éthique de la parole. Savoir quand dire, comment dire, et parfois, savoir taire.
Car s’informer, aujourd’hui, c’est aussi savoir se protéger. C’est un acte de soin. Pour soi, pour les autres. Une hygiène mentale. Une respiration. Et peut-être, une forme de sagesse.
🔗 En lien avec ce sujet : Idéologie : Une métamorphose existentielle des structures mentales
Informer, c’est dominer : L’algorithme comme nouvel empire
Le journalisme l’avait compris, dès le Watergate. Quand l’information perce, elle renverse. Mais ce pouvoir est double. Ce qui révèle peut manipuler. Ce qui informe peut déformer.
L’information est un pharmakon. Elle soigne et elle infecte. Elle éclaire et elle aveugle. Son pouvoir dépend moins de sa véracité que de son régime de circulation. Une vérité ignorée ne sert à rien. Un mensonge bien véhiculé peut tout défaire.
Ce régime, aujourd’hui, s’appelle algorithme. Derrière chaque fil, une métaphysique : celle de l’engagement, du clic, du temps d’attention. Et donc, de la valeur. Nous sommes entrés dans un capitalisme de l’information, où chaque donnée est un actif, chaque comportement une monnaie, chaque décision une anticipation.
Shoshana Zuboff l’a montré : ce n’est plus l’humain qui pense le monde. C’est l’information qui pense pour lui. Et elle pense selon des intérêts : commerciaux, stratégiques, politiques. Il ne s’agit plus de savoir, mais de capter. Et donc de formater.
Dans ce contexte, l’éducation devient résistance. Apprendre à lire, à douter, c’est restaurer une autonomie. Introduire de la lenteur dans la vitesse. Du recul dans l’immédiat. Du silence dans le vacarme.
Car celui qui contrôle l’information contrôle les perceptions. Et donc les émotions. Et donc les choix. L’information ne sert pas à connaître. Elle sert à faire croire. Elle est croyance. Elle est récit. Elle est foi. Et cela, les stratèges l’ont toujours su. La victoire commence par une image. Un mot. Une donnée.
Penser l’information, ce n’est pas réfléchir à la vérité. C’est interroger nos liens au monde. Notre façon de voir. Notre capacité à résister au flux. C’est choisir, consciemment, ce que l’on reçoit. Et ce que l’on refuse.
C’est, peut-être, retrouver la sagesse de la huppe : ne pas parler pour parler. Mais parler quand il faut. Et dire ce qui compte. Car une information peut éclairer un empire. Ou le faire tomber.
Références
Bob Woodward & Carl Bernstein (1974). All the President’s Men. Simon & Schuster.
Christopher Andrew & Vasili Mitrokhin (1999). The Mitrokhin Archive. Penguin Books.
Daniel Kahneman (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.
George A. Miller (1956). « The Magical Number Seven, Plus or Minus Two ». Psychological Review, 63(2), 81–97.
Gilbert Simondon (1969). Du mode d’existence des objets techniques. Aubier.
Jacques Ellul (1962). Propagandes. Armand Colin.
Marshall McLuhan (1964). Understanding Media. MIT Press.
Michel Foucault (1975). Surveiller et punir. Gallimard.
Paul Virilio (1995). La vitesse de libération. Galilée.
Shoshana Zuboff (2019). The Age of Surveillance Capitalism. PublicAffairs.

Ahmed El Bounjaimi
Concepteur-rédacteur
Master en communication des organisations, université Hassan II.
Licence en philosophie de communication et champs publics, université Hassan II.