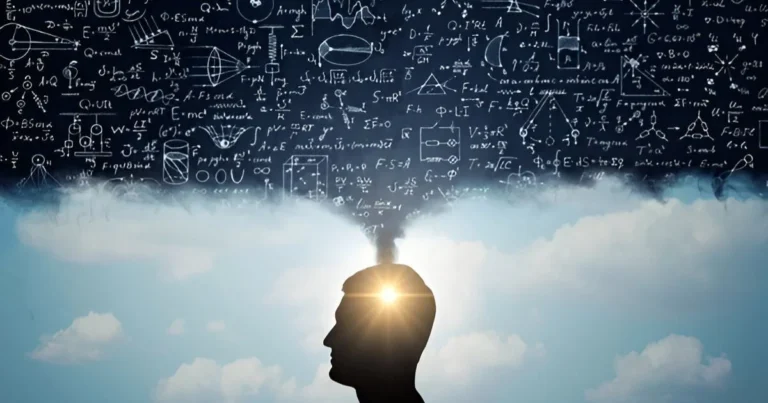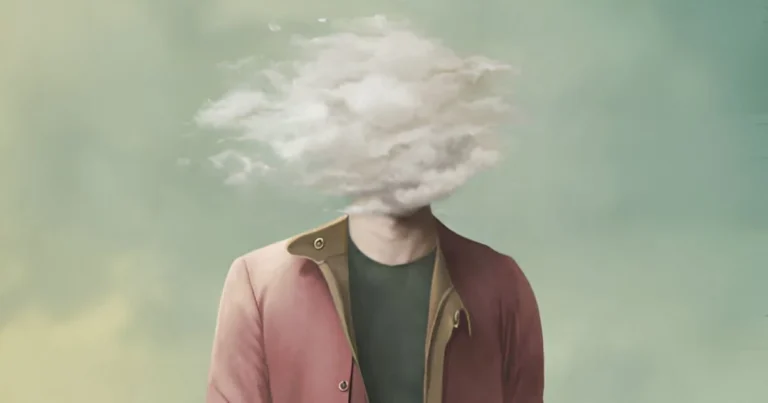Quand l’IA pense comme un cerveau
L’intelligence artificielle (IA) progresse à une vitesse fulgurante, mais ses succès reposent encore sur une logique très différente de celle du cerveau humain. Les réseaux de neurones artificiels les plus puissants exigent des milliards de paramètres et d’énormes volumes de données pour accomplir des tâches spécifiques. À l’inverse, le cerveau humain apprend avec peu d’exemples, s’adapte rapidement à des environnements changeants et reste efficace face à l’incertitude. Rapide, économe et souple, il incarne une forme d’intelligence profondément contextuelle.
Cette différence de nature soulève une question essentielle : peut-on imaginer une IA qui ne se contente pas d’imiter nos performances, mais qui s’inspire des principes mêmes qui gouvernent notre fonctionnement neuronal ? Pour y répondre, une équipe américaine de chercheurs, réunissant des institutions comme Rutgers, le MIT, Yale et l’Université du Nebraska-Lincoln, a franchi une étape décisive. Dans une étude parue dans Nature Communications (2022), ils ont montré qu’il est possible de construire des modèles computationnels directement à partir de données cérébrales humaines, donnant naissance à une IA “neuro-inspirée” qui reflète la logique interne du cerveau.
L’approche neuro-inspirée : au-delà de la performance brute
Depuis leur création, les réseaux artificiels ont été conçus pour maximiser la performance : reconnaissance d’images, traduction automatique, prédiction de texte. Leur efficacité est indéniable, mais leur rigidité reste problématique. Changer légèrement les conditions d’une tâche peut suffire à les déstabiliser, là où un humain réajuste sans effort ses réponses.
Cette fragilité s’explique par la manière dont ces modèles sont construits. Ils ne respectent pas les contraintes biologiques du cerveau : connectivité limitée, coûts métaboliques, ou encore topologie particulière des réseaux neuronaux. Pour dépasser ces limites, certains chercheurs proposent une approche différente : intégrer la logique propre du cerveau, non pas seulement comme une métaphore, mais comme une architecture réelle.
🔗 À lire aussi : Quand la pensée remplace le clavier
C’est ici que la notion de connectivitéfonctionnelle entre en jeu. Grâce à l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), il est possible d’observer quelles régions cérébrales s’activent ensemble et comment elles échangent de l’information, aussi bien au repos que lors de tâches complexes. Cette cartographie dynamique, bien plus que la simple anatomie des fibres nerveuses, offre une clé pour comprendre la flexibilité du cerveau.
Quand le cerveau devient une matrice pour l’IA
Les chercheurs américains ont utilisé cette connectivité fonctionnelle pour construire ce qu’ils appellent un Empirical Neural Network (ENN) un réseau neuronal artificiel dont l’architecture est directement dérivée des données cérébrales humaines. Plutôt que de définir arbitrairement des couches et des connexions, ils ont identifié, à partir d’IRMf, les régions du cerveau responsables de différents aspects d’une tâche cognitive : perception sensorielle, règles contextuelles, réponses motrices.
Un élément central de leur modèle réside dans les “conjunction hubs”, des zones qui intègrent plusieurs types d’informations : les règles d’une tâche, les stimuli sensoriels et les réponses attendues. Ces hubs jouent le rôle de carrefours computationnels, permettant au cerveau – et au modèle – de transformer des entrées diverses en comportements adaptés.
Leur expérience reposait sur une tâche de contrôle cognitif appelée C-PRO (Concrete Permuted Rule Operations). Les participants devaient appliquer des règles logiques, sensorielles et motrices à des stimuli visuels et auditifs variés. En utilisant les données d’IRMf recueillies pendant cette tâche, les chercheurs ont construit un réseau capable de simuler le flux d’activité entre régions cérébrales et de prédire les réponses motrices attendues.
Les résultats sont impressionnants : sans passer par un entraînement classique fondé sur des millions d’exemples, l’ENN parvenait à générer des prédictions au-dessus du hasard concernant les réponses des participants. Autrement dit, la seule architecture issue du cerveau humain suffisait à implémenter des transformations computationnelles flexibles.
🔗 Découvrez également : Le cerveau quantique : Mythe ou réalité ?
Une IA plus souple, plus humaine ?
Ce type de modèle marque une rupture avec l’IA traditionnelle. Là où les réseaux artificiels classiques sont optimisés pour des performances maximales dans des environnements restreints, l’ENN privilégie la souplesse et l’adaptabilité.
Deux éléments expliquent cette différence :
- Les conjunction hubs : leur rôle est crucial. Lorsque les chercheurs les ont supprimés du modèle, les performances s’effondraient. Ces hubs incarnent donc une pièce maîtresse de la flexibilité cognitive.
- Les non-linéarités : en introduisant des fonctions similaires à celles observées dans les neurones, les chercheurs ont montré que le modèle pouvait implémenter une logique conditionnelle, indispensable pour traiter des situations complexes.
Ainsi, même si ces modèles n’égalisent pas encore la rapidité des IA classiques, ils brillent par leur robustesse. Confrontés à des contextes imprévus, ils continuent de fonctionner sans se désorganiser. Une telle capacité de généralisation, qui rapproche l’IA du comportement humain, ouvre une voie vers des systèmes plus fiables et plus durables.
De l’IA à la médecine personnalisée
Ces travaux ne se limitent pas à la conception d’IA plus intelligentes. Ils ouvrent également des perspectives pour la médecine et les neurosciences.
En reproduisant l’organisation réelle du cerveau, les ENN pourraient servir de laboratoiresvirtuels pour tester des hypothèses cliniques. Par exemple, simuler l’effet d’une lésion dans un réseau fonctionnel permettrait de prédire les conséquences d’un accident vasculaire cérébral ou d’une maladie neurodégénérative.
À terme, on peut imaginer une médecinepersonnalisée, en construisant un modèle computationnel à partir de l’IRMf d’un patient, il deviendrait possible de prédire l’évolution de sa pathologie, d’évaluer l’efficacité potentielle d’une thérapie, ou encore d’adapter des neuroprothèses à son profil unique.
🔗 À lire aussi : Brain Rot : L’effet insidieux du contenu instantané sur notre fonctionnement mental
Ainsi, la convergence entre IA et neurosciences ne se réduit pas à une quête de puissance technologique. Elle constitue aussi une chance de mieux comprendre le cerveau humain et d’améliorer la prise en charge médicale. Mais une telle proximité entre l’IA et le cerveau humain interroge. Doit-on chercher à créer des machines qui respectent la logique biologique du vivant, au risque de brouiller les frontières entre naturel et artificiel ?
Une IA qui “pense comme un cerveau” n’est pas nécessairement plus puissante, mais elle est plus contextuelle et humaine dans son fonctionnement. Elle valorise la stabilité, la généralisation à partir de peu d’exemples, et la résistance aux perturbations. Ces qualités sont précieuses dans un monde complexe et incertain, où la performance brute ne suffit pas toujours. Cette démarche oblige à repenser l’orientation de nos recherches : voulons-nous des IA qui surpassent l’homme dans des tâches limitées, ou des IA qui s’accordent à nos rythmes cognitifs et à nos modes d’adaptation ?
Référence
Ito, T., Yang, G.R., Laurent, P. et al. Constructing neural network models from brain data reveals representational transformations linked to adaptive behavior. Nat Commun 13, 673 (2022).