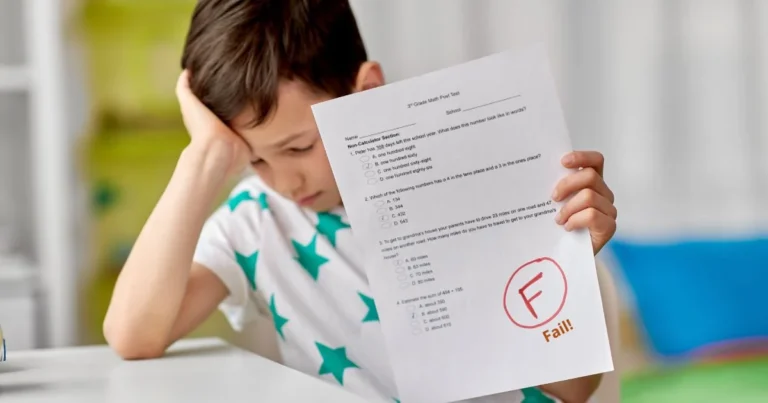Reprogrammer pour guérir : Une avancée majeure contre la maladie de Parkinson
La maladie de Parkinson affecte près de 1 % des personnes âgées de plus de 60 ans. Elle résulte de la dégénérescence progressive des neurones dopaminergiques situés dans la substance noire, une région profonde du cerveau impliquée dans le contrôle des mouvements. Cette perte neuronale entraîne l’apparition de symptômes caractéristiques : tremblements au repos, raideur musculaire, ralentissement moteur et troubles de l’équilibre. Si les traitements actuels à base de dopamine soulagent ces symptômes, leur efficacité s’estompe avec le temps, sans enrayer l’évolution de la maladie.
Face à ces limites, la médecine régénérative ouvre une perspective radicalement nouvelle, non plus compenser les effets de la perte neuronale, mais tenter de la réparer en remplaçant les cellules détruites. Encore faut-il disposer d’une source cellulaire fiable, éthique et capable de restaurer durablement une activité dopaminergique dans le cerveau. C’est précisément ce qu’a tenté une équipe japonaise dirigée par les professeurs Jun Takahashi et Ryosuke Takahashi. Leur essai clinique pionnier, publié dans Nature en mai 2025, marque une étape décisive dans la recherche de traitements curatifs pour la maladie de Parkinson.
🔗 À lire aussi : Du spectre à la chute : L’étrange fil rouge entre autisme et Parkinson
Des cellules reprogrammées pour réparer le cerveau
L’objectif de cette étude était d’évaluer la sécurité et les premiers effets cliniques d’une greffe de cellules dopaminergiques chez des patients atteints de la maladie de Parkinson. Contrairement aux essais précédents basés sur du tissu fœtal, cette approche repose sur des cellules souches dites pluripotentes induites (iPS), obtenues à partir de cellules adultes reprogrammées. Les chercheurs ont utilisé des cellules sanguines prélevées chez un donneur sain, sélectionné pour sa compatibilité avec une grande partie de la population japonaise, afin de limiter les risques de rejet. Ces cellules ont ensuite été transformées en progéniteurs dopaminergiques, les précurseurs des neurones responsables de la production de dopamine. Seules les cellules présentant les bons marqueurs ont été conservées, tandis que celles susceptibles de provoquer des effets indésirables, comme les cellules sérotoninergiques, ont été éliminées.
L’essai s’est déroulé à l’Hôpital Universitaire de Kyoto auprès de sept patients atteints de Parkinson à un stade avancé. Les greffes ont été réalisées avec une grande précision, directement dans le putamen, une région du cerveau essentielle au contrôle des mouvements. Le suivi sur deux ans montre des résultats rassurants : aucun effet secondaire grave n’a été observé. Les rares effets indésirables étaient mineurs et temporaires. L’imagerie cérébrale n’a révélé ni inflammation ni croissance anormale des cellules greffées.
Les données les plus encourageantes concernent la dopamine. Les cellules greffées ont non seulement survécu, mais elles ont aussi produit cette précieuse molécule, essentielle au bon fonctionnement moteur. Cette activité était plus marquée chez les patients ayant reçu une dose plus élevée. Sur le plan clinique, la majorité des patients ont présenté une amélioration de leurs mouvements, même sans traitement médicamenteux. De plus, aucun participant n’a souffert des effets secondaires moteurs, parfois observés lors d’anciennes tentatives de greffe. Les tests menés sur des modèles animaux ont confirmé que ces cellules s’intègrent dans le cerveau et adoptent un comportement proche de celui des neurones dopaminergiques naturels. Ces résultats renforcent l’espoir d’un jour pouvoir proposer une thérapie réparatrice pour les personnes atteintes de Parkinson.
🔗 En lien avec ce sujet : Les cellules souches du cerveau face au temps
Vers une médecine régénérative personnalisée pour les maladies neurodégénératives
Cette première application clinique de cellules souches iPS dans la maladie de Parkinson marque une étape clé dans le domaine de la médecine régénérative. L’étude prouve qu’il est désormais possible de reprogrammer des cellules adultes, de les transformer en neurones dopaminergiques, puis de les greffer dans le cerveau humain en toute sécurité. Mieux encore, ces cellules peuvent produire de la dopamine, s’intégrer aux circuits cérébraux et contribuer à améliorer les symptômes chez certains patients.
Comparée aux tentatives plus anciennes utilisant du tissu fœtal, cette approche présente des avantages majeurs. Elle est plus éthique, car elle n’implique pas de tissu embryonnaire ; plus standardisable, car les cellules sont produites selon des protocoles stricts ; et potentiellement plus accessible à long terme, grâce à des procédés de fabrication reproductibles. Il s’agit d’un changement de paradigme, on ne se contente plus de compenser les effets de la maladie, on cherche désormais à réparer les circuits abîmés.
La prochaine étape, déjà en préparation, sera un essai clinique de plus grande envergure, cette fois mené en double aveugle, avec un groupe placebo et un suivi renforcé, afin de confirmer l’efficacité du traitement à plus large échelle et mieux comprendre son impact sur les fonctions cognitives et la qualité de vie. D’autres pistes sont également à l’étude, comme l’augmentation de la dose de cellules implantées, l’élargissement des zones ciblées, ou encore l’association avec des traitements neuroprotecteurs qui prolongeraient les effets de la greffe.
En parallèle, la possibilité d’utiliser les propres cellules du patient, reprogrammées en laboratoire pour contourner le rejet immunitaire, suscite un intérêt croissant. Cette approche dite d’« autogreffe » a déjà été testée avec succès dans un cas isolé, et pourrait devenir, à terme, une alternative personnalisée et totalement compatible sur le plan immunologique.
🔗 Découvrez également : Synapses en souffrance : Comprendre la dégénérescence fronto temporale
L’essai de l’équipe de Kyoto représente donc bien plus qu’une avancée technique. Il dessine les contours d’une nouvelle génération de traitements pour les maladies neurodégénératives, où l’on ne traite plus uniquement les symptômes, mais où l’on envisage de restaurer les fonctions perdues. La route reste longue, mais cette étape ouvre une voie tangible vers une médecine du futur, capable de réparer le cerveau avec ses propres cellules.
Référence
Sawamoto, N., Doi, D., Nakanishi, E. et al. Phase I/II trial of iPS-cell-derived dopaminergic cells for Parkinson’s disease. Nature 641, 971–977 (2025).