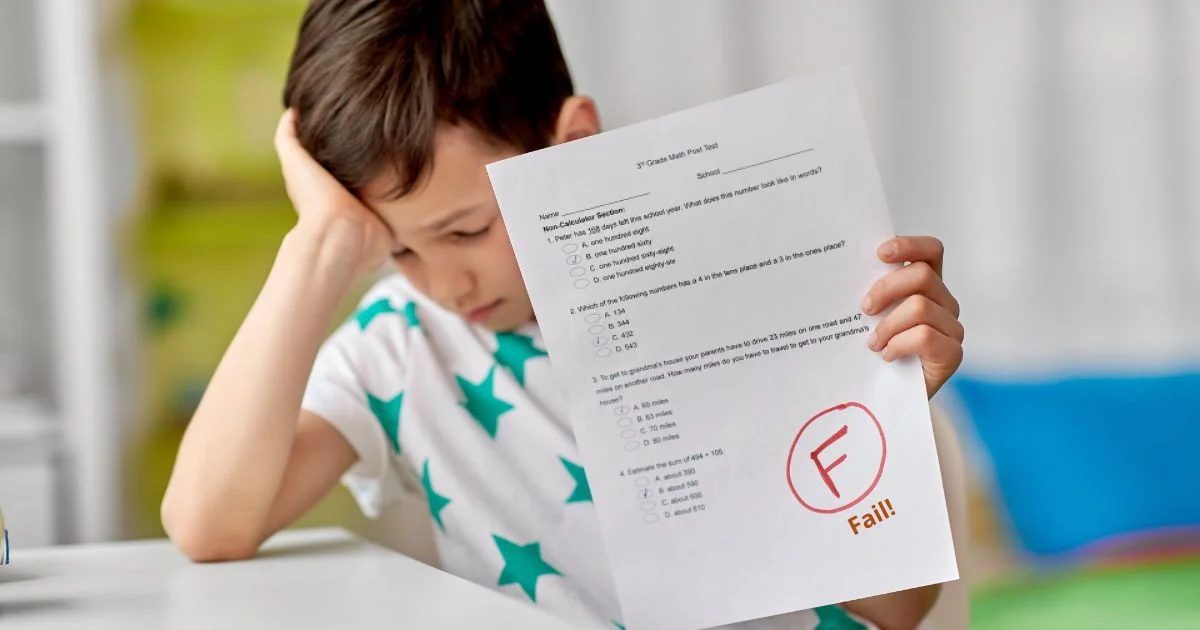Quand l’échec tue
Elle n’avait que 14 ans. Ce matin-là, elle s’est levée comme les autres, mais quelque chose avait changé. La veille, les résultats scolaires étaient tombés : elle avait échoué à son examen de troisième année. Un simple mot, échec, et tout son univers s’est effondré. Quelques heures plus tard, elle montait au troisième étage d’un immeuble… et sautait dans le vide.
C’est l’histoire tragique d’une adolescente d’El Jadida. Non pas une jeune fille qui refusait la vie, mais une enfant qui croyait ne plus avoir le droit de la mériter. Elle pensait avoir déçu. Déçu ses parents, ses professeurs, ses proches, et peut-être surtout, s’être déçue elle-même.
Pour elle, rater un examen n’était pas une simple difficulté passagère, mais une faute grave. Une tache sur son image, un verdict. Ce n’est donc pas l’échec en lui-même qui l’a brisée, mais la charge qu’on y avait associée. Ce que cet échec signifiait dans les regards des autres, et dans le sien. Car trop souvent, ce que l’enfant ressent ne vient pas de la réalité, mais du miroir que lui tendent les adultes.
Quand l’amour fait pression
L’échec scolaire, en soi, n’est ni une catastrophe ni une fatalité. Ce qui le rend douloureux, c’est souvent la manière dont il est perçu, interprété, et surtout, accueilli. Dans de nombreuses familles, l’exigence de réussite est profondément liée à l’amour parental. On pousse l’enfant à se surpasser, non par dureté, mais par souci de son avenir. On le félicite quand il réussit, on le réprimande quand il échoue, croyant, en toute bonne foi, qu’on l’aide à progresser. Pourtant, ce que l’adulte pense transmettre « je fais cela pour ton bien » peut être interprété tout autrement par l’enfant ou l’adolescent « Si je n’y arrive pas, je ne mérite pas d’être aimé. »
Ce malentendu entre le message des parents et la façon dont il est perçu par l’enfant repose sur le conditionnement affectif. Très tôt, l’enfant apprend à associer l’attention, la reconnaissance ou les marques d’affection à ce qu’il accomplit. Si les compliments arrivent surtout après de bonnes notes, et si les tensions apparaissent dès qu’il échoue, alors une idée insidieuse s’installe : « On m’aime quand je réussis. » Dans ce contexte, l’amour semble dépendre de la performance.
Peu à peu, l’école ne représente plus seulement un lieu d’apprentissage, mais un terrain d’évaluation de sa valeur personnelle. Chaque mauvaise note n’est plus un simple revers passager, elle devient une menace pour sa sécurité affective. l’enfant ne redoute pas seulement l’échec scolaire, mais ce qu’il pourrait provoquer dans le regard des autres. Ce n’est plus le bulletin qui est en jeu, c’est le sentiment d’être digne d’amour, d’attention ou de soutien.
Ce mécanisme s’enracine encore plus profondément à l’adolescence, une période marquée par une grande vulnérabilité émotionnelle et une intense reconfiguration cérébrale. Le cerveau adolescent est encore en chantier : les régions liées aux émotions, comme l’amygdale, deviennent particulièrement réactives, tandis que les zones préfrontales responsables du raisonnement, de la prise de recul et de la régulation des impulsions, sont encore en pleine maturation. Cette asymétrie rend les adolescents plus sensibles aux jugements extérieurs, aux critiques et aux échecs.
Dans ce contexte, une mauvaise note, un redoublement ou même une remarque apparemment anodine peuvent prendre des proportions démesurées parce que son système de traitement émotionnel est encore en train de se construire. Ce n’est pas seulement l’erreur qui est vécue, mais tout ce qu’elle semble remettre en cause : la valeur personnelle, la place au sein de la famille, l’estime de soi, et parfois même le sentiment d’appartenance au groupe. À cet âge où l’identité est en construction, rater un examen peut être vécu comme une véritable menace affective, bien plus que comme un simple obstacle à surmonter.
Face à cela, ni les familles ni les enseignants ne sont dans une logique punitive consciente. Au contraire, leurs attentes sont souvent motivées par le désir de bien faire. Mais les messages transmis peuvent, sans qu’ils le sachent, induire une pression implicite redoutable. Dire à un enfant « il faut que tu réussisses pour t’en sortir » revient, dans l’esprit encore malléable d’un adolescent, à poser la réussite comme condition de sa légitimité sociale. L’échec cesse alors d’être une étape normale du parcours pour devenir une sorte de faute morale.
🔗 À lire aussi : Apprendre à l’ère des robots : Le pari risqué de ChatGPT chez les ados
Apprendre à tout prix, mais à quel coût ?
Le système éducatif lui-même fonctionne sous une pression constante. Les enseignants doivent faire face à des classes surchargées, à des programmes denses, et à des objectifs de performance toujours plus exigeants. Dans ces conditions, il devient très difficile de s’adapter aux besoins émotionnels et cognitifs de chaque élève. L’école, qui devrait être un lieu d’apprentissage et de développement, est souvent poussée à se concentrer sur les résultats chiffrés, au détriment de l’écoute et de la relation humaine.
Lorsqu’un élève échoue, ce n’est pas toujours interprété comme un signal de détresse ou un besoin d’aide, mais plutôt comme un simple manque d’effort, voire de discipline. On suppose trop vite que l’élève « n’a pas travaillé » ou « ne s’est pas investi », sans toujours chercher à comprendre les raisons sous-jacentes. Pourtant, comme l’a souligné Daniel Favre, l’erreur ne s’oppose pas à la connaissance, elle en est une condition essentielle. Apprendre, c’est tâtonner, se tromper, recommencer. C’est en se confrontant à l’erreur que l’on progresse réellement.
Malgré les avancées en psychologie de l’éducation, cette vision reste encore marginale dans la pratique quotidienne. Trop souvent, l’erreur est sanctionnée par des notes décourageantes, le redoublement sert de punition implicite, et les encouragements vont principalement à ceux qui réussissent selon les critères standards. On valorise la conformité bien plus que l’effort, et les progrès discrets passent inaperçus. Dans ce contexte, l’élève reçoit un message implicite mais puissant : tu vaux ce que ta moyenne indique.
Les adolescents, dont l’image sociale est déjà un enjeu central, se retrouvent ainsi pris dans un réseau de jugements permanents. Chaque note, chaque évaluation, chaque bulletin scolaire porte en lui une charge symbolique qui dépasse largement la simple appréciation scolaire. Aux yeux de l’adolescent, un échec ne signifie pas seulement une difficulté dans une matière, il remet en question sa valeur personnelle, sa place dans sa famille, son groupe, sa communauté.
Il est essentiel de comprendre que ces blessures ne sont pas infligées par des adultes malveillants. Elles sont le résultat de mécanismes collectifs, souvent animés de bonnes intentions, mais mal ajustés aux réalités psychiques des enfants et des adolescents. Personne ne cherche délibérément à blesser. Pourtant, cela se produit, jour après jour, à force de reproduire des normes rigides et d’oublier que chaque parcours d’apprentissage est singulier.
Le drame que nous évoquons révèle une société qui peine encore à reconnaître l’échec comme une étape normale du développement personnel. Tant que la chute sera perçue comme une faute plutôt que comme une opportunité d’apprendre, tant que la vulnérabilité sera vécue comme une faiblesse honteuse, tant que l’amour semblera conditionné par la performance, nous continuerons à engendrer les mêmes blessures silencieuses, souvent invisibles jusqu’à ce qu’il soit trop tard.
🔗 Découvrez également : Une histoire par jour, et le cerveau s’éveille
Et si l’échec était une étape, pas une fin ?
Transformer en profondeur notre rapport à l’échec scolaire n’implique pas simplement de réduire la pression sur les élèves. Il s’agit d’un changement plus fondamental, celui de la culture éducative dans son ensemble. Tant que l’erreur sera perçue comme un signe de faiblesse ou un défaut à corriger, les élèves continueront à la craindre plutôt qu’à l’intégrer comme une partie normale de leur progression. Or, cette perception est en contradiction directe avec ce que nous enseigne aujourd’hui la neuro-éducation.
Loin d’être un simple faux pas, l’erreur est le moteur même de l’apprentissage. Car le cerveau humain n’apprend pas de manière linéaire ni parfaite. Il apprend par essais, erreurs et ajustements. Chaque fois que nous commettons une erreur, des circuits spécifiques dans le cerveau s’activent, notamment ceux impliqués dans la détection de l’erreur et la mise à jour des prédictions. Ces mécanismes permettent au cerveau de repérer ce qui ne fonctionne pas, de comparer la réponse attendue à la réponse obtenue, et d’ajuster progressivement ses modèles internes. En d’autres termes, se tromper n’est pas une anomalie, mais une étape essentielle du processus d’apprentissage.
Mais pour que le cerveau tire profit de l’erreur, encore faut-il que le climat émotionnel le permette. Si l’erreur est associée à la honte, à la peur ou au jugement, elle n’active plus les circuits de l’apprentissage, mais ceux du stress et de l’évitement. L’élève n’essaie plus, il se protège. Il ne prend plus de risques cognitifs, il se replie. Or, un enfant qui n’ose plus se tromper n’ose plus apprendre.
Et c’est là que l’environnement relationnel joue un rôle central. Peu d’enfants savent qu’ils ont le droit de se tromper sans perdre l’amour ou le respect de ceux qui les entourent. Peu d’adolescents savent qu’ils peuvent exprimer la tristesse, la déception ou la confusion sans être perçus comme faibles ou ingrats. Dans les familles où l’on évite les émotions, ou pire, où l’on confond fragilité et échec moral, l’enfant en souffrance s’enferme souvent dans le silence. Il ne demande pas d’aide, non par indifférence, mais parce qu’il pense que cela aggraverait sa faute ou sa dévalorisation.
Cette réalité appelle une remise en question profonde de nos façons d’enseigner, d’évaluer et d’accompagner les élèves. Cela commence par un changement de regard : redonner à l’erreur sa valeur formatrice, à l’effort la reconnaissance qu’il mérite, et à la progression lente le même respect qu’à la performance rapide. Mais cela suppose aussi de dissocier clairement la valeur d’un enfant de ses résultats scolaires. L’amour parental ne peut dépendre d’un classement, et l’estime sociale ne devrait jamais se construire sur l’humiliation de ceux qui avancent à leur rythme.
🔗 En lien avec ce sujet : La force née des fractures : Psychologie des crises et du rebond
Ce changement de culture éducative est devenu une nécessité face aux conséquences psychiques mesurables de la pression scolaire. Les recherches récentes confirment que lorsque le stress académique devient chronique et mal régulé, il peut fragiliser profondément la santé mentale des adolescents. Lorsqu’un élève vit l’école comme un espace de jugement permanent, où chaque note semble engager sa valeur ou son avenir, son image de soi peut vaciller. Et si, en plus, il se sent seul face à cette pression, le danger devient bien réel.
Car ce n’est pas tant l’intensité du stress qui déstabilise, que l’absence de ressources internes et externes pour y faire face. C’est là qu’interviennent les stratégies d’adaptation, et ce qu’on appelle la résilience. Lorsqu’un adolescent est confronté à un échec, il peut réagir de manières très différentes. Certains se replient, se jugent sévèrement, ou cherchent à fuir dans des distractions. Ce sont des réflexes naturels, mais qui, à long terme, risquent de l’enfermer dans une impasse émotionnelle. D’autres, au contraire, parviennent à prendre du recul, à demander de l’aide, à reformuler ce qu’ils vivent. Ils n’effacent pas la douleur, mais trouvent un chemin pour la traverser.
Cette résilience ou capacité à traverser la tempête sans sombrer, ne signifie pas que l’on ne souffre pas, ni que l’on encaisse tout en silence. Elle signifie qu’au fond de soi, on conserve la conviction que la chute n’est pas la fin de l’histoire. Qu’il est possible d’apprendre, de se relever, d’essayer autrement. Pourtant, cette force n’est pas innée. Elle se construit, lentement, patiemment. Et souvent, elle se forge dans le regard des autres. Lorsqu’un enfant sent que son entourage continue de croire en lui, même après un échec, il commence à intégrer l’idée qu’il peut se remettre en mouvement.
C’est pourquoi la présence d’un adulte bienveillant, un parent, un enseignant, un proche, peut faire toute la différence. Un adulte qui ne minimise pas la douleur, mais qui ne la dramatise pas non plus. Un adulte qui dit : « Je sais que c’est dur, mais je suis là. Et tu peux recommencer. » Ces mots simples peuvent devenir une ancre, un repère, un souffle. Nous ne pouvons pas supprimer tous les obstacles du chemin de nos enfants, mais nous pouvons les aider à s’équiper de cette boussole intérieure qui leur permettra de les franchir.
Le drame que nous évoquons ici ne doit pas être considéré comme une simple tragédie isolée. Il met en lumière les angles morts d’un modèle qui accorde trop de place à la compétition, et pas assez à la construction intérieure. Il rappelle que, pour certains enfants, une mauvaise note peut devenir une blessure existentielle si elle n’est pas accompagnée. La mort de cette jeune fille témoigne d’un amour mal exprimé, d’une peur du jugement, d’un monde où le droit de trébucher semble refusé. Son geste, aussi déchirant soit-il, doit aujourd’hui devenir un signal d’alarme. Un appel à la lucidité. Nous devons réapprendre à nos enfants que l’échec n’est pas une condamnation, mais une étape parmi d’autres. Qu’ils ont le droit de rater sans être rejetés. Le droit de demander de l’aide sans craindre le jugement. Le droit de rester aimés, surtout lorsqu’ils sont vulnérables. Et, plus que tout, le droit de ne jamais se sentir seuls.
Références
Liu, L., Wang, W., Lian, Y., Wu, X., Li, C., & Qiao, Z. (2023). Longitudinal Impact of Perfectionism on Suicidal Ideation among Chinese College Students with Perceived Academic Failure: The Roles of Rumination and Depression. Archives of Suicide Research, 28(3), 830–843.
Okechukwu, C. E., Dirisu, O. J., Agberotimi, S. F., & Asante, K. O. (2022). Academic stress, coping styles, and suicidal ideation in a sample of Nigerian university students. BMC Psychiatry, 22(1), 891.
Zhao, Y., Maes, J. H. R., & Li, X. (2023). Association of stress exposure and parental involvement with suicide risk among adolescents: A school-based study. medRxiv.

Sara Lakehayli
Docteur en neuroscience cliniques et santé mentale, PhD
Membre associée au Laboratoire des Maladies du Système Nerveux, Neurosensorielles et du Handicap, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca.
Professeur à l'école supérieure de psychologie