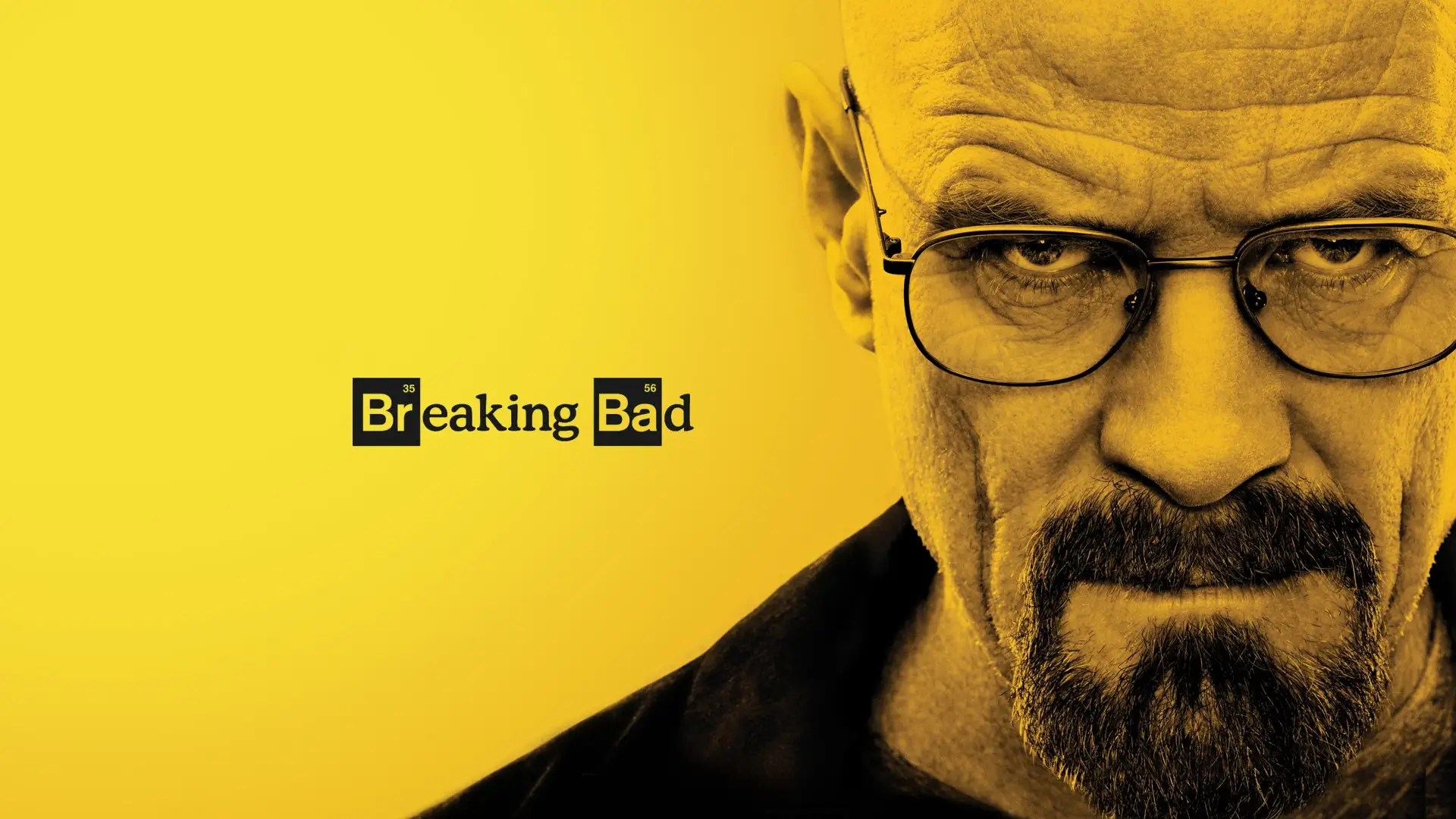Braking bad : La glorification du mal
Je ne suis pas en danger Skyler. Je suis le Danger
Oui, on a adoré cette série. Oui, elle figure régulièrement dans le top des classements mondiaux, et j’ai moi-même suivie Walter White avec enthousiasme, épisode après épisode. Mais ne trouvez-vous pas troublant, presque malsain, d’aduler un professeur devenu criminel, un trafiquant de drogue avide de pouvoir, prêt à tuer pour grimper dans les échelons du crime ?
Cette tension est au cœur de Breaking Bad : comment une œuvre peut-elle nous captiver, nous attacher et parfois même nous surprendre à espérer la réussite de Walter White, alors que ses actes le placeraient, hors de la fiction, du côté de ceux que nous condamnons sans hésitation.
Cette série, diffusée de 2008 à 2013, ne s’est pas contentée de réunir des millions de téléspectateurs autour d’un récit sombre ; elle est devenue un phénomène culturel global. Le personnage de Walter White, alias Heisenberg, a dépassé le cadre du petit écran pour s’imprimer dans la culture populaire. Son visage, son regard froid, et certaines de ses répliques : « Je ne suis pas en danger… je suis le danger » ou « Dites mon nom », ont été reprises, traduites et mémorisées par les fans comme des lignes devenues presque mythiques du XXIᵉ siècle télévisuel
Les images et les motifs de la série ont aussi investi l’espace réel. Des t-shirts à l’effigie de Los Pollos Hermanos, ce faux restaurant qui sert de façade à un réseau criminel dans l’univers de la série, sont portés par des fans et vendus sur des boutiques spécialisées, transformant un symbole fictionnel en objet de mode reconnaissable instantanément. Cet attachement va au-delà du simple déguisement : il témoigne d’une émulation profonde entre le public et l’esthétique narrative de la série, où des éléments de fiction deviennent des marqueurs d’identité culturelle.
Dans son regard
Dès le début, Breaking Bad adopte un dispositif narratif précis : elle aligne le spectateur sur Walter White. La série choisit de nous faire avancer avec lui, rarement contre lui. Nous savons ce qu’il sait, nous découvrons les événements à son rythme, et nous sommes placés dans la continuité de ses décisions. Avant toute évaluation morale, la série impose un point de vue.
En théorie du cinéma, ce mécanisme est souvent décrit comme un alignement spectatoriel, un concept notamment travaillé par Murray Smith. Il ne s’agit pas encore d’empathie morale ni d’adhésion éthique, mais d’un partage d’informations, de perceptions et de perspective. Le spectateur n’est pas invité à approuver Walter White, mais à comprendre sa logique de l’intérieur.
Une scène du tout premier épisode illustre parfaitement ce procédé : celle du ride-along avec Hank Schrader, lorsque Walter accompagne son beau-frère lors d’une intervention antidrogue. La séquence est décisive. Le spectateur observe le monde du trafic de méthamphétamine non pas à travers le regard des forces de l’ordre, mais à travers celui de Walter. La caméra insiste sur ce qu’il voit : l’argent saisi, la facilité apparente avec laquelle d’autres exploitent un savoir chimique qu’il maîtrise mieux qu’eux, et surtout l’humiliation silencieuse de se sentir invisible, inutile, sous-estimé. Rien n’est encore illégal de son côté, mais tout est déjà en place sur le plan narratif.
À ce moment-là, la série ne nous montre pas encore les conséquences du crime. Elle nous montre l’injustice ressentie, le déséquilibre perçu, le décalage entre compétence et reconnaissance. Le spectateur ne suit pas une idéologie, il suit un raisonnement. Et parce que nous disposons des mêmes informations que Walter White, parce que nous partageons son point de vue, la distance critique commence à se réduire, sans que nous en ayons pleinement conscience.
Ce choix narratif est fondamental. Il prépare le terrain de tout ce qui suivra. En nous plaçant si tôt dans la perspective de Walter White, Breaking Bad rend possible un glissement progressif : nous ne sommes pas encore dans l’empathie, mais nous avons déjà quitté la neutralité. Et une fois ce déplacement opéré, juger devient plus difficile.
🔗À lire aussi : Du divan à la caméra : Les Psy font leur cinéma
Le premier pas
Si Breaking Bad parvient à nous faire accepter l’inacceptable, ce n’est pas par rupture brutale, mais par glissement progressif. La série exploite un mécanisme psychologique bien documenté : nous tolérons plus facilement une transgression lorsqu’elle est graduelle et qu’elle semble répondre, au départ, à une cause perçue comme légitime, protéger sa famille, assurer une survie économique, réparer une injustice sociale.
En psychologie morale, ce phénomène est lié à ce que certains chercheurs décrivent comme une normalisation progressive de la déviance. Une première action moralement discutable, lorsqu’elle paraît compréhensible, sert de point d’ancrage. Les actes suivants, bien que plus graves, sont alors évalués non plus selon une morale externe, mais par comparaison avec les choix précédents. Le seuil de tolérance se déplace.
Breaking Bad épouse précisément cette logique. Walter White ne bascule jamais d’un coup. Chaque étape est présentée comme une réponse circonstancielle, presque raisonnable dans son contexte immédiat. Le récit ne demande pas au spectateur d’accepter le crime dans son ensemble, mais d’accepter chaque décision prise isolément. Et c’est cette fragmentation morale qui rend l’ensemble supportable, du moins pendant un temps.
Quand le Mal est bien fait
Si Breaking Bad parvient à rendre Walter White fascinant, ce n’est pas uniquement par l’écriture ou la progression narrative, mais par un travail de mise en scène extrêmement conscient. La série ne se contente pas de raconter la montée en puissance de son personnage : elle la met en image, elle la stylise, elle la rend désirable.
Au fil des saisons, la réalisation accompagne la transformation de Walter White en figure de pouvoir. Le langage visuel évolue avec lui. Plus Walter affirme son autorité, plus la caméra le filme comme un personnage dominant : contre-plongées, cadres stables, compositions symétriques, placements centraux dans l’image. Là où le Walter du début est souvent écrasé par son environnement, perdu dans des cadres larges, dominé par les autres personnages, le Walter devenu Heisenberg occupe progressivement l’espace. L’image lui appartient.
La série exploite également une esthétique du contrôle et de la maîtrise. De nombreuses scènes montrent Walter immobile pendant que le monde autour de lui s’agite. Les silences sont prolongés, les dialogues réduits au minimum, laissant la mise en scène suggérer la menace plutôt que l’exprimer. Cette économie de paroles renforce l’impression de puissance : Walter n’a plus besoin de convaincre, il impose. Le spectateur, lui, est invité à admirer cette transformation visuelle, parfois sans même s’en rendre compte.
Un autre élément clé est le traitement de la violence. Breaking Bad ne la montre pas toujours frontalement. Souvent, elle est préparée, ritualisée, puis suivie d’un moment de calme presque esthétique. Certaines scènes de mort ou de domination sont filmées avec une précision formelle qui neutralise partiellement leur brutalité morale. La violence devient un événement narratif fort, presque “beau” dans sa construction visuelle. Ce choix n’excuse pas les actes, mais il en modifie la réception émotionnelle.
La musique joue un rôle tout aussi central. Plutôt que de souligner la gravité morale des situations, elle accompagne fréquemment les moments de réussite de Walter avec des choix musicaux ironiques, stylisés ou énergiques. Ces séquences — montages, plans larges, rythmes affirmés — transforment des actions criminelles en moments de triomphe narratif. Le spectateur ressent alors une satisfaction esthétique qui entre en contradiction avec le contenu moral de la scène.
Enfin, l’esthétique globale de la série — couleurs contrastées, symbolique des costumes, décors iconiques — contribue à construire une mythologie visuelle. Le chapeau noir de Heisenberg, le laboratoire souterrain, le désert du Nouveau-Mexique : autant d’éléments qui participent à l’iconisation du personnage. Walter White n’est plus seulement un individu, il devient une figure, presque un emblème. Et une figure, au cinéma, appelle rarement le rejet immédiat ; elle appelle la contemplation.
C’est ici que la glorification opère pleinement. Breaking Bad ne nous dit jamais explicitement d’admirer Walter White. Elle le fait autrement : en le filmant comme le cinéma filme traditionnellement les personnages puissants, charismatiques, mémorables. Le mal n’est pas justifié par le discours, mais embelli par la forme. Et lorsque la forme séduit, le jugement moral devient secondaire.
🔗Découvrez également : Chute libre : Une plongée vers la rupture mentale
Je l’ai fait pour moi. J’aimais ça. J’étais bon dans ce domaine… j’étais vivant
Quand Walter White se rase le crâne, quelque chose se ferme. Le visage devient plus dur, plus lisible, presque iconique. Ce n’est pas encore Heisenberg dans toute sa puissance, mais ce n’est déjà plus l’homme ordinaire qu’il prétend être. À partir de là, il ne cherche plus à être jugé ni compris. La question n’est plus celle du bien ou du mal au sens collectif, mais celle d’une morale personnelle, construite selon ses propres règles.
Breaking Bad opère alors un déplacement décisif : la série ne demande plus au spectateur d’évaluer les actes de Walter selon une morale partagée, mais de vérifier leur cohérence interne. Le jugement moral est remplacé par un raisonnement logique. La question implicite n’est plus « est-ce juste ? », mais « est-ce cohérent avec ce qu’il est devenu ? ».
Ce procédé est central. La série ne nous pousse pas à approuver Walter White ; elle nous entraîne à suivre sa logique. Chaque décision est présentée comme une étape rationnelle dans un système déjà en place. Les actes ne sont plus isolés, mais intégrés dans une continuité narrative qui leur donne un sens fonctionnel. Le spectateur n’évalue plus les conséquences humaines, mais la solidité du raisonnement.
La morale de Walter devient ainsi un outil narratif. Elle sert de filtre à la perception du spectateur. Tant que cette morale interne reste stable, structurée, compréhensible, la série maintient l’adhésion cognitive. Le spectateur peut désapprouver abstraitement, tout en continuant à suivre, à anticiper, à attendre la prochaine décision comme on attend le coup suivant dans une partie d’échecs.
Ce glissement est d’autant plus efficace que la série évite toute confrontation morale frontale. Les conséquences éthiques sont souvent différées, déplacées ou absorbées par la logique du récit. La souffrance causée existe, mais elle est rarement le point focal. Ce qui prime, c’est la cohérence du système que Walter a construit — un système qui fonctionne, du moins provisoirement.
Ainsi, Breaking Bad ne nous fait pas oublier la morale en la niant, mais en la déplaçant. Elle remplace une morale collective, fondée sur des règles partagées, par une morale de fonctionnement, fondée sur l’efficacité et la cohérence. Et tant que cette cohérence tient, le spectateur tient avec elle.
C’est précisément ici que la série est la plus troublante : elle démontre que le mal n’a pas besoin d’être séduisant pour être accepté. Il lui suffit d’être logiquement raconté.
🔗À lire aussi : La cigarette au cinéma: Une grammaire visuelle héritée
L’empathie n’est plus un choix
Le glissement moral est désormais bien installé. L’identification à Walter White a opéré. Breaking Bad va alors plus loin : elle place le spectateur dans une position de complicité émotionnelle involontaire. Certaines scènes sont construites pour susciter de la tension, voire un soulagement, lorsque Walter échappe aux conséquences immédiates de ses actes. Ce soulagement est révélateur. Il ne signifie pas une approbation morale consciente, mais il trahit une implication affective que la série a patiemment construite.
C’est ici que Breaking Bad devient profondément dérangeante. Elle ne nous demande jamais explicitement d’aimer Walter White. Elle démontre plutôt que, placés dans certaines conditions narratives, nous pouvons continuer à ressentir de l’empathie pour un personnage que nous condamnons pourtant sur le plan rationnel.
Par la forme, la logique et la continuité du point de vue, Breaking Bad ne se contente pas de représenter le mal : elle en organise la glorification en affaiblissant progressivement le jugement moral du spectateur.
En ce sens, Breaking Bad ne raconte pas seulement la chute d’un homme. Elle met en lumière une faille du spectateur lui-même. Elle montre que l’empathie, loin d’être un indicateur moral fiable, peut se transformer en réflexe narratif. Et lorsque ce réflexe s’installe, le mal n’a plus besoin d’être justifié ni défendu : il est simplement suivi — à moins que le spectateur ne choisisse consciemment de reprendre une distance critique.
Cette fascination ne s’est pas limitée à l’écran. En 2015, en Italie, un étudiant de 22 ans a été arrêté après le démantèlement d’un laboratoire clandestin de méthamphétamine ; les autorités ont explicitement indiqué que le jeune homme s’était inspiré de Breaking Bad et de Walter White, professeur de chimie devenu fabricant de drogue dans la série. Il ne s’agit pas d’accuser la fiction de provoquer le crime, mais de constater jusqu’où une narration peut imprimer des imaginaires, des modèles et des désirs de transgression.
Ce fait divers agit comme un révélateur. Breaking Bad ne pousse pas ses spectateurs à fabriquer de la drogue, mais elle montre qu’un récit peut rendre le mal intelligible, fascinant et imitable.
Références
Bandura, A. (2016). Moral disengagement: How people do harm and live with themselves. Worth Publishers.
Bordwell, D. (1985). Narration in the fiction film. University of Wisconsin Press.
Elsaesser, T., & Hagener, M. (2015). Film theory: An introduction through the senses. Routledge.
Mittell, J. (2015). Complex TV: The poetics of contemporary television storytelling. New York University Press.
Plantinga, C. (2018). Screen stories: Emotion and the ethics of engagement. Oxford University Press.
Prince, S. (2003). Classical film violence: Designing and regulating brutality in Hollywood cinema. Rutgers University Press.
Smith, M. (1995). Engaging characters: Fiction, emotion, and the cinema. Oxford University Press.

Amine Lahhab
Réalisateur
Master en Réalisation- Ecole Supérieur de l'AudioVisuel (ESAV), Université de Toulouse.
License en Histoire- Université Hassan 2 de Casablanca.
DEUG en Philosophie- Université Hassan 2 de Casablanca.