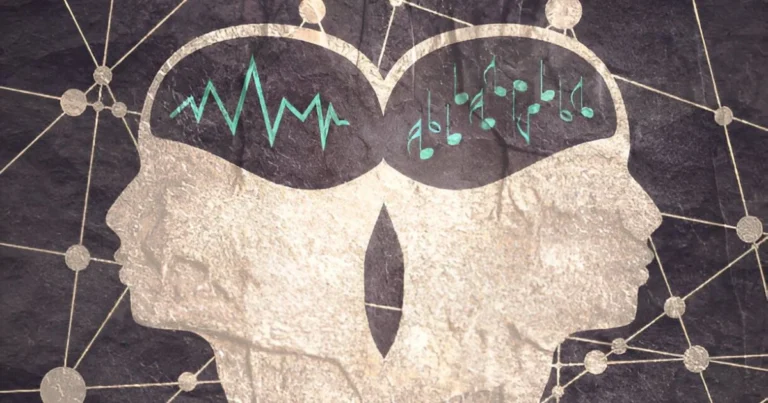Apprendre une nouvelle langue fait-il oublier les anciennes ?
L’apprentissage des langues est souvent perçu comme une richesse, une ouverture vers de nouveaux horizons culturels et cognitifs. Pourtant, de nombreux polyglottes rapportent une étrange difficulté. En acquérant une nouvelle langue, ils peinent parfois à retrouver des mots dans celles qu’ils maîtrisaient auparavant. Ce phénomène, à la fois troublant et intrigant, soulève une question essentielle. Notre cerveau est-il conçu pour accumuler indéfiniment des langues, ou l’introduction d’un nouvel idiome perturbe-t-elle l’accès aux langues déjà acquises ?
Une étude récente menée par des chercheurs en psycholinguistique apporte des éléments de réponse qui mettent en lumière les nuances de la mémoire linguistique et les mécanismes d’interférence qui façonnent notre capacité à jongler entre plusieurs langues.
Les mécanismes de l’interférence linguistique
Une équipe de chercheurs de l’Université Radboud s’est intéressée à l’impact de l’interférence rétroactive sur la mémoire linguistique, afin de mieux comprendre les interactions entre l’apprentissage d’une nouvelle langue et l’accessibilité des langues précédemment acquises. Leur étude, publiée dans le Quarterly Journal of Experimental Psychology en 2024, met en évidence un phénomène clé de la cognition. Lorsque nous apprenons une nouvelle langue, l’accès aux langues antérieures peut être momentanément perturbé. Ce mécanisme, bien documenté en psychologie cognitive, se traduit par une difficulté accrue à retrouver des mots déjà appris, suggérant que le cerveau réajuste dynamiquement ses connexions linguistiques au gré des nouvelles acquisitions. Cette dynamique soulève des questions fondamentales sur la plasticité cérébrale et la manière dont les différentes langues coexistent dans notre mémoire.
L’idée que les langues apprises en dernier puissent venir brouiller les anciennes repose sur le principe de compétition lexicale. Lorsqu’un individu multilingue tente de récupérer un mot, toutes les représentations associées à ce concept s’activent simultanément, y compris celles dans d’autres langues. Ce phénomène, bien documenté par la psycholinguistique, pourrait expliquer pourquoi, dans certains cas, apprendre une nouvelle langue rend plus difficile l’accès aux langues déjà acquises.
L’idée que les langues apprises en dernier puissent venir brouiller les anciennes repose sur le principe de compétition lexicale.
🔗 À lire aussi : La fenêtre manquée : L’histoire de Victor, l’enfant sauvage
Quand l’apprentissage d’une langue en bouscule une autre
L’étude a recruté 26 locuteurs natifs néerlandais maîtrisant l’anglais comme seconde langue (L2) mais n’ayant jamais appris l’espagnol (L3). Les chercheurs ont d’abord mesuré leur connaissance de l’anglais en leur demandant de nommer 46 objets en anglais. Ensuite, la moitié de ces mots leur a été enseignée en espagnol. Enfin, un test final a mesuré leur capacité à retrouver ces mots en anglais. Deux expériences ont été menées. La première au sein d’une même session, et la seconde avec un délai de consolidation entre l’apprentissage de l’espagnol et le test en anglais.
Les résultats de la recherche révèlent que les participants éprouvaient davantage de difficultés à récupérer les mots en anglais après avoir appris leur traduction en espagnol, par rapport à ceux pour lesquels aucune interférence n’avait été introduite. De plus, ce phénomène ne s’est pas atténué avec le temps, suggérant que l’effet d’interférence apparaît immédiatement après l’apprentissage et ne nécessite pas de consolidation pour s’intensifier. Ces observations confirment un effet de compétition linguistique où l’accès à une langue en inhibe temporairement une autre. De nombreux bilingues en font l’expérience au quotidien, lorsqu’un mot dans leur langue maternelle leur échappe après avoir intensifié leur usage d’un autre idiome. Cette interférence semble d’ailleurs particulièrement marquée chez ceux qui, par immersion, adoptent une nouvelle langue au détriment de leur langue d’origine.
La question se pose alors de savoir si cette interférence est inévitable ou si elle peut être atténuée par des stratégies adaptées. Bien que troublante, elle n’est pas une fatalité. Les recherches récentes suggèrent que la réactivation régulière d’une langue, par l’usage ou l’exposition, permet d’en limiter l’érosion et de restaurer son accessibilité, empêchant ainsi qu’elle ne glisse dans l’oubli. Ce phénomène, connu sous le nom d’attrition linguistique, désigne la perte progressive d’une langue que l’on utilise moins fréquemment.
🔗 Découvrez également : Le professeur qui ne pouvait plus lire
Toutefois, cette difficulté d’accès ne signifie pas une disparition irréversible. Les recherches en neurosciences du langage confirment que l’empreinte de la langue maternelle persiste dans le cerveau, même après des années de non-utilisation. Une étude réalisée par l’Université McGill et l’Institut Neurologique de Montréal a démontré, grâce à l’imagerie cérébrale, que des adultes d’origine coréenne, adoptés très jeunes par des familles néerlandophones et n’ayant plus été exposés au coréen depuis l’enfance, activaient encore des zones cérébrales spécifiques à cette langue lorsqu’ils étaient exposés à des sons coréens. De manière similaire, une autre étude menée auprès de jeunes filles chinoises adoptées par des familles francophones a révélé que, bien qu’elles n’aient plus pratiqué le chinois depuis plusieurs années, leur cerveau réagissait différemment à la langue française par rapport aux monolingues francophones, montrant une influence persistante de leur langue maternelle sur le traitement du langage.
Ces résultats suggèrent que l’attrition linguistique ne résulte pas d’un effacement des traces mnésiques, mais plutôt d’une accessibilité réduite aux connaissances stockées, due à une activation plus faible des réseaux neuronaux impliqués. Cette observation est renforcée par une étude publiée dans le Royal Society Open Science, qui a examiné la perception des sons coréens chez des adultes néerlandais. Parmi eux, un groupe était composé de personnes nées en Corée et adoptées avant l’âge de six ans par des familles néerlandophones, tandis que l’autre groupe n’avait jamais été exposé au coréen. Les résultats ont montré que les adoptés coréens, bien qu’ayant complètement cessé de parler leur langue natale, étaient toujours capables de distinguer les contrastes phonétiques du coréen avec une précision bien supérieure à celle des participants n’ayant jamais été exposés à cette langue.
Ces résultats suggèrent que l’attrition linguistique ne résulte pas d’un effacement des traces mnésiques, mais plutôt d’une accessibilité réduite aux connaissances stockées, due à une activation plus faible des réseaux neuronaux impliqués.
Ces résultats indiquent que l’apprentissage précoce d’une langue laisse une empreinte mnésique durable, même si son usage cesse complètement, et qu’une exposition ultérieure peut faciliter la récupération de cette langue. Par conséquent, une pratique adaptée, reposant sur une exposition active, une alternance maîtrisée entre les langues et des rappels contextuels fréquents, peut significativement atténuer ces effets. Lire, écouter ou parler régulièrement dans la langue en question, en particulier dans des contextes riches et variés, favorise son maintien et sa fluidité.
À cela s’ajoute le sommeil, ce mystérieux artisan de la mémoire, qui joue un rôle clé dans la consolidation et la stabilisation des souvenirs linguistiques, rendant les mots moins vulnérables à l’oubli. Mais toutes les langues ne sont pas égales face à l’oubli. L’environnement dans lequel elles sont apprises façonne leur résilience. Une langue acquise dans un cadre riche, varié et stimulant s’ancre plus solidement, résistant mieux aux interférences.
Ainsi, loin d’être un champ de bataille où les langues se disputent l’espace mental, notre cerveau semble plutôt ajuster dynamiquement leurs connexions, naviguant entre elles avec une plasticité fascinante. Bien que l’apprentissage d’une nouvelle langue puisse temporairement entraver l’accès aux langues antérieures, ces dernières ne disparaissent pas pour autant. Elles restent profondément ancrées dans les circuits neuronaux et peuvent être réactivées grâce à une exposition renouvelée ou une stimulation ciblée. L’attrition linguistique, loin d’être un simple phénomène de suppression, semble plutôt relever d’une réorganisation dynamique des priorités cognitives en fonction des besoins communicationnels de l’individu. Ainsi, la plasticité cérébrale joue un rôle déterminant dans le maintien des langues et leur récupération potentielle, renforçant l’idée que la langue maternelle constitue un ancrage linguistique durable, même en l’absence prolongée d’utilisation.
🔗 À lire aussi : Les Himba : Quand les mots peignent les couleurs
Ces résultats indiquent que notre cerveau ne stocke pas simplement des informations de manière rigide, il les structure en réseaux interconnectés, où chaque nouvelle liaison peut redéfinir l’accès aux connaissances existantes. Plutôt qu’une perte irrémédiable, l’interférence met en lumière un apprentissage linguistique dynamique, marqué par des interactions entre les langues, parfois conflictuelles, mais aussi enrichissantes. La fluidité avec laquelle un multilingue passe d’une langue à l’autre dépend de nombreux facteurs, notamment de l’usage qu’il en fait, de la fréquence d’activation des différentes langues et des stratégies qu’il met en place pour maintenir son répertoire linguistique actif.
La mémoire humaine n’est pas un coffre-fort où s’accumulent passivement des souvenirs intacts, mais plutôt un organisme vivant, en perpétuelle adaptation. Ainsi, apprendre une nouvelle langue ne fait pas disparaître les anciennes, mais réorganise la manière dont nous y avons accès. C’est un processus fluide, parfois chaotique, mais toujours révélateur de la fascinante flexibilité de la cognition humaine.
Références
Mickan, A., Slesareva, E., McQueen, J. M., & Lemhöfer, K. (2024). New in, old out: Does learning a new language make you forget previously learned foreign languages? Quarterly Journal of Experimental Psychology, 77(3), 530–550.
Pierce, L. J., Chen, J. K., Delcenserie, A., Genesee, F., & Klein, D. (2015). Past experience shapes ongoing neural patterns for language. Nature Communications, 6, 10073.