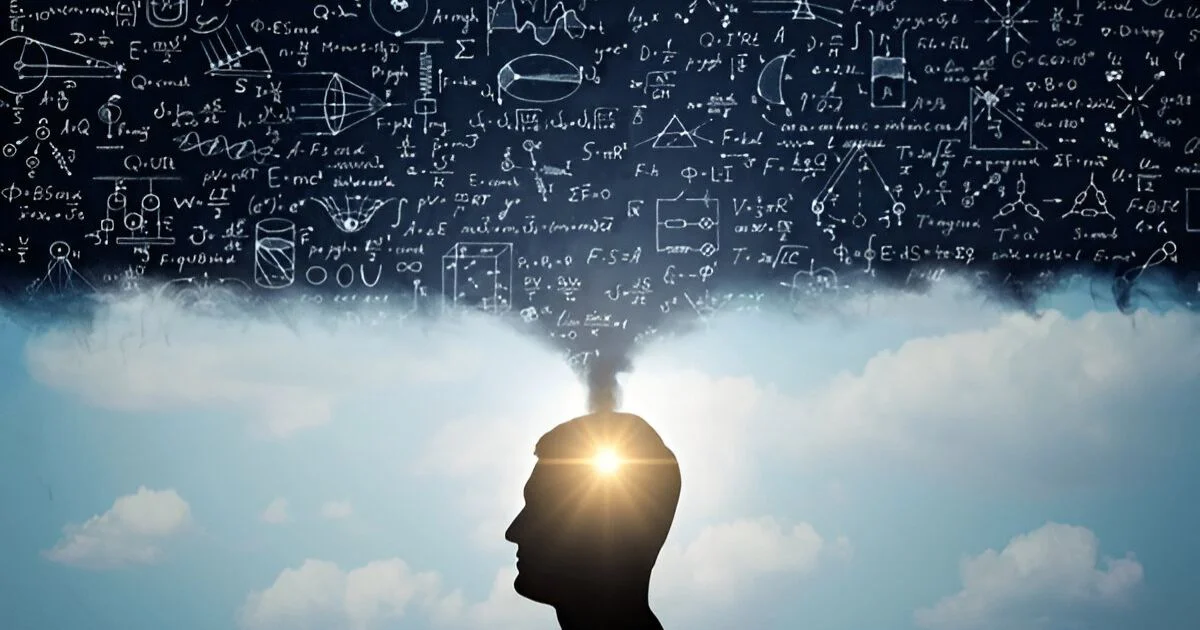Alzheimer sous la loupe des équations
La maladie d’Alzheimer demeure l’un des défis majeurs de la neurologie, tant par son ampleur épidémiologique que par la complexité de ses mécanismes. Si les plaques amyloïdes et les enchevêtrements de protéine tau sont bien identifiés comme des marqueurs pathologiques, une question essentielle reste ouverte : pourquoi certaines régions cérébrales se dégradent très tôt tandis que d’autres semblent résister longtemps à l’agression ? Cette sélectivité de la vulnérabilité et de la résilience constitue un angle d’analyse essentiel, car elle conditionne la progression clinique et oriente les pistes thérapeutiques. Pour éclairer cette énigme, une équipe de l’Université de Californie à San Francisco a adopté une approche originale, fondée sur l’application de modèles mathématiques permettant de cartographier la diffusion de la pathologie tau et de la confronter aux signatures génétiques de vulnérabilité.
Quand les équations s’invitent dans la recherche sur Alzheimer
Depuis plus de trente ans, on sait que la protéine tau ne se dépose pas au hasard mais suit un parcours précis, partant de l’hippocampe et du cortex entorhinal pour gagner progressivement d’autres zones. Pourtant, certaines régions comme les aires sensorielles restent longtemps épargnées, ce qui laisse penser que toutes les cellules nerveuses n’ont pas la même fragilité face à la maladie. Les explications classiques, centrées sur le métabolisme ou la résistance au stress oxydatif, offrent des pistes, mais elles ne suffisent pas à expliquer pourquoi la pathologie progresse selon des itinéraires aussi réguliers et prédictibles. Pour dépasser ces limites, l’étude de Chaitali Anand et de ses collègues de l’Université de Californie à San Francisco propose d’ajouter un outil inédit : les mathématiques.
En appliquant un modèle de diffusion en réseau enrichi, l’extended network diffusion model (eNDM), les chercheurs simulent la manière dont la protéine tau se propage le long des fibres reliant les différentes régions du cerveau, tout en prenant en compte la tendance des cellules à accumuler ou à éliminer cette protéine. Le principe est de comparer deux cartes : celle prédite par les équations et celle réellement observée grâce à l’imagerie TEP-tau de 196 patients. Les zones où les deux cartes divergent deviennent alors des indices précieux de l’influence de facteurs supplémentaires, notamment génétiques. Cette approche, qui combine imagerie cérébrale, connectivité et mathématiques, marque un tournant. Elle permet pour la première fois de distinguer ce qui relève du réseau de communication du cerveau de ce qui dépend de la biologie propre à chaque région.
🔗 À lire aussi : Le soi effacé : Alzheimer et l’anosognosie de la mémoire
Gènes et réseaux : un dialogue décisif
Les résultats indiquent que le modèle mathématique reproduit en grande partie la carte des dépôts de tau, confirmant que les connexions cérébrales jouent un rôle essentiel dans la progression de la maladie. Mais certaines zones, notamment temporales et orbitofrontales, présentent une accumulation plus élevée que prévu, signe que d’autres facteurs, en particulier génétiques, entrent en jeu. En croisant les données d’imagerie avec l’expression de cent gènes de risque connus, les chercheurs identifient quatre profils distincts : vulnérabilité liée au réseau, vulnérabilité indépendante du réseau, résilience liée au réseau et résilience indépendante.
Autrement dit, certains gènes modulent la propagation en suivant les connexions, tandis que d’autres influencent directement la fragilité des cellules. Dans le premier cas, on retrouve par exemple MAPT, gène de la protéine tau, et TSPOAP1, impliqué dans l’inflammation. Dans le second, des gènes comme PRNP ou JAZF1 renforcent le risque, alors que BACE1 et FOXF1 semblent jouer un rôle protecteur. L’analyse fonctionnelle confirme cette répartition : les gènes liés au réseau interviennent surtout dans la mort neuronale et la réponse au stress, tandis que les gènes indépendants sont davantage associés au métabolisme de l’amyloïde et à l’immunité.
Cette approche intégrée éclaire un paradoxe longtemps débattu : pourquoi la carte des gènes de risque ne correspond-elle pas toujours à la carte réelle de la pathologie ? La réponse tient à la coexistence de deux dynamiques, l’une guidée par les circuits de communication du cerveau, l’autre dictée par la biologie propre de chaque région. En pratique, cette distinction ouvre la voie à des stratégies thérapeutiques plus ciblées : agir soit sur les mécanismes de propagation, soit sur les défenses locales. Plus largement, elle montre comment mathématiques, génétique et imagerie peuvent s’associer pour renouveler la compréhension d’Alzheimer et esquisser de nouvelles pistes de prévention.
📖 Découvrez également: Les faux souvenirs : Quand notre mémoire nous joue des tours
L’étude d’Anand et de ses collègues montre toute la richesse qu’apporte le croisement de disciplines traditionnellement séparées. En combinant équations mathématiques et données génétiques, ils dessinent une carte inédite de la vulnérabilité cérébrale face à Alzheimer, qui distingue l’influence des réseaux de communication neuronaux de celle des mécanismes propres à chaque région. Si ces résultats doivent encore être confirmés et élargis, cette approche intégrée ouvre une voie prometteuse, celle d’une modélisation globale de la maladie, capable de relier gènes, connectivité et imagerie pour mieux comprendre comment se tissent la fragilité et la résilience du cerveau.
Référence
Anand, C., Abdelnour, F., Sipes, B., Ma, D., Maia, P. D., Torok, J., & Raj, A. (2025). Selective vulnerability and resilience to Alzheimer’s disease tauopathy as a function of genes and the connectome. Brain.